Chapitre VI La circulation coronaire • 2 artères coronaires issues du sinus aor
Chapitre VI La circulation coronaire • 2 artères coronaires issues du sinus aortique : - Artère coronaire gauche issue du sinus aortique antéro-gauche - Artère coronaire droite issue du sinus aortique antéro-droit • Cheminent dans les sillons en « couronne » I. Rappel Anatomique Circulation coronarienne • Coronaire gauche : - Issue du sinus aortique au-dessus de la valvule antéro-gauche - Tronc initial dit « tronc commun » - qui se divise en une artère inter-ventriculaire antérieure, qui descend dans le sillon IVA, donne des diagonales, des septales, et des ventriculaires droites - et une circonflexe qui descend dans le sillon atrio-ventriculaire gauche, donne des marginales et des branches auriculaires gauches • Coronaire droite : - Issue du sinus antéro-droit au-dessus de la valvule antéro-droite - Forme d’un « C » - Constituée de 3 segments : segment I, segment II, segment III - Segment I donne l’artère du nœud sinusal - Segment II donne l’artère marginale du bord droit - Segment III se divise en : rétroventriculaire postérieur qui rejoint la circonflexe, et en interventriculaire postérieure qui rejoint l’IVA • Vascularisation veineuse : - Veines parallèles aux artères - Grande veine cardiaque dans sillon IVA - Se drainent dans le sinus coronaire : à la croix du cœur, draine presque tout le sang veineux du cœur • Vascularisation lymphatique : draine la lymphe de l’endocarde, du myocarde, et de l’épicarde vers les ganglions lymphatiques de la bifurcation trachéale • Rôle des principales couches : - l’intima : sécrétion facteur croissance, chimiotactisme, hémostase, défense immunitaire - la média : composante dynamique régulation tonus artériel - l’adventice : contient nerfs régulation tonus artériel, vaisseaux alimentation artériell II. Histologie des artères coronaires II.1. Artères coronaires = artères de moyen calibre III. Rôle des artères coronaires •Transport substrats nécessaires (O2, glucose …) au fonctionnement du myocarde IV. Régulation de la circulation coronaire •Les coronaires nourrissent un muscle continuellement en exercice Perfusion myocardique difficile en systole, et appropriée qu’en diastole Pour pallier à cela : extraction d’O2 d’emblée maximale dès le repos Donc tout besoin myocardique supplémentaire en O2 ne pourra être fourni qu’à partir d’une augmentation du débit coronaire L’apport d’O2 du myocarde ne dépend donc quasi exclusivement que du débit sanguin coronaire • 3 caractéristiques du flux sanguin coronaire : - VARIABLE au cours du cycle cardiaque : maximum en diastole (notamment au début) durant laquelle la pression intramyocardique est minimale - INHOMOGENEITE de la perfusion à travers la paroi myocardique : de l’épicarde vers l’endocarde début ischémie au niveau des zones sous- endocardiques en cas de sténose coronaire (obstruction incomplète d'une artère irriguant le coeur) - Capacité d’ADAPTATION du débit coronaire Normal Sténose coronaire - Capacités d’adaptation du débit coronaire • Adaptation de la pression de perfusion et des besoins myocardiques en O2 = Autorégulation • Quels mécanismes de régulation ? - Nerveux : systèmes sympathiques et parasympathiques - Myogéniques : réponse contractile du muscle lisse en réponse à la distension facteurs de relaxation ou de contraction - Métabolique : pression O2, adénosine, prostaglandines • Rapport du débit coronaire maximal et du débit coronaire de base = Réserve coronaire V – Valeurs et caractéristique du débit sanguin coronaire * DSC normal: 250 ml / min, soit 5% du Qc (le cœur 0,5% du poids corporel), soit donc un DSC de 0,8 ml / g * DSC est élevé car la VO2 (Consommation de l’O2 du myocarde) est élevée et l’extraction de l’O2 est très importante. * MVO2 (niveau de consommation d’O2 myocardique) = 11 ml / min / 100 g de cœur. Soit 13% de la VO2 de l’organisme * A titre indicatif : VO2 du rein = 6 ml / mn / 100 g VO2 du foie = 2 ml / mn / 100 g VO2 du muscle = 0,16 ml / mn / 100 g VI- Moyens de mesure - Les techniques de mesure du DSC reposent sur les mêmes principes que ceux qui évaluent le Qc: - Principe de Fick direct à l’O2: Qc = VO2 Qc = VO2 (CAO2-CVO2) DAVO2 Avec: CAO2 : Contenu artériel en oxygène, ponctionné au niveau d'une artère, CVO2 : contenu veineux en oxygène, ponctionné au niveau de l'artère pulmonaire, DAVO2 : différence artério-veineuse en oxygène, VO2 : consommation d'O2 (en L/min) - Radio-isotopes. - Thermorégulation. VII- Régulation du DSC A- Facteurs mécaniques DSC Pression de perfusion Résistance à l’écoulement DSC = P △ R △P: différence de pression de part et d’autres d’un système; dans le système coronaire c’est la pression de perfusion. △P : différence entre Pao (P AO) et Pad (P VG), donc en diastole. △P : Pao – Pad or Pad 0 donc △P = PAo DSC= Pao R R : résistance coronaire totale Le DSC n’est pas uniforme dans toute l’épaisseur de la paroi myocardique, notamment celle du VG . La résistance R est subdivisée en 3 types de résistances qui varient au cours d’une révolution cardiaque et obéissent à différents facteurs de régulation. R = R1 + R2 + R3 R1: Résistance visqueuse de base. R2: Résistance variable dépend de l’autorégulation métabolique; R2 > 4 à 5 fois R1 R3: Résistance extrinsèque liée à la tension intra myocardique comprimant les vaisseaux et variant durant le cycle cardiaque. Conclusion • Circulation coronaire : - Maximale en diastole - Plus vulnérable en profondeur au niveau des couches sous- endocardiques - Autorégulation en fonction des besoins en O2 • Nombreux médiateurs hormonaux qui contribuent à maintenir un équilibre de ce débit coronaire Le péricarde est constitué de deux parties : - Partie externe : le péricarde fibreux qui entoure le coeur, adhère en bas au diaphragme. - Partie interne : le péricarde séreux, constitué de deux feuillets, un feuillet viscérale qui recouvre le cœur et se prolonge vers le haut sur l’aorte et l’artère pulmonaire. Et un feuillet pariétale qui recouvre le feuillet viscérale et tapisse la face profonde du péricarde fibreux. Ces deux feuillets limitent la cavité péricardique qui contient un liquide, peu important en volume (20 à 50ml), mais qui facilite la contractilité cardiaque. Physiologie du péricarde Un certain nombre de fonctions « mécaniques » sont présentes : – protection du cœur contre les infections; – maintien dans une position grossièrement identique par rapport aux autres éléments du thorax lors des changements de position; – diminution des frottements entre le cœur et les structures adjacentes, facilitation des battements cardiaques (changements brusques de volume des cavités). D’autres propriétés « hémodynamiques » sont aussi présentes : – prévention d’une dilatation excessive aiguë du cœur; – optimisation des relations volume/pression intracavitaires. I- Fonctions du péricarde II- La distensibilité du sac péricardique Le sac péricardique n’est pas très distensible, une faible est surtout rapide augmentation du volume du liquide péricardique engendre une élévation importante de la pression intra- péricardique. La relation pression –volume intra-péricardique: - Une augmentation progressive du volume intra-péricardique engendre une élévation progressive de la pression intra-péricardique. - Alors qu’une augmentation brutale du volume péricardique dépasse rapidement la limite de la distensibilité du péricarde et élève la pression intra- péricardique. 20 Athérosclérose Lésion de l’endothélium d ’une artère ==> formation d ’une plaque d’athérome dans la paroi de l ’artère. = renflement de la paroi formé d’une prolifération de cellules et de dépôts graisseux (cholestérol). uploads/S4/ chapitre-6-circulation-connaire.pdf
Documents similaires









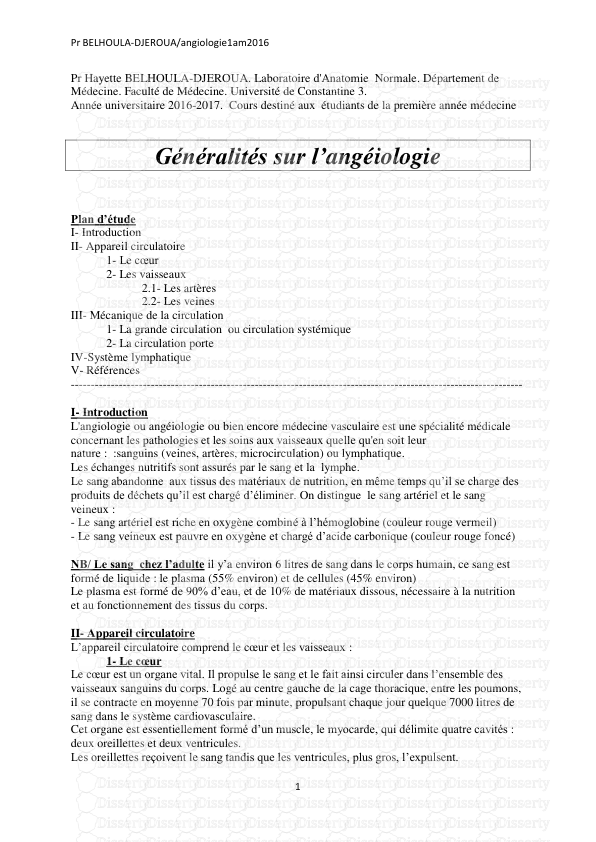
-
39
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 14, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.5235MB


