1 DROIT CONSTITUTIONNEL 1 Théorie générale -------------- Cours du professeur M
1 DROIT CONSTITUTIONNEL 1 Théorie générale -------------- Cours du professeur Martin BLEOU Professeur titulaire des Universités (année universitaire 2020-2021) 2 BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE (en ce qui concerne la théorie générale du droit constitutionnel, c’est-à-dire les données de base et les régimes politiques) I- RECUEILS DE TEXTES ET DE DECISIONS - Louis Favoreu, Loïc Philip et autres : Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, Dalloz ; - Michel Verpeaux et autres : Droit constitutionnel. Les grandes décisions de la jurisprudence, PUF, 2011 ; - Ferdinand Mélin-Soucramanien : Constitution de la République française, Dalloz, 2010 ; Les Constitutions de la France de la Révolution à la IVème République, Dalloz, 2009 ; Les grandes démocraties, Dalloz, 2007 II- MANUELS - Philippe Ardant et Bertrand Mathieu : Droit constitutionnel et institutions politiques, LGDJ, 2017 ; - Bernard Chantebout : Droit constitutionnel, 32e édition, Sirey, 2015 ; - R. Debbasch : Droit constitutionnel, 9e édition, Lexis Nexis, 2014 ; - O. Duhamel et G. Tusseau : Droit constitutionnel et institutions politiques, 4e édition, Le Seuil, 2016 ; - Francis Hamon et Michel Troper (ouvrage de Georges Burdeau, décédé) : Droit constitutionnel, 37e édition, LGDJ, 2016 ; - D. Rousseau et A. Viala : Droit constitutionnel, Montchrestien, 2004 ; - Louis Favoreu, Patrick Gaïa et autres : Droit constitutionnel, 20e édition, Dalloz, 2018 ; - Jean Gicquel et Jean-Eric Gicquel : Droit constitutionnel et institutions politiques, 30e édition, Domat Montchrestien, 2016 ; - Pierre Pactet et Ferdinand Mélin-Soucramanien : Droit constitutionnel, 36e édition, Sirey, 2018 ; III- EXERCICES PRATIQUES - Philippe Ardant : Droit constitutionnel et institutions politiques. Conseils-exercices, LGDJ ; - Claude Le Clercq et Pierre-Henri Chalvidan : Travaux dirigés de droit constitutionnel. - Pierre Pactet : Exercices de droit constitutionnel, 4ème édition, 1998, Armand Colin. 3 IV- REVUES - Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger (RDP) - La revue Pouvoirs - La Revue française de droit constitutionnel - L’annuaire international de justice constitutionnelle - Constitutions - Revue de droit constitutionnel appliqué - Afrilex - Afrique contemporaine - Revue ivoirienne de droit 4 INTRODUCTION GENERALE Il est indispensable de commencer par définir le droit constitutionnel, pour faire apparaître sa spécificité par rapport aux autres disciplines juridiques. Pour ce faire, il s’impose, en tout premier lieu, de préciser l’objet du droit constitutionnel ; l’ayant fait, l’on s’attachera, par la suite, à marquer la position du droit constitutionnel dans la sphère du droit ; enfin, l’on indiquera la méthode suivie pour son enseignement. I- L’OBJET DU DROIT CONSTITUTIONNEL La vie en société n’est possible et n’a de sens que si elle procure l’ordre, la justice et la paix. A cette fin, elle est régie par toutes sortes de règles dont les lois de la religion ou de la morale, auxquelles s’ajoutent les règles de droit. Celles-ci se définissent comme un « ensemble de préceptes de conduite obligatoires, établis par les hommes et pour les hommes vivant en société, et destinés à faire régner, dans les relations sociales, l’ordre et la justice, et dont l’application peut être obtenue, le cas échéant, par la contrainte » (Carré de Malberg). C’est dire que là où vit un seul individu, il ne peut y avoir de droit ; le droit robinsonien n’existe donc pas. En tant que phénomène social ou sociétal, le droit, en ses différentes parties, régit tous les secteurs de la vie sociale. Il en va ainsi, par exemple, du droit civil qui régit, entre autres, les personnes, les biens, la famille, et qui est donné comme le droit commun dans le domaine du droit privé ; du droit commercial, applicable aux commerçants ; du droit pénal, qui définit les infractions et les sanctions qui leur sont applicables ; du droit administratif, qui est l’ensemble des règles spécifiques qui, par dérogation au droit privé, s’appliquent aux personnes publiques, dans le cadre de l’organisation et du fonctionnement des services publics, sauf lorsqu’elles se placent dans les mailles du droit privé ou « s’habillent en civil » ; c’est donc le droit commun de l’Administration. Qu’est-ce, alors, que le droit constitutionnel, à côté de ces différentes disciplines ? Le droit constitutionnel a la particularité d’être l’ensemble des règles juridiques régissant le pouvoir politique, pouvoir suprême, dont l’Etat est le titulaire. En d’autres termes, et selon la formule du professeur André Hauriou, le droit constitutionnel se présente comme « l’encadrement juridique des phénomènes politiques » (Droit 5 constitutionnel). Il tire sa source de la Constitution qui est l’acte fondateur de l’Etat, l’acte qui crée l’Etat, au sens où elle le fait passer du stade d’élément de fait au stade de sujet de droit en l’organisant, en lui donnant forme (Carré de Malberg ; Francis Wodié). Ainsi, le droit constitutionnel détermine le statut du pouvoir politique en le soumettant à des règles de droit ; celles-ci se rapportent à la conquête du pouvoir, à l’exercice du pouvoir, à la transmission du pouvoir. Il suit de là que l’Etat, puissance publique par excellence, est soumis au droit ; les organes dont il est doté par le droit, à savoir les gouvernants, au moyen desquels il décide et agit en tant que personne morale, c’est-à-dire « sujet de droit fictif » (Gérard Cornu et autres : Vocabulaire juridique), sont soumis au droit. Ils sont tenus à l’obligation d’agir conformément au droit, et singulièrement de respecter les droits et libertés reconnus aux citoyens ou, d’une manière générale, aux individus par la Constitution. C’est en cela que le droit constitutionnel apparaît, selon la formule d’André Hauriou comme la conciliation de l’autorité et de la liberté ; c’est que le droit constitutionnel fait cohabiter dans le même espace ces deux éléments qui semblent s’exclure : il donne à l’autorité les moyens de son action tout en l’encadrant, tout en le canalisant aux fins d’assurer la garantie de la liberté. Il résulte de ce qui précède que le droit constitutionnel est la discipline juridique qui soumet l’Etat au droit ; l’Etat, qui détient le pouvoir suprême, est lié par le droit. Ainsi, le droit constitutionnel consacre le règne, la suprématie du droit. Il consacre donc ce qu’on appelle l’Etat de droit – système dans lequel l’Etat est organisé par le droit et fonctionne sur la base du droit (Francis Wodié) – qui s’oppose à l’Etat de police, dans lequel les autorités, agissant au nom de l’Etat, n’ont de limites qu’en elles-mêmes (Prosper Weil). II- LA POSITION DU DROIT CONSTITUTIONNEL DANS LA SPHÈRE DU DROIT Les lignes, qui précèdent, donnent de voir que le droit constitutionnel occupe une place particulière dans le monde du droit, à deux points de vue. Au premier point de vue, d’abord : les disciplines juridiques sont réparties en deux grandes branches : droit public et droit privé ; c’est la summa divisio, la division fondamentale. Le droit public est donné comme le droit de l’Etat, c’est-à-dire le droit applicable aux rapports dans lesquels se trouve impliquée une personne publique ; c’est un 6 droit de commandement, et par conséquent un droit d’inégalité ; sa méthode est celle de l’acte unilatéral, acte procédant d’une seule volonté et s’imposant à ses destinataires ou adressataires sans que leur consentement ait été préalablement requis. Le droit privé, au contraire, est le droit dans l’Etat ; c’est le droit applicable aux personnes privées dans leurs rapports mutuels ; c’est un droit d’égalité ; pour cela il repose sur le consensualisme ; la technique qu’il utilise est l’accord des volontés, le contrat. A l’évidence, le droit constitutionnel apparaît comme appartenant au droit public par cela seul qu’il est le droit du pouvoir politique. Sa spécificité tient à ceci qu’à l’intérieur du droit public, il est la discipline qui soumet le pouvoir politique au droit. Par son objet, le droit constitutionnel s’affirme comme occupant, dans la sphère du droit, une position particulière. Au second point de vue, le droit constitutionnel s’offre comme la matière de base du droit, de tout le droit, qu’il s’agisse du droit public ou du droit privé, en ce que, jetant les bases de l’Etat, il crée le droit. Ainsi, tout ce qui se réalise à l’intérieur de l’Etat prend sa source dans la Constitution, donc dans le droit constitutionnel. Il en va ainsi tant du droit public que du droit privé. Ainsi, d’une manière ou d’une autre, le droit public et le droit privé ont des bases constitutionnelles. III- LA METHODE SUIVIE POUR L’ENSEIGNEMENT DU DROIT CONSTITUTIONNEL L’enseignement ou l’étude du droit constitutionnel stricto sensu consiste dans l’exposé et l’analyse des règles de droit régissant le pouvoir politique. Ces règles sont issues de la Constitution qui est, en règle générale, un document élaboré et adopté selon une procédure solennelle. Toutefois, la Constitution peut être coutumière, c’est-à-dire non écrite, les règles régissant la vie politique se formant, alors, au moyen de pratiques suivies de façon constante, et acceptées comme règles de droit, donc obligatoires. La méthode que voilà s’en tient aux origines des institutions, au statut, aux prérogatives et obligations des institutions, à leurs rapports mutuels, à leurs uploads/S4/ droit-constitutionnel-1.pdf
Documents similaires









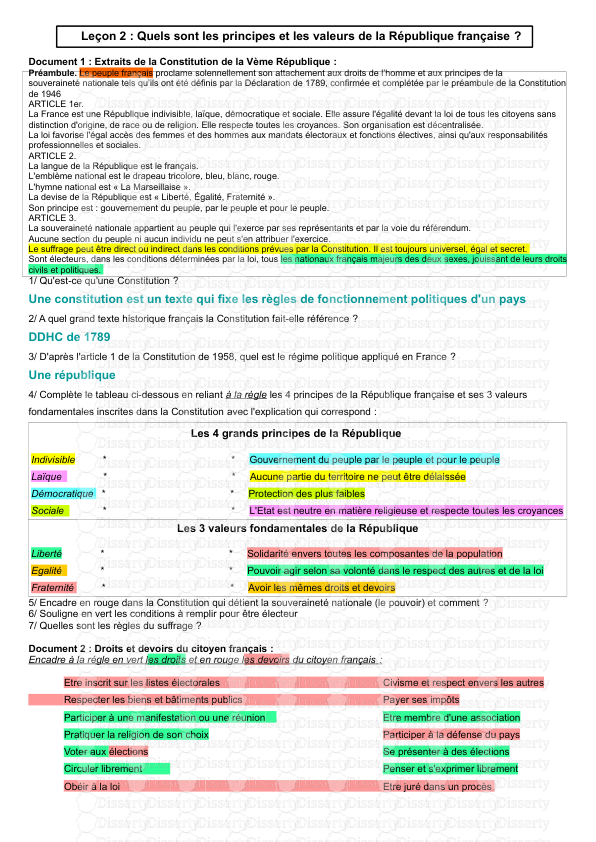
-
46
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 22, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 1.1396MB


