DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE Il s’agit d’un droit qui peut s’apparenter a
DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE Il s’agit d’un droit qui peut s’apparenter au droit des biens. Mais c’est une discipline tout à fait émancipée, ce dont témoigne l’existence d’un Code spécifique. Il arrive qu’il faille aller chercher un mécanisme général dans le droit civil, mais c’est rare. Ce droit touche à des biens incorporels, immatériels. Un roman peut être imprimé sous forme de livre, mais c’est le roman qui fait l’objet de notre droit, non le livre. Le droit de la propriété intellectuelle se trouve partout. La cafetière de mon café a sûrement fait l’objet de brevets, de certificats d’obtention etc.… Cet ordinateur fonctionne grâce à la topographie des semi-conducteurs, qui a fait l’objet d’une protection de propriété intellectuelle. C’est un droit qui porte sur des objets hétérogènes, mais c’est aussi un droit hétérogène, il diffère selon l’objet considéré. La protection n’est pas identique selon la matière et le domaine. 2 ou 3 branches ce semestre : Droit des brevets d’invention, droit des marques et éventuellement droit des dessins et modèles. INTRODUCTION A LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET INTELLECTUELLE La propriété industrielle est l'une des deux branches de la propriété intellectuelle. En France, elle se subdivise en droit des marques et droit des brevets. Les textes réglementant ce secteur du droit se trouvent principalement dans le Code de la propriété intellectuelle. Les dessins et modèles, au caractère hybride, bénéficient d'un cumul de protection entre la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique. Ce qui va être protégé par la commercialisation de biscuits LU, c’est l’aptitude du signe distinctif LU à distinguer des biscuits des autres. On protége le signe, il n’y a aucune invention, innovation. A l’inverse, l’inventeur qui innove peut protéger son idée. De même l’œuvre de l’esprit, originale en matière de création, est protégée par le droit d’auteur. Section 1 : Des droits sur les biens immatériels Les droits de propriété intellectuelle (y compris industrielle) sont récents, nés avec la Révolution Française. Les systèmes antérieurs n’ont rien à voir avec ceux d’aujourd’hui. Et il n’y a pas de droits précurseurs antiques. Sous-section 1 : Les fondements controversés de la PI La justification des droits sur les biens immatériels a varié avec le temps et continue d’être discutée. Si on regarde ce qui se passait avant, on voit que sous l’Ancien Régime, les inventions ou les œuvres n’étaient protégées que par une technique particulière : par les privilèges (ou lettres patentes) accordés par le Prince, seul juge de les accorder ou non. Il n’y avait à l’époque aucune règle, c’était le bon vouloir du Prince. On est loin d’un DROIT de propriété. La propriété industrielle et artistique n’apparaît vraiment au sens moderne qu’avec la Révolution. Le législateur révolutionnaire met en avant la notion de PI et de droit naturel pour accorder un droit exclusif à l’auteur ou à l’inventeur. Il s’agit d’une propriété individuelle, ce qui est important. On fait alors une distinction entre la propriété sur l’objet matériel et la propriété sur l’objet intellectuel. On a enfin l’idée que la propriété n’est pas simplement corporelle, mais peut aussi exister sur l’incorporel. Lorsqu’un écrivain cède le manuscrit d’un roman, il cède le bien matériel mais pas le droit de publier le roman. Celui qui a inventé ou a créé a un droit naturel à s’approprier son œuvre ou son invention. Car cela n’existerait pas sans lui. Ce n’est donc plus la faveur du Prince. Cela doit donc faire l’objet de conditions objectives qui permettent de s’approprier le droit. En ce qui concerne les marques, c’est un peu différent. Avant la Révolution, les seules marques sont celles des corporations. Avec la Révolution, la corporation et les privilèges étant balayés, le système est remis à plat. Le droit sur la marque est d’abord un droit d’occupation active : le premier à exploiter un signe en devient propriétaire. Comment la doctrine justifie-t-elle la propriété intellectuelle ? La doctrine de la récompense, qui consiste à accorder un droit d’exploiter (PI) comme la récompense de l’effort inventif ou créateur. On accorde ce droit pour encourager la création ou l’innovation. Cette récompense s’arrête dès que l’on considère qu’il a été assez encouragé. Le législateur peut donc restreindre ce droit. Le droit est ici conçu comme une exception temporaire, limitée : dès que la récompense sociale a été usée, on revient à la libre utilisation. Seuls les besoins de la société justifient donc ce droit, limité. Cette doctrine a inspiré le droit communautaire et américain ; cela rappelle le système des privilèges. 2e conception : Le Jus naturalisme. On met ici en avant les intérêts du créateur, de l’inventeur ou du titulaire de la marque. Le droit est naturel, la loi ne fait que l’organiser. Autrement dit, c’est parce que je suis le créateur, inventeur ou le premier à utiliser un signe distinctif que je suis le titulaire du droit. Les objets étant immatériels, c’est normal que le droit l’organise. C’est l’esprit du droit d’auteur français, qui se mélange avec la théorie de la récompense dans le droit des brevets. En matière de signes distinctifs, cela ne s’explique pas par ces 2 théories. 3e conception : Protection et Défense de l’investissement. Si quelque chose a coûté de l’argent, cette chose a de la valeur, susceptible d’être copiée, il faut donc la protéger. Ici, l’idée est de protéger l’investissement. Cette doctrine présente de gros inconvénients, car tout investissement naturel présenterait alors un droit de propriété. Cela aboutit aussi à éroder le domaine public. La propriété intellectuelle doit donc constituer une exception, le principe devant rester la liberté du commerce et de l’industrie. De plus, si la PI est fondée sur l’investissement ou la récompense, alors il est facile de critiquer, car le fondement avancé est uniquement économique, donc favorise seulement les plus riches. Dans tous les cas, même dans le jus naturalisme, on a besoin du législateur pour organiser ce droit. Le bien étant immatériel, il faut en définir les contours. Tous ces droits ont en commun de participer à la politique de la concurrence ; tous participent à l’idée d’encourager le commerce, la création et le progrès et tous se basent sur la justice et l’équité. Sous-section 2 : Une nature juridique discutée C’est une controverse vieille, commencée au 19e siècle, qui n’est pas que théorique étant donné les enjeux pratiques. Cette propriété est-elle assimilable à celle du Code Civil ou est-elle sui generis ? Si Code Civil, on va pouvoir transposer des mécanismes de ce dernier au droit de la PI. L’accession mobilière peut-elle s’appliquer ? Le droit de propriété bénéficie de garanties constitutionnelles et CESDH, en est-il de même avec le droit de la propriété intellectuelle ? La doctrine est hésitante de même que le législateur. Ce dernier fait tantôt référence au mot propriété tantôt non. Le mot propriété n’a sûrement pas la même signification que propriété au sens général du terme. Les premières lois parlent de propriété (PLA ou invention) : c’est une révolution en tant que telle, la propriété étant le droit le plus absolu, le plus éminent. Malgré cela, on établit un régime qui est loin de celui se trouvant dans le Code Civil de 1804. Ce droit de propriété est, en effet, très limité dans le temps au moment de la Révolution (+ pas de possession acquisitive). Dans le droit d’auteur, il y a en plus un élément incongru, ce droit d’auteur n’étant pas purement patrimonial. Jusque dans les années 1980, la doctrine majoritaire considérait qu’il s’agissait d’un droit entièrement nouveau et sui generis, et se prononçait contre la qualification du droit de propriété. Il s’agissait seulement d’un monopole d’exploitation temporaire d’un objet immatériel. Roubier a établi une théorie sur les droits de la PI, droits de clientèle. Tous ces droits avaient pour objet une exploitation (inverse de la propriété oisive) et avaient comme objectif commun d’attirer la clientèle. L’objet de tous ces droits est donc la clientèle, qui constitue véritablement la valeur ou le bien. Le droit de clientèle est une 3e catégorie de droit après les droits immobiliers et mobiliers. Ce qui est contestable est que cela consiste à catégoriser la nature du droit par son effet. De plus, ce droit de clientèle n’assure pas en réalité une appropriation de la clientèle. Mais droit sui generis car : - aspect patrimonial au sens de la propriété en général ; - composante extrapatrimoniale conduit à ce que cela ne fasse pas entièrement partie du droit de propriété en général. Mousseron et une grande partie de la doctrine est revenue à l’idée de propriété pure et simple : même si le droit n’est pas perpétuel (ce qui ne définit pas forcément la propriété), il n’en demeure pas moins que la propriété peut être conditionnée par l’exploitation de son objet. De plus, le législateur pourrait exproprier et limiter cette propriété pour l’intérêt général. D’autant plus que le droit des marques est renouvelable tous les 10 ans (= propriété). D’autre part, la maîtrise d’un objet intellectuel ne peut être qu’intellectuelle elle-même. Le détenteur du droit a le droit d’en jouir absolument (542 uploads/S4/ droit-de-la-propriete-industrielle.pdf
Documents similaires







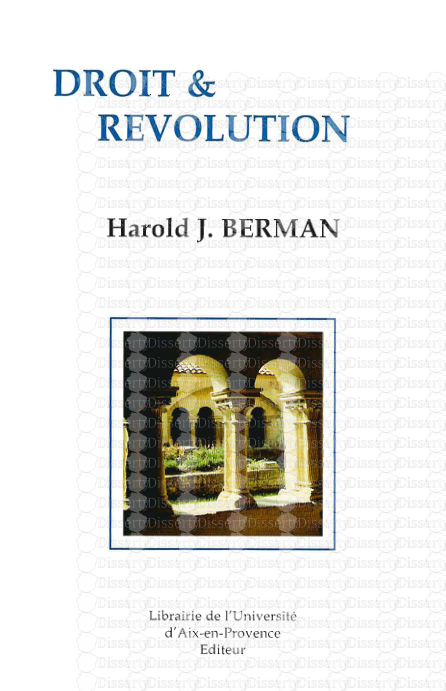


-
104
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 25, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.5482MB


