LE DROIT AU DROIT « LIBRE ÉCHANGE » COLLBCTION FONDÉB PAR FLORIN AFTALION BT GE
LE DROIT AU DROIT « LIBRE ÉCHANGE » COLLBCTION FONDÉB PAR FLORIN AFTALION BT GEORGES GALLAIS-HAMONNO ET DIRIGÉE PAR FLORIN AFTALION LE DROIT AU DROIT Pour un libéralisme institutionnel JEAN-MARC VARAUT Presses Universitaires de France ISBN 2 13039479 !I ISBN 029'-7020 Dépôt légal - Ira édition : 1986, février © Presses Universitaires de France, 1986 108, boulevard Saint-Germain, 75006 Paris Si je veux que la porte tourne, il faut que les gonds soient fixes. WITTGENSTEIN, De la certitude. SOMMAIRE PROLOGUE, 7 1. Le droit au droit, 9 Comment le goulag, archipel du non-droit, prouve le droit, 9 - Com- ment s'opère la genèse de la liberté par le droit, 14 - Comment dissocier le pouvoir d'Etat de la société civile par J'incrustation du libéralisme dans les institutions, 20 - Comment l'inflation des lois déprécie le droit, 26 - Comment le droit au droit déborde l'explication tautologique: la loi c'est la loi, 33 - Comment et pourquoi restaurer la monarchie du droit, 36 - Comment juridifier la politique et constitutionnaliser le Pouvoir, 43. 2. Le contrôle de l'Etat de droit, 49 Comment, partis des mêmes conceptions, les conventionnels américains et les constituants franfais ont abouti à des institutions opposées, 50 - Com- ment la démocratie a pris en France un mauvais départ, 52 - Comment la conception franfaise de la démocratie aboutit à l'omnipotence du pouvoir législatif, 53 - Comment l'omnipotence du pouvoir législatif entraîne le refus du contrôle de la constitutionnalité des lois, 55 - Com- ment l'omnipotence du Parlement conduit à la subordination du pouvoir judiciaire en France, 59 - Comment le droit sacré à l'insurrection a remplacé en France le contrôle de la constitutionnalité interne des lois, 63 6 LE DROIT AU DROIT - Comment la souveraineté parlementaire peut conduire de la démocratie oppressive au principat plébiscitaire, 65 - Comment a été introduit le principe de constitutionnalité par le général de Gaulle, 67 - Comment Valéry Giscard d'Estaing a mis fin à un absolutisme, 70 - Comment l'alternance a entraîné l'abandon définitif de la souveraineté de la loi, 73 - Le droit à la Constitution, 77. 3. Le droit au juge, 85 Comment lajustice en crise appelle au renouveau de lajustice, 85 - Com- ment la contrebande judiciaire ruine la justice, 87 - Comment le droit au droit implique le droit au juge, 92 - Comment juger est une fonction politique, 96 - Comment séparer le pouvoir judiciaire du pouvoir d'Etat, 102 - Comment restaurer l'indépendance du juge, 108 - Comment couper les ponts entre la magistrature et le gouvernement, l 1 8. 4. Le droit au contradictoire, 12.3 Comment un modèle autorégulé de société civile opposé au modèle hégé- monique peut s'insPirer du système judiciaire accusatoire, 123 - Com- ment le formalisme et le rituel judiciaire favorisent l'altérité et la réci- procité propres au droit, 126 - Comment les droits de la défense sont au fondement du droit, 137 - Comment la défense est un impératif catégorique, 140 - Comment les droits de la défense sont des droits de l'homme, 146. 5. Le droit d'avoir des droits, 15 1 Pour un individualisme responsable, 151 - Le mien, le tien et le sien, 163 - Le laisser-contracter, 181 - Le droit de s'associer, 190 - Le droit de l'homme à la communication, 197 - Le droit à la peine, 212. OUVERTURE - Des lois de l'homme aux droits de l'homme, 2.33 Comment la Convention européenne de sauvegarde des droits et libertés ouvre un nouvel espace du droit, 240. Prologue Les idées meurent-elles aussi ? Leur mort appartient à l'histoire alitant que les événements qui en sont les témoins. Nous l'avons compris un soir d'avril Ij7J, où, à lafaveur d'une émission de Bernard Pivot, apparllt sllr les écrans un être hors du temps 011 plutôt de tous les temps. Il venait de publier le premier tome de l'histoire d'Ilne humanité martyre. SOIIS lesyellx de millions de téléspectateurs stupéfaits, Alexandre Soijenit!}ne déchira le voile qui dissimu- lait la réalité de l'Union soviétique. Il ébranla les colonnes de l'ordre russe. Il imposa la perception d'un univers qui rendait fades les témoignages les plus lucides, de Victor Serge à Boris Souvarine. Il imposa un mot - un seul mot, jamais entendu mais qui, désorn/ais, marqlle de fafon indélébile l'Etat qlli se proclame socialiste et que nul1Z'osa rémser -, le mot« GOULAG ». Quelques mois plus tard, rapporte Roger Stéphane!, Malraux transporté à l'hôpital pour motlrir n'emportait qu'un livre, un livre de Soijenit!}ne. Un mot n'est pas un événement. Mais ce mot marque, comme en archéologie, la mort d'une philosophie. Son cadavre couvre une partie du monde, des vallées de l'Afghanistan aux forêts de l'Angola en passant par les déserts de l'Ethiopie mais c'est un nom de mort et non plus d'esPérance. Sans l'Armée rouge et la terreur cette philosophie serait obsolète comme la scolastique, le nominalisme ou le stmcturalisme. Son rrJeton, le jaurésisme-léninisme est mort lui aussi d'avoir rencontré la réalité. Moins la réalité de la crise que la crise de la réalité. Le jaurésisme-léninisme avait cru qu'en multipliant les clientèles de l'Etat, en érigeant des monopoles comme autant de cités interdites, en confisquant la parole 1. Revue Commmlaire, été 1985 : André Malraux et le communisme. 8 LE DROIT AU DROIT légitime par une hégémonie sans faille sur l'information, il pourrait renvoyer longtemps le redoutable problème de penser le réel. Mais si l'on peut ouvrir avec la clé des songes le monde clos des utoPies, on ne guérit pas les écrouelles avec des paroles gelées. Le gouvernement de la prodigalité, puis celui de la désillusion, puis celui de la rigueur2 ont enterré le modèle socialiste sous des tartines de pensées stéréotypées et cimentées par l'usage en bancs de mots morts, signes sans valeur - trottoirs d'idées, dont parlait Flaubert. C'est atfiourd'hui l'état de disgrâce des idées socialistes. La droite était au pouvoir, quand la gauche était dans les têtes. La gauche est venue au pouvoir au moment où il était évident à tous que le communisme, le socialisme et le gauchisme étaient en pleine déroute idéologique. Atfiourd'hui le socialisme sort du cercle de la politique magique, traverse le miroir,. il réintègre lentement la réalité. C'est le crépuscule des idéologies. La liberté se retrouve constituante après que la tutelle, les incantations et l'arrogance ont fait leur temps. L'individu se retrouve principe et fin de la politique. « Il faut qu'il se condNise» - dit Montesquieu de l'individu - et ce n'est pas pour l'enfermer mais pour l'inviter à bâtir lui-même son univers, « selon soi », comme dit Montaigne. C'est à l'homme de commencer. C'est au libéralisme, cette vertu devenue programme, d'inaugurer. Il n'y a pas de savoir absolu, de vérité univoque, de modèle exemplaire, de classe élue, de parti prêtre, de gauche divine, d' homme providentiel, de rendez-vous avec l'histoire ,'1' histoire, comme le savoir, est plurielle. C'est par la lacune du savoir que nous sommes ouverts à la vérité contingente de la politique nécessaire et des politiques super- flues. C'est en se pensant modestement, non comme une force, mais comme une faiblesse au cœur de l'Etre, que l'homme peut s'ouvrir à l'autre en reconnaissant avec l'autre la valeur retrouvée de la liberté, faite d'autonomies souhaitées, d'initiatives conquises, de dissentiments respectés,. cette liberté qui fait reculer l'ordre des plans, cet internat socialiste, ce panoptique transparent, ce pouvoir omniprésent, tutélaire, absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux que pro- phétisait Tocqueville, et qui est le songe des âmes fatiguées de la liberté. Cette nouvelle manière d'être ensemble, dans une société civile po!Jcratique et contrac- tuelle n'est pas la liberté sauvage, mais la liberté institutionnelle, la liberté dans le droit, cet armistice des forces, dont la justice est le dernier mot. Ou plutôt le premier mot qui doit être la source commune. Il est parfois trop tôt, il n'est jamais trop tard pour s'accorder sur ce premier mot. z. Lire Michel Massenet, La Françe après la gaJ«he, Robert Laffont, 1984, 1 LE DROIT AU DROIT « Ce qui est juste ne découle pas de la r;gle mais la règle pro- ~ient de noire connaissance de ce qui est jllste. » JULIUS PAULUS, Digeste 5°,17, I, III" siècle. « Il est courant que les mots soient dltoumés de leur acception première pOlir signifier d'allires choses : ainsi le mot médecine, employé d'abord polir signifier le remède destiné à gllérir lin ma- lade, a été ensuite appiiqllé à l'art de guérir. Pareillement le mot droit. Il a été IItilisé d'abord pour signifier la chose juste elle-même, puis il a dlsigné l'art de discerner le juste,. ensllite le lim même où se rend la justice, comme quand on dit de quelqu'lIII qu'il a comparn en justice,. et enfin l'arrêt, fût-il inique, rendu par cellli qui est chargé de faire justice. » Saint THOMAS D'AQUIN, Somme théologique, lia, lIae, quo 57, a 1. « Dire qu'il n'y a rien de juste ni d'injuste que ce qu' orthnnent les lois positives, c'est dire qu'avant qu'on eût tracé de cercle tous les rayons n'étaient pas égallX. » MONTESQUIEU, De l'Esprit uploads/S4/ le-droit-au-droit-varaut-jean-marc.pdf
Documents similaires


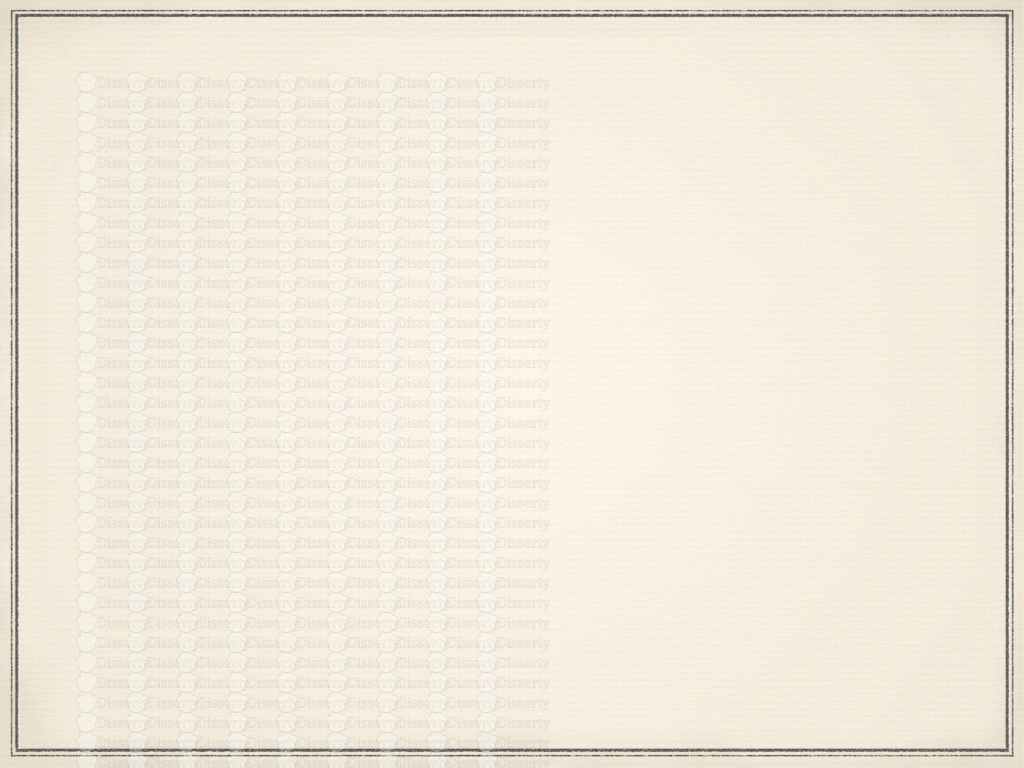







-
52
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 09, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 9.6038MB


