CAHIERS DU CINÉMA Photo de couverture : Jean-Pierre Léaud dans Les Quatre cents
CAHIERS DU CINÉMA Photo de couverture : Jean-Pierre Léaud dans Les Quatre cents coups (coll. Cahiers du cinéma) CREDITS PHOTOGRAPHIQUES Aygiies: p. XXVI (haut: droite). Jea11-Pie1Te Biesse: p. XXIV (haut). R. Calo: p. XXII (bas). Coll. Avant-scène : p. XXIII (haut). Coll. Janine Bazin : p. Il (bas), V (haut), XXVII (bas). Coll. Charles Bilrch : p. XIX (haut, bas), XXX (bas), XXXI. Coll. J. Bontemps : p. XXV (milieu). Coll. Cahiers du cinéma : p. II (haut), IV, V (milieu, bas), X (bas), XII (bas), XIII (milieu, gauche et droite), XIV (bas), XV (haut, bas), XVI (haut, bas), XVIII (haut, bas), XX (haut, bas), XXI (bas), XXIII (bas), XXV (haut, bas : gauche, milieu, droite), XXVI (haut : gauche, milieu et bas : gauche et droite), XXVII (milieu : gauche, droite), XXVIII (haut, milieu), XIX (bas), XXX (haut), XXXII (milieu: droite). Coll. Nicole Do11iol-Valcroze: p. VI, VII (haut, milieu, bas). Coll. Gilles Durieux : p. XXXII (milieu : gauche). Coll. Films du Carrosse: p. X (haut), XXXII (bas). Coll. Jean Narbo11i : p. XII (haut). DR : p. XVII (haut : gauche), XXI (haut), XXI[ (haut), XIV (bas), XXVIII (bas). André G11ejfet1 : p. XXVII (haut). Hélène Jea11bra11 / coll. Charles Bitsch : p. I (haut). Paris-Match / Garofalo : p. I (bas), XI (haut, bas), XIII (haut, bas). Paris-Jlfatch / Vital : p. XVII (bas). SIPA : p. XVII (haut : droite). Denise Tuai : p. II (haut : droite). Pierre Zucca : p. XIV. Les Cahiers du cinéma HISTOIRE D'UNE REVUE , Tome I: A l'assaut du cinéma 1951-1959 À Sylvie Du même auteur: La Caricature révolutionnaire, Presses du CNRS, 1988 L 'An 1 des droits de l'homme, Presses du CNRS, 1988 Une histoire de la démocratie en Europe (ed.), Le Monde-Editions, 1991 Andrei Tarkovski, Editions Cahiers du cinéma, 1989 Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans la présente publication (ou le présent ouvrage), faite sans l'autorisation de l'éditeur est illicite et constirue une contrefaçon. Seules sont autori- sées, d'une part, les reproductions strictement réservées à l'usage du copiste et non destinées à une utilisation collective, et, d'autre part, les analyses et courtes citations justifiées par le caractère scientifique ou d'information de l'œuvre dans laquelle elles sont incorporées (loi du 11 mars 1957- art 40 et 41 et Code pénal art. 425).Toutefois, des photocopies peuvent être réalisées avec l'auto- risation de l'éditeur. Celle-ci pourra être obtenue auprès du Centre Français du Copyright, 6 bis, rue Gabriel-1..aumain, 75010 Paris, auquel « Les &litions de ! 'Etoile » ont donné mandat pour les représenter auprès des utilisateurs. © Editions Cahiers du cinéma 1991 Diffusion Seuil - 27, rue Jacob - 75006 Paris ISBN - Broché : 286642 106 X Relié : 286642 107 8 Antoine de Baecque Les Cahiers du cinéma HISTOIRE D'UNE REVUE , Tome I: A l'assaut du cinéma 1951-1959 Cet ouvrage a été publié avec le concours du Centre National des Lettres CAHIERS DU CINÉMA LE PETIT THÉÂTRE DES CAHIERS DU CINÉMA « "Pourquoi ne nous raconteriez-vous pas un jour l'histoire des Cahiers.?"» m'écrit un de nos fidèles lecteurs. Oui, pourquoi pas? C'est un petit roman édifiant. Nous y penserons ... » Jacques Doniol-Valcroze, Cahiers du cinéma, n°58, avril 1956. Comment parler de soi? De soi quand il est autre? En entreprenant une histoire des Cahiers du cinéma, je savais me confronter à ces deux ques- tions problématiques. D'abord, dira-t-on, un récit qui coïncide avec un anni- versaire (le quarantième), écrit de plus par un membre du groupe (rédacteur de la revue depuis 1986), cela ressemble à une célébration, à une autocélé- bration, les pires de toutes. Ensuite, ce célébrateur, connaît-il seulement son histoire? A-t-il lu tous les textes? Non. En commençant son travail, le critique, jeune, connaît peu ses classiques. Bien sûr, il a lu quelques articles fondamentaux d'André Bazin, il a feuilleté les rééditions fac-similé des pre- miers numéros, et, depuis une dizaine d'années, suit de plus près l'évolu- tion de la revue. Mais il n'en sait pas plus, et son histoire sera aussi récit ini- tiatique, avec les détours que cela comporte, comme certains raccourcis. Peut-être d'ailleurs est-ce ce parti pris - parler de soi comme d'un autre, parler d'un autre comme de soi - qui garantit une certaine distance tout en appelant un désir de proximité, la proximité propre à la volonté de faire récit, la distance nécessaire à son écriture. Comment ne pas se célébrer? Comment se reconnaître, quand même? Ce que l'on recherche, c'est une « identité Cahiers du cinéma», une photo de groupe dont la trame serait assez lâche pour ne pas impliquer une identifi- 8 Histoire d'une revue cation immédiate et nostalgique, assez serrée pour avoir regroupé une dizai- ne de générations de critiques sous un même esprit, sous une même philo- sophie du cinéma. C'est donc cette trame que je voudrais restituer ici, en faisant lecture, puis récit d'une revue qui a proposé, depuis quarante ans, des signatures très diverses, des critiques, des cinéastes, des structuralistes, des lacaniens, des communistes, des maoïstes, ou, simplement, des «amis», le plus souvent des cinéphiles. Outre les incitations conjoncturelles, cette histoire est aussi partie d'une curiosité, piquée par un jugement régulièrement formulé: la déplora- tion. Il fallait croire qu'il existait jadis et naguère, en un moment désigné sous le nom de « Cahiers jaunes», un âge de haute critique, de parfait amour d'un cinéma lui-même aimable. Dans leurs fils de vie croisés, un être jeune (cette nouvelle revue composée de noms devenus ensuite prestigieux) ren- contrait un autre être, mûr quant à lui (le cinéma classique), l'aimait et finissait par le séduire. L'anthropomorphisme n'est pas ici de trop, car ceux qui ont vécu cet amour, ceux-là parlent du cinéma et des Cahiers comme de personnes, de corps qui sont nés, ont vécu, et seraient en train de mourir. A ce moment du raisonnement, l'historien, pourtant habitué à ce discours de déploration répété par toutes les sociétés, sort de son agacement pour partir enquêter. Et si cela était vrai, si les Cahiers jaunes avaient effectivement rencontré le cinéma dans son apogée, pour donner naissance à une idée: l'art classique du xxe siècle ? Il fallait aller voir. Cela, de toute façon, n'empêcherait pas de raconter la suite, ce temps irrégulier qui nous mène jusqu'aujourd'hui, à ce numéro 442 d'avril 1991, quarante ans après ... La première chose qu'il rencontre, cet historien curieux et cinéphile, ce sont des textes. Car une revue se lit d'abord comme un long texte, avec des images entremêlées puisque l'on écrit sur le cinéma, continu et discon- tinu tout à la fois puisqu'il existe des grands textes et des petits, ceux qui arrêtent le regard et ceux qui sont écrits, disposés, imprimés, pour le faire se mouvoir. La revue s'est d'emblée constituée selon une ambition claire- ment littéraire, ignorant très volontairement les aspects techniques du jar- gon de cinéma ou, même, la langue du journalisme, pour tenir un discours à vocation philosophique, universelle. L'influence des Cahiers, bien au-delà des milieux proprement cinéphiliques, vient sans doute de ce statut quasi allégorique (le cinéma comme emblème du monde), de cette dimension parfois prophétique. C'est là que réside la première identité de la revue, celle que nous cherchons à reconnaître, une façon de faire texte avec le cinéma, façon qui, cela m'apparaît de plus en plus évidemment, a été modelée par André Bazin, le père des Cahiers. Il existe un texte fondateur dans lequel, même s'ils ne l'ont pas tous lu avec une attention semblable, Introduction 9 se reconnaissent l'ensemble des rédacteurs: la certitude secrète de détenir, à travers le réel enregistré par la caméra, une parcelle de vérité sur l'homme d'abord, sur l'œuvre d'art ensuite, liés indissolublement. Le critique doit dire non pas l'histoire, non pas la sociologie, non pas le langage, mais la vérité sur un homme de cinéma, l'auteur, et sur une œuvre de cinéma, la mise en scène. D'abord un texte, ensuite des écritures. Revisitant une revue, le pro- meneur les rencontre aussi, ourlant le texte, Je travaillant parfois, le provo- quant souvent. Car les écritures des Cahiers ont emprunté des chemins dif- férents - diverses par le genre auquel elles appartiennent (l'essai théo- rique, la critique, la note, la notule, le journal, la brève, le compte rendu, la légende, l'entretien, le conseil, la résolution collective, l'éditorial, le pro- gramme, le billet, le récit de tournage, le portrait ... ), diverses par les per- sonnalités dont elles sont la marque. Chemins différents mais tracés dans une semblable passion. Les Cahiers n'ont jamais su parler autrement que sur un mode amoureux: comprenant le cinéma en une enivrante identifica- tion ou en une violente dénonciation, voire en le dépouillant, en le muti- lant, rite masochiste, détournement de l'écriture vers le dogmatisme. Il s'agit peu d'étudier, mais beaucoup d'aimer. Tous les moments forts de la revue s'apparentent ainsi, d'une façon ou d'une autre, à la « Lettre sur Ros~ sellini » écrite par Jacques Rivette en avril 1955, bousculant l'organisation uploads/S4/ les-cahiers-du-cine-ma-histoire-d-x27-une-revue-tome-1-a-l-x27-assaut-du-cine-ma-1951-1959-cahiers-du-cine-ma-antoine-de-baecque-1991.pdf
Documents similaires


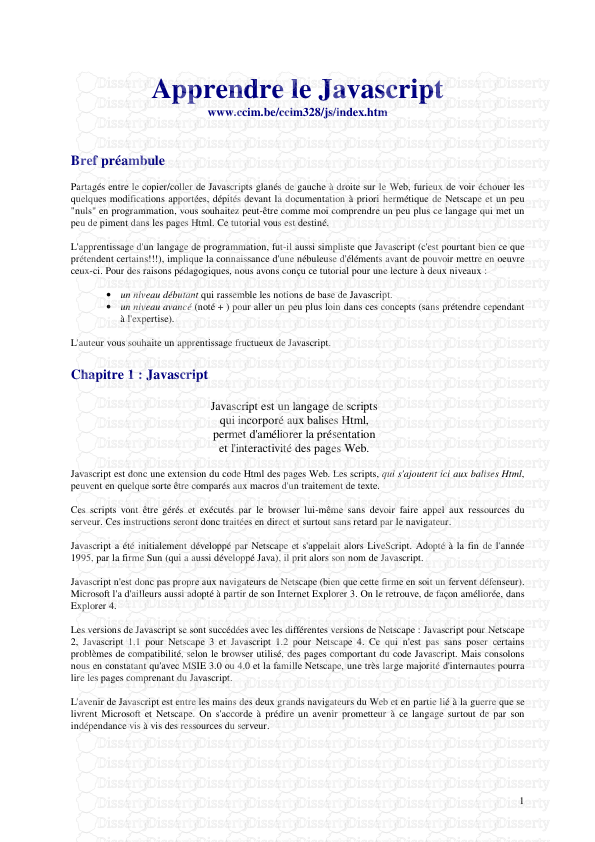







-
47
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 16, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 27.8899MB


