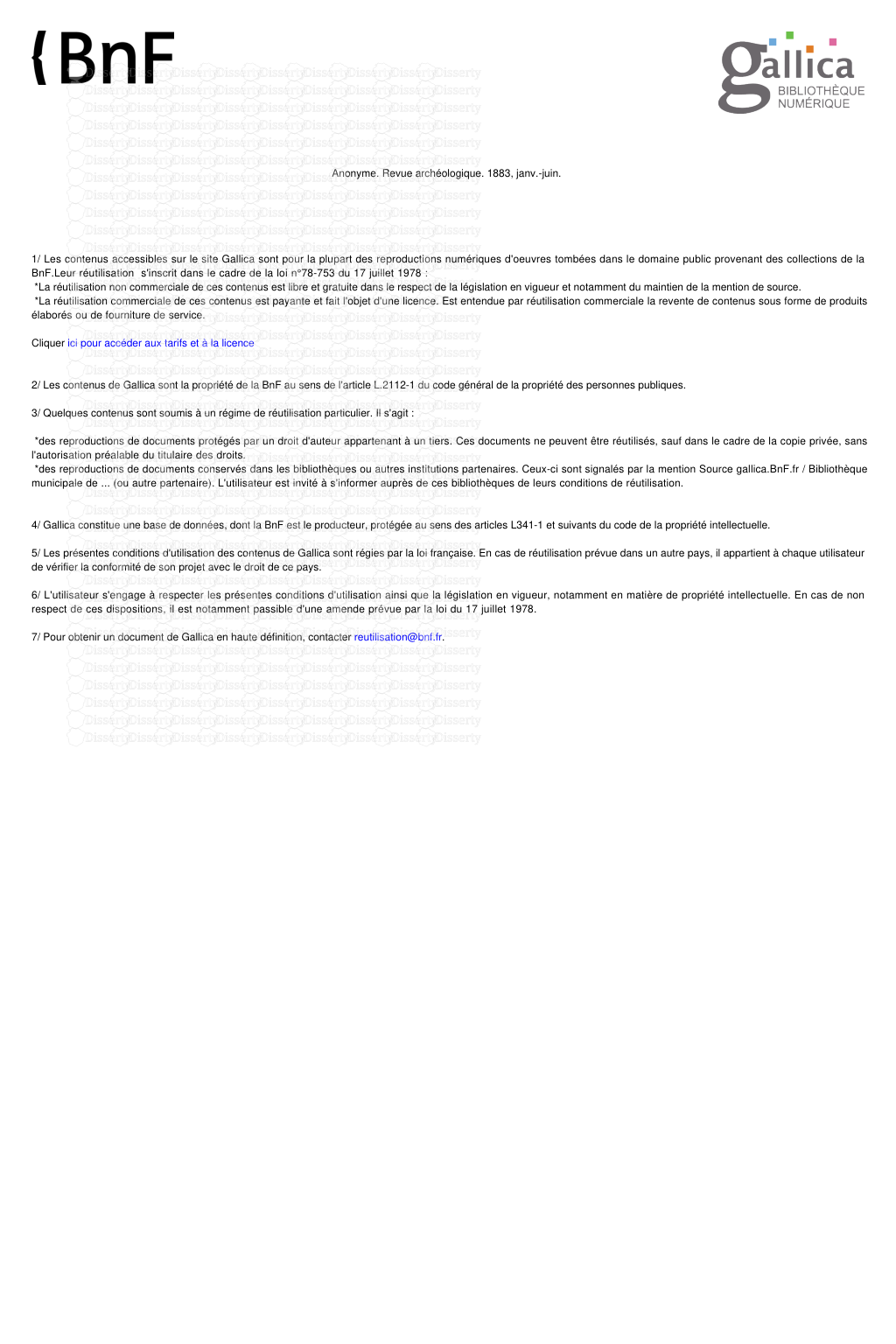Anonyme. Revue archéologique. 1883, janv.-juin. 1/ Les contenus accessibles sur
Anonyme. Revue archéologique. 1883, janv.-juin. 1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF.Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : *La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. *La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service. Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence 2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit : *des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits. *des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation. 4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays. 6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978. 7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr. REVUE ARCHÉOLOGIQUE JANVIER A JUIN 1883 PARIS. -IMPRIMERIE DE PILLEr ET DUMOULIN 5,rue des Grands-Au6ustms. REVUE ARCHEOLOGIQUE (ANTIQUITÉ ET MOYEN AGE DE MM. ALEX. BERTRAND ET G. PERROT MEMBRES DE L'INSTITUT. TROISIÈME SÉRIE. — TOME Ier. JANVIER—JUIN 1883 PARIS JOSEPH BAER, LIBRAIRE-ÉDITEUR 18, RUE DE L'ANCIENNE-COMÉDIE, 18 FRANCFORT-SUR-LE-MEIN, Rossmarkt, 18 1883 Droits de traduction et de reproduction réservés. UN CIPPE FIGURATIF DE LA PREMIÈRE PERIODE CHRÉTIENNE SUR LA MOSELLE' Le monument dont je vais m'occuper servait encore au mois d'avril 1882 de fonts baptismaux dans une modeste église, d'ori- gine très ancienne. Il se trouvait au petit village de Virecoùrt (Virecuria), à deux kilomètres de Bayon et de la Moselle, à trois kilomètres du cimetière mérovingien, de la côte -Le Bel, qui a fourni un grand nombre d'ustensiles et d'armes de cette époque. J'ai retrouvé, à six cents pas de Virecourt, des substructions an- tiques, un couronnement d'autel gallo-romain, un quinaire à fleur de coin portant l'effigie d'Alexandre Sévère, et une anse d'am- phore à estampille de potier marquée des lettres ME. J'ai suivi une voie romaine pavée de pierres debout, qui, touchant la rive droite de la, Moselle, passe ensuite sous les maisons de Virecourt. .Cette voie recevait une bifurcation,, dont une branche traversait la rivière à Bayon. Virecoùrt est donc une localité très ancienne, et a possédé, au moyen âge une commanderie de templiers. Le- page se trompe en répétant, d'après la statistique-de 1822, que j'église porte le millésime de 940 2. Toutefois la nef est une recons- truction du xve siècle et le porche, bien plus ancien, est divisé en deux portions très inégales par un pilier extrêmement trapu. Ce 1. La Direction de la Revuerappelle qu'elle laisse aux auteurs des articles l'on- tière responsabilité de leurs opinions. 2. Lepage, Statistique de la Meurthe, 1843, article Virecourt. Ille SÉRIE, T. 1er. 1 2 REVUE ARCHÉOLOGIQUE. pilier forme l'angle du clocher'. Le chapiteau- cubique couronnant le pilier doit être antérieur au xn° siècle, et il avait été fait pour être adossé. Tel qu'il est, il présente deux têtes d'angle, dont l'une porte à sa coiffure, sur le front, deux serpents enlacés comme sur un caducée renversé, et de chaque côté une corne de bélier. Faut-il voir dans ces attributs, et surtout dans celui des serpents, une analogie de symbole avec ceux des figures typiques représentant à Strasbourg, à Reims, à Paris, sur nos cathédrales du XIIIe siècle, l'emblème du paganisme? Cela paraîtrait naturel, car l'autre tête du même chapiteau, type à la fois humain et bestial, coiffée du bonnet à grelots des fous, et ayant reçu en polychromie des moustaches félines, sur un muffle progna- the, nous montre une caricature intentionnelle, l'image très probable du paganisme. Dans un recoin obscur du porche, divisé par ce pilier, s'appliquait au mur septentrional la pierre que je vais décrire. Qu'on se figure un cippe au plan carré, aux parois verticales de 0m,92 d'élévation sur 0m,54 de largeur à la base. La face. adossée est plane, à peine dégrossie, et faite pour rester telle. Les trois autres portent, des figures en relief. Le socle est très simple; une plate-bande sous un biseau un peu concave, voilà tout. Quant au couronnement qui in- dique une basse époque, il est remarquable qu'il ne présente aucune saillie sur le plan de la base. Cette singularité est cherchée.et ne saurait être attribuée aux dimensions trop faibles de la pierre em- ployée. 1. Ce clocher, placé lui-même à l'angle de la façade, est marqué de plusieurs re- traits accusant des remaniements, et sa partie inférieure' peut avoir eu une destina- tion inconnue. UN CIPPE FIGURATIF. 3 Le couronnement est donc formé, au milieu de sa hauteur, d'urie large plate-bande, séparée'des figures par un tore entre deux cavets. Au-dessus, un autre cavet surmonté d'une échine, servant d'amor- tissement. Le plateau dominant est creusé d'un large et profond bassin en segment de sphère. Ce cippe, qui, depuis longtemps, était plutôt méconnu qu'ignoré dés archéologues de la région, offre un caractère si étrange que-les princes de la science, à qui des dessins en ontwété soumis, ont émis, avec une sage réserve sans doute, les appréciations les plus contra- dictoires sur l'âge qui l'a produit: L'un d'eux, M. Charles Robert, écrivait à ce sujet « Votre curieux monument me paraissait gallo- romain, et j'avais remarqué le caractère de la femme aux deux en- fants et surtout sa coiffure. Deux de mes confrères de l'Institut s'étant 'montrés disposés à faire descendre votre cippe assez bas, et un de mes amis ayant prétendu qu'il était du moyen âge, je. mesuis adressé à Jules Quicherat, que je considère comme l'homme le plus compé- tent. Voici sa réponse.» Signé C. Robert. (Lettre de M. Quicherat.) « Mon cher collègue, le font baptismal de Virecourt me fait l'éffet d'être un-cippe gallo-romain qu'on a creusé au moyen âge pour lui donner une destination qui n'était pas la sienne. Les figures .sont étrangères à l'imagerie sacrée du moyen âge au contraire il y en a une, la femme aux deux enfants au maillot, dont nous possédons beau- coup de représentations du deuxième et du.troisième siècle de notre ère. Il sera arrivé qu'en rebâtissant l'église de Virecourt on aura trouvé dans la fondation cette pierre sculptée, qui avait été employée dans la construction antérieure, ou qui avait fait partie d'un temple occupant la place avant qu'il y eût une église; Le monument déterré de la sorte a été réputé chrétien, et, à cause des bambins et des vases qui sont dans les mains des autres personnages, on a cru que 'le sujet 'se rapportait au sacrement du baptême. » A ces deux autorités d'un si grand poidsj et dont'l'une me paraît grandie encore par la mort, s'en est jointe une troisième d'une égale valeur. Lorsque, dernièrement, je fis une lecture la Sorbonne sur ce sujet, le savant directeur du Musée de Saint-Germain, M. Alexandre Bertrand, émit l'opinion que le monument, paraissant appartenir une époque de transition, lui semblait toutefois plutôt gallo-romain que postérieur. Si j'ai tenu à faire connaître tout d'abord le sentiment de nos ap- préciateurs les plus éminents, c'est pour faire pressentir au lecteur le caractère tout énigmatique du-monument que je vais essayer d'étu- dier, pour en faire apprécier la haute valeur, et en même temps pour 4 REVUEARCHÉOLOGIQUE. 1 témoigner de mon profond respect pour les maîtres en, archéologie, dans lés questions même- où je me permets de ne pas être de leur avis. Je commence par convenir qu'au premier aspect le cippe de Vire- court offre dans plusieurs de.ses parties un air de famille avec des monuments de la période gallo-romaine1. Il est évident que des types païens ont servi de modèles; mais il me semble que, s'il y a imitation, c'est une imitation libre, et je, ne connais pas un seul des motifs représentés sur notre .mono.lithe qui reproduise sans modifi- cation un spécimen connu. Ensuite, couvertes de reliefs, uploads/S4/ revue-archeologique-1883.pdf
Documents similaires










-
26
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 20, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 17.5423MB