Ce livre fait un pari. Le lecteur est intelligent. Le respecter se traduit par
Ce livre fait un pari. Le lecteur est intelligent. Le respecter se traduit par deux obligations de la part des auteurs : ne pas s’adresser à lui sur un mode infantile, ne pas lui raconter des histoires. Alors nous ne parlerons plus ni de marque, ni de marché. de l’entreprise marchande àl’entreprise marquante Jean-Claude Thoenig - Charles Waldman De l’entreprise marchande à l’entreprise marquante Chez le même éditeur Georges Chétochine, Le blues du consommateur Gilles Marion, Idéologie marketing Nicolas Riou, Peur sur la pub Kevin Roberts, Lovemarks. Le nouveau souffle des marques Gerald Zaltman, Dans la tête du client JEAN-CLAUDE THOENIG CHARLES WALDMAN De l’entreprise marchande à l’entreprise marquante Le code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992 interdit en effet expressément la photocopie à usage collectif sans autorisation des ayants droit. Or, cette pratique s’est généralisée notamment dans l’enseignement provoquant une baisse brutale des achats de livres, au point que la possibi- lité même pour les auteurs de créer des œuvres nouvelles et de les faire édi- ter correctement est aujourd’hui menacée. En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire inté- gralement ou partiellement le présent ouvrage, sur quelque support que ce soit, sans autorisa- tion de l’Éditeur ou du Centre Français d’Exploitation du Droit de copie, 20, rue des Grands- Augustins, 75006 Paris. © Éditions d’Organisation, 2005 ISBN : 2-7081-2742-X © Éditions d’Organisation Sommaire Retour aux fondamentaux 7 De quoi parle ce livre 8 D’où parle le livre 16 À qui parle le livre 19 1 Les défaillances des constructions traditionnelles du rapport au marché 21 Menaces et opportunités 22 Les icônes déchues 32 La vacuité du concept de besoin 33 Approcher le marché autrement 39 2 Le monde des artisans du bâtiment 45 La chute d’une grande marque 46 La vérification du positionnement stratégique 50 La reconnaissance du caractère distinctif de la cible 53 Du ciblage stratégique au marketing mix 56 Une mise en œuvre rapide et puissante 61 Marketing orthodoxe et conséquences contingentes 62 3 Le territoire des animaux 65 L’héritage du vétérinaire, du chien et du sec 67 L’avenir aux traditionnels 71 Investir des segments qui n’ont jamais existé 74 Changer le statut de l’animal et de son maître 78 Un marketing vraiment peu orthodoxe 81 6 DE L’ENTREPRISE MARCHANDE © Éditions d’Organisation Mobiliser une communauté 84 La prochaine étape 89 4 Le marquage : un concept et ses composantes 93 Ce qu’est et ce que n’est pas le marquage 94 Les types de marquage 104 Deux applications 116 La nécessité du marquage 121 La contingence des types de marquage 125 5 Un juste état d’esprit 129 L’écoute des mondes en émergence 132 Une vue large et ouverte du monde extérieur 138 La soumission à la sanction de l’information adéquate 142 Une définition enrichie ou holiste du client 146 La distanciation par rapport aux règles du jeu 147 Le client au centre de l’entreprise 153 6 Détruire un marquage 157 Les pièges à éviter 159 Les pratiques d’évitement des pièges 173 Un péché mortel 191 7 Le territoire de l’entreprise 199 Un mode de raisonnement 199 Un projet d’action 207 Des fonctions et des dispositifs 213 Les 6 composantes de la territorialité 223 8 L’organisation missionnaire 233 Concilier des exigences contradictoires 233 La coopération organisationnelle 238 Les ressorts moraux d’une pression consentie 240 L’organisation interne et l’aménagement du territoire externe 243 Les fondamentaux de l’organisation communautaire 246 La valeur du territoire 249 Bibliographie 255 Index des noms de personnes 261 Index des noms d’entreprises, de marques et d’institutions 265 Index des matières 269 © Éditions d’Organisation Retour aux fondamentaux Ce livre énonce trois propositions pour l’action. Le succès et la survie de l’entreprise résident dans sa capacité à conquérir, à marquer et à développer un territoire sociétal et éco- nomique. Un territoire est constitué de parties prenantes multiples (clients, fournisseurs, salariés, associations civiques, milieux experts, etc.) que l’entreprise fédère autour de son projet, par le biais de valeurs communes, d’identités partagées, d’intérêts reconnus et de parte- nariats durables. La référence à son territoire constitue son code de conduite. L’entreprise marquante met en œuvre un mode de management spécifique : une définition méticuleuse et pointue des prestations offertes, un suivi permanent et obsessionnel des événements qui peuvent l’affecter, l’érection de protections contre les intrus et contre les menaces, un modèle organisationnel de type commu- nautaire. Trois constats militent pour une approche en terme de conquête de territoires. Le modèle de l’entreprise marchande est, sauf exceptions, moins performant et moins durable que le modèle de l’entreprise mar- quante. 8 DE L’ENTREPRISE MARCHANDE © Éditions d’Organisation L’entreprise marchande est prisonnière de visions appauvries de son environnement — ainsi celle de marché — et de représenta- tions peu réalistes de la demande — ainsi celle du consommateur. Elle a recours à des solutions purement technicistes et à des recettes largement épuisées. Les stratèges ont beau affiner leurs matrices, les marketeurs approfondir leurs méthodes, les communicateurs accroître leurs budgets et les gestionnaires de marques multiplier les études : le saut à faire vers une approche par le territoire est quantique. C’est tout un système de pensée et de pratiques qu’il faut interroger et faire évoluer. DE QUOI PARLE CE LIVRE Ce livre parle de fondamentaux du management Positionner une entreprise dans un contexte économique et sociétal, piloter son fonctionnement en tant qu’organisation, sont des arts et des manières qui renvoient à ce qu’on appellera des fondamentaux. Le cœur du management est généraliste. Il consiste à mettre en liaison des compétences, des logiques d’attention et des savoir-faire, et à rendre ces assemblages compatibles et efficaces par rapport à un projet de positionnement assurant une rente viable. En théorie, l’évidence s’impose tant elle paraît simple. En prati- que, le bon sens laisse souvent à désirer. La pratique des affaires révèle un long cortège d’écarts et d’oublis. Les bases du manage- ment généraliste se diluent. Des demi-vérités ont force de loi. Des gestes relevant parfois de la magie pure saisissent les managers et fondent leurs actes. Pire encore, le management généraliste devient une spécialité cantonnée dans un coin de l’organisation. Une dérive fréquemment observée est celle de la centralisation. La compétence de généraliste et d’assembleur qualifierait les seuls dirigeants. Plus on descendrait dans la hiérarchie de l’autorité et des métiers, moins on demanderait aux personnes d’agir comme des intégrateurs à leur niveau et des dépositaires du fonds de jeu collec- tif. En haut on compose le programme et on dirige l’orchestre. En bas on respecte les procédures et on exécute sa partition. À L’ENTREPRISE MARQUANTE 9 © Éditions d’Organisation Une dérive pire est celle de la spécialisation corporative. Le bon management consisterait à recruter les meilleurs professionnels et experts : stratèges issus des plus fameux cabinets américains, logisti- ciens de pointe, marketeurs ayant été formés dans les multinationa- les les plus célèbres de l’alimentation et des lessives, contrôleurs de gestion bardés de logiciels et férus de ratios, etc. Puis il faudrait les parquer dans des services spécialisés et leur reconnaître une juridic- tion exclusive sur leur fonction. Bref, l’entreprise coupe le manage- ment en rondelles. Elle fait le pari que la somme des métiers assure l’intégration et l’assemblage, quitte à ériger un paysage de silos verti- caux ne coopérant plus entre eux et s’enfermant dans des bonnes pratiques à base de modèles à prétention scientifique et de procédu- res passe-partout. Ce n’est donc pas un projet propre à l’entreprise, endogène car développé en son sein et partagé par chacun, qui ras- semble et fait sens. Ce sont des communautés professionnelles externes — les comptables, les marketeurs et d’autres métiers s’éri- geant en quasi-juridictions — et des modèles exogènes importés par des mercenaires qui sont censés assurer la cohérence et la mobilisa- tion dans l’entreprise, de bas en haut et d’aval en amont. Les raisons de ces dérives ne manquent pas. Ainsi la faute incomberait aux cycles de la mode et du prêt à penser. Avec l’aide des consultants et des gourous, les media du management alimen- tent une course à la pharmacopée universelle1. Certes les praticiens, qui ne sont par ailleurs pas plus idiots que d’autres, restent prudents sinon méfiants. Néanmoins le mal est fait. On attend de l’instru- ment en vogue une solution immédiate et même un miracle quel que soit le contexte. Si les compétences généralistes ont beaucoup de mal à être prises au sérieux, la raison en incomberait aussi à la formation des mana- gers. Ainsi le scientisme apparent serait alimenté par le savoir acadé- mique, par la prétention des professeurs et des chercheurs en management à vouloir naturaliser un domaine qui relève pourtant de l’incertain et de l’humain. Quant à l’hyperspécialisation, elle serait alimentée par des stratégies de promotion corporative qui per- mettraient à tel milieu — les marketeurs, les financiers, les commu- 1. La posture des cabinets de conseil tend à privilégier dans maints cas le statu quo des modèles de gestion en vigueur dans les entreprises et à perpétuer les principes tayloriens de gestion uploads/Finance/ de-l-entreprise-marchande-a-l-entreprise-marquante-pdf.pdf
Documents similaires






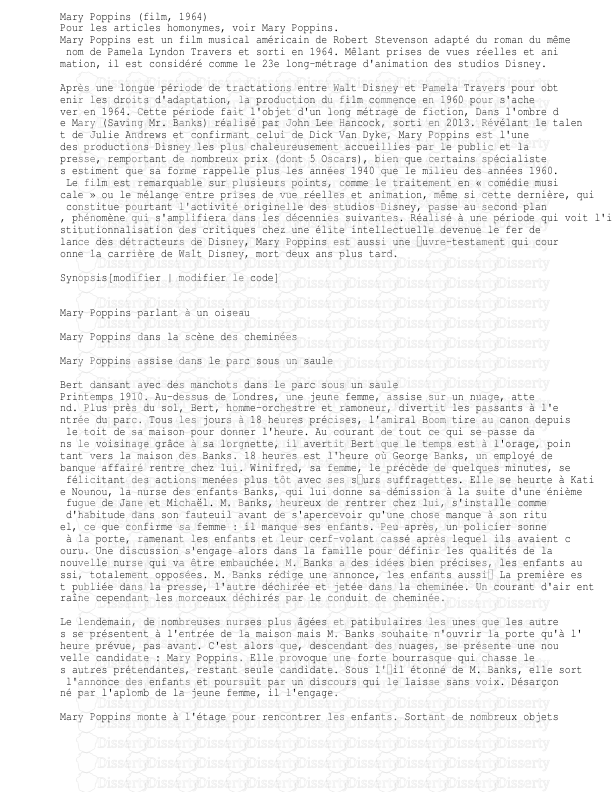


-
53
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 04, 2021
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 2.3922MB


