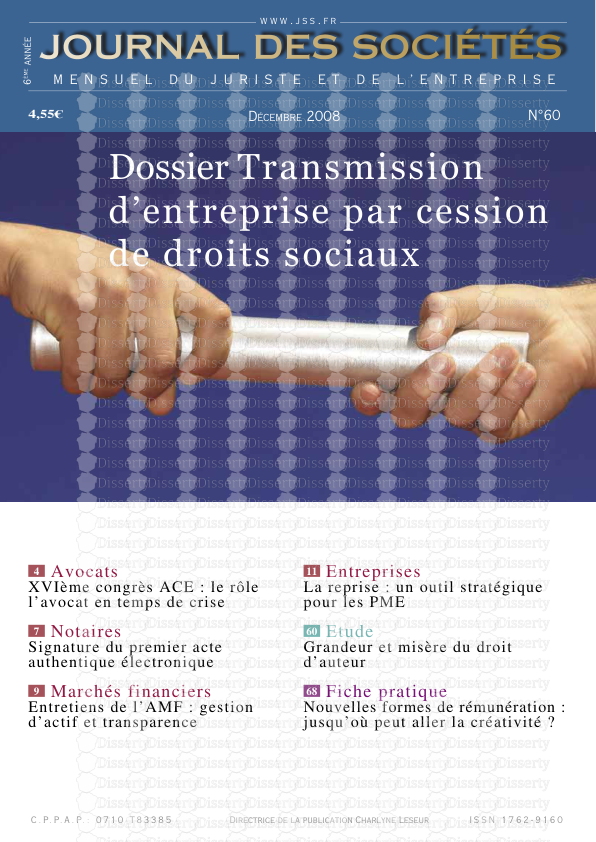C . P. P. A . P. : 0 7 1 0 T 8 3 3 8 5 Directrice de la publication Charlyne Le
C . P. P. A . P. : 0 7 1 0 T 8 3 3 8 5 Directrice de la publication Charlyne Leseur I S S N 1 7 6 2 - 9 1 6 0 N°60 M E N S U E L D U J U R I S T E E T D E L ’ E N T R E P R I S E 6ème année 4,55€ W W W . J S S . F R DÉCEMBRE 2008 Dossier Transmission d’entreprise par cession de droits sociaux 4 Avocats XVIème congrès ACE : le rôle l’avocat en temps de crise 7 Notaires Signature du premier acte authentique électronique 9 Marchés financiers Entretiens de l’AMF : gestion d’actif et transparence 11 Entreprises La reprise : un outil stratégique pour les PME 60 Etude Grandeur et misère du droit d’auteur 68 Fiche pratique Nouvelles formes de rémunération : jusqu’où peut aller la créativité ? JOURNAL DES SOCIÉTÉS 2 N°60 Décembre 2008 S o m m a i r e Actualité .......................................................... Avocats 4 XVI ème congrès de l’ACE : croissance et rôle de l’avocat en temps de crise 6 L’avocat, sa responsabilité civile, son assurance Notaires 7 Interview de Jean-François Humbert, Président de la Chambre des Notaires de Paris 7 Le premier acte authentique électronique signé 8 Lutte contre le blanchiment Marchés financiers 9 Gestion d’actifs : l’AMF au milieu du gué 10 Fonds de dotation : un nouvel « être juridique » au service du mécénat Entreprises 11 La croissance externe : un outil pour mieux vendre son entreprise Veille législative et réglementaire 12 Focus Droit communautaire Transmission d’entreprise par cession de droits sociaux .......................................................... 15 Propos introductifs Antoine Hontebeyrie, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université d’Angers, Avocat Associé, David Robine, Maître de conférences à l’Université de Rouen, Avocat à la Cour, Racine 16 Le transfert du contrôle de la société non cotée Mélanie Coiraton-Mavré, Avocat Associé, Elisabeth Causse-Cordier, Avocat à la Cour, Claire Charroin, Avocat à la Cour, Racine 23 Le transfert du contrôle de la société cotée Jean-Yves Martin, Docteur en Droit, Avocat Associé, Racine 29 La cession de l’entreprise en difficulté par reprise du capital Antoine Diesbecq, Avocat Associé, Racine 34 La situation des salariés en cas de transmission de l’entreprise par cession des droits sociaux Carla di Fazio Perrin, Avocat Associé Alain Ménard, Avocat Associé, Racine 38 Les clauses de prix dans les cessions de droit sociaux Bruno Cavalié, Avocat Associé, Racine 42 Les recours ouverts par la loi au cessionnaire déçu Antoine Hontebeyrie, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université d’Angers, Avocat Associé David Robine, Maître de conférences à l’Université de Rouen, Avocat à la Cour, Of Counsel, Racine 47 L’engagement de non concurrence du cédant Valérie Ledoux, Avocat Associé, Clément Tournaire, Avocat à la Cour, Racine 52 Les garanties conventionnelles Luc Pons, Avocat Associé, Racine Etude .......................................................... 60 Grandeur et misère du droit d’auteur Laure Merland, Maître de conférences à l’Université d’Aix Marseille III Fiche pratique .......................................................... 68 Nouvelles formes de rémunération : jusqu’où peut aller la créativité ? Nicole Laffue, Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence 72 Flash info du Journal Spécial des Sociétés 74 Agenda N°60 Décembre 2008 15 JOURNAL DES SOCIÉTÉS Dossier Transmission d’entreprise par cession de droits sociaux Propos introductifs Antoine Hontebeyrie, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université d’Angers, Avocat Associé David Robine, Maître de conférences à l’Université de Rouen, Avocat à la Cour, Racine L’entreprise est partout ; et, pourtant, si difficilement saisissable. On en veut pour preuve les nombreuses études qui lui ont été spécifiquement consacrées (1). Elle n’en attire pas moins les convoitises. Partant, elle pose la difficulté de savoir par quelle technique juridique sa transmission doit s’opérer. Deux voies principales peuvent être empruntées à cette fin. En premier lieu, on peut envisager de procéder à la cession de l’entreprise elle-même. L’opération prendra alors, généralement, la forme d’une cession de fonds(2) : fonds de commerce, fonds artisanal, fonds agricole, voire même « fonds libéral » (3). Elle impliquera d’assez lourdes contraintes, notamment des contraintes d’ordre rédactionnel destinées à délimiter clairement le périmètre du fonds cédé. Aussi existe-t-il, en second lieu, une voie bien plus simple et connue de tous. Cette autre voie consiste à ne pas transmettre directement l’entreprise, mais uniquement la majorité, voire la totalité des droits sociaux de la société qui, par hypothèse, détient l’entreprise convoitée. On procédera donc à une cession du contrôle lato sensu de la société « propriétaire » de cette entreprise. Sans doute cette technique n’est-elle pas exclusivement dédiée à la transmission de l’entreprise. Le cessionnaire peut en effet avoir pour seul objectif d’effectuer un placement financier. Mais, fréquemment, il s’agira pour lui d’appréhender de la sorte, indirectement, l’entreprise même que contient la société. Bien sûr, les droits sociaux qui composent le capital de celle-ci ne se confondent pas, juridiquement, avec l’entreprise. Le cessionnaire n’en parviendra pas moins à un résultat approchant. La raison en est que les titres lui confèrent des prérogatives politiques et patrimoniales qui, sans nullement se prêter à une assimilation avec un droit de propriété sur l’entreprise, lui permettent tout de même, comme la propriété, d’exercer un pouvoir sur celle- ci et d’en tirer les utilités. Cette voie peut être choisie lorsque la société est in bonis, mais également lorsqu’elle fait l’objet d’une procédure collective (4). En toute hypothèse, elle suppose, évidemment, d’acquérir le contrôle de la société et de le conserver (5). Ce qui implique certaines contraintes, en particulier lorsque la société est cotée (6). Ceci étant, une fois encore, l’entreprise ne se confond pas avec les titres de la société qui la contient. Il en résulte, notamment, que le statut des salariés ne ressort pas affecté de l’opération, sauf circonstances particulières tenant, notamment, à l’hypothèse d’une restructuration subséquente (7). Il en résulte aussi que les parties et leurs conseils doivent prendre garde à réduire, autant que faire se peut, le décalage entre l’instrument utilisé (la cession de titres) et le résultat recherché (la transmission de l’entreprise). Par exemple, le prix doit rendre compte de la valeur de l’entreprise. D’où les clauses de prix, qui appellent des précautions rédactionnelles particulières destinées à asseoir la valeur des titres sur celle de l’entreprise mais aussi à exclure tout risque d’inefficacité juridique (8). De même, le décalage se fait particulièrement sentir dans l’hypothèse où le cessionnaire est, après coup, déçu par l’opération. Le plus souvent, sa déception tient à l’état de l’entreprise, soit contemporain de la cession, soit même postérieur à celle-ci, en particulier à raison d’actes concurrentiels commis par le cédant. Or, bien souvent, cette déception est dépourvue d’incidence juridique, et donc de remède, pour cette raison que ce n’est pas l’entreprise qui a été cédée, mais les droits sociaux. A tout le moins est-ce le cas lorsque le cessionnaire entreprend de se placer sur le terrain strictement légal (9), même si ce terrain lui offre quelques voies de recours. D’où, une fois de plus, la nécessité, sinon l’utilité, de recourir en amont à la voie contractuelle et d’exploiter toutes les richesses de la liberté qu’elle confère aux parties. On stipulera, évidemment, des garanties conventionnelles (10). On aura soin, aussi, d’organiser contractuellement une interdiction de concurrence à la charge du cédant, tout en respectant le droit de la concurrence (11). En somme, si le décalage entre l’instrument utilisé et le résultat recherché demeure en droit, il peut- être réduit grâce à la liberté contractuelle si elle est correctement exploitée. C’est dire, finalement, que la transmission de l’entreprise par cession de droits sociaux est sans doute une voie idéale. L’objet du présent dossier est d’en exposer les raisons ainsi que les conditions. 1) Cf., entres autres références : T. Tarroux, La notion d’entreprise, JCP éd. N , 6 décembre 2002 ; G. Blanc, Les frontières de l’entreprise en droit commercial, D 1999, chr. p. 415 ; B. Vaillant, La notion d’entreprise en droit fiscal des affaires, thèse Toulouse 1996 ; A. Jeammaud, T. Kirat et M.-C. Villeval, Les règles juridiques, l’entreprise et son institutionnalisation : au croisement de l’économie et du droit, RID éco. (Bruxelles) 1996, p. 99 ; B. Mercadal, La notion d’entreprise, in Les activités et les biens de l’entreprise, Mélanges offerts à J. Derrupé, GLN-JOLY et LITEC, 1991, p. 9 ; D. Vidal, Une analyse juridique de l’entreprise, P.A., 9 juillet 1986, n° 82 ; M. Despax, L’entreprise et le droit, LGDJ, 1957. 2) On sait cependant que la notion d’entreprise ne se confond pas avec celle de fonds de commerce : B. Mercadal, art. préc. ; M. Despax, op. cit. 3) Civ. 1ère, 7 novembre 2000, Bull. n° 283. 4) A. Diesbecq, La cession de l’entreprise en difficulté par reprise du capital, Journal des Sociétés. Décembre 2008 n°60 p. 29. 5) M. Coiraton-Mavré, E. Causse-Cordier et C. Charroin, Le transfert du contrôle de la société non cotée, Journal des Sociétés, Décembre 2008 n°60 p. 16. 6) J.-Y. Martin, Le transfert du contrôle de la société cotée, Journal des Sociétés, Décembre 2008 n°60 p. 23. 7) C. Di uploads/Finance/ juriste-de-l-x27-entreprise.pdf
Documents similaires








-
45
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 24, 2022
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 0.4129MB