Économie de la Côte d'Ivoire Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. All
Économie de la Côte d'Ivoire Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Aller à : Navigation, rechercher Côte d’Ivoire Indicateurs économiques Abidjan, capitale économique Monnaie franc CFA Année fiscale année calendaire Organisations internationales Banque mondiale, OMC, UEMOA, CEDEAO. Statistiques Produit intérieur brut (parité nominale) 23,4 milliards $ (est. 2008) 2 Produit intérieur brut en PPA 34,9 milliards $ (est. 2007) 1 Rang pour le PIB en PPA 188e1 Croissance du PIB 2,3 % (2008) 2 PIB par habitant en PPA 1 600 USD (2011) 22 PIB par secteur agriculture : 23,9 % industrie : 25,3 % services : 50,8 % (est. 2007) 4 Inflation (IPC) 8,1 % (est. 2008) 2 Pop. sous le seuil de pauvreté 48,9 % (est. 2008) 2 Indice de développement humain (IDH) 0.432 (168e) (en 2013) 2 Population active 6 502 1153 Population active par secteur agriculture : 27 % industrie : 18,5 % services : 54,5 % (2006) 1 Taux de chômage 45 % Principales industries raffinage de pétrole, cacao, café, bois et produits en bois, produits alimentaires, boissons, assemblage de camion et d'autobus, textiles, engrais, matériaux de construction, électricité, construction de bateau et réparation Commerce extérieur Exportations 11.24 milliards USD (est. 2011) 12 Biens exportés cacao, café, bois, pétrole, coton, banane, ananas, huile de palme, poisson Principaux clients Allemagne 9,6 %, Nigeria 9,1 %, Pays-Bas 8,3 %, France 7,2 %, USA 6,9 %, Burkina Faso 4,4 % (2007) 1 Importations 7.90 milliards USD (est. 2011)12 Biens importés combustibles, biens d'équipement, denrées alimentaires Principaux fournisseurs Nigeria 29,5 %, France 16,8 %, Chine 6,9 %, Belgique 3,5 % (2007) 4 Finances publiques Dette publique 75,2 % du PIB (est. 2007) 1 Dette extérieure 13,79 milliards $ (est. 31 décembre 2007) 3 Recettes publiques 20,8 % du PIB (est. 2007)3 Dépenses publiques 20,5 % du PIB (est. 2007)3 Déficit public Aide au développement Sources : 1. CIA factbook2. Banque mondiale3. Perspectives éco4. PNUD modifier L’économie de la Côte d'Ivoire, avec un PIB par habitant qui s'élève à 1 600 USD en 20111 fait partie des économies en voie de développement. L'indice de pauvreté atteint 48,9 % en 2008. Depuis l'instauration du commerce triangulaire lors des premiers contacts avec les explorateurs, l'économie est dominée par l'exportation de produits dits de rente, en particulier le café et le cacao, pour lesquels la Côte d'Ivoire occupe les premiers rangs sur le plan mondial. Si l'économie ivoirienne repose à titre principal sur le secteur agricole que favorise un climat chaud et humide, l'apport de l'industrie au PIB est évalué à 20 % et celui du secteur tertiaire à 50 %. La Côte d'Ivoire possède de plus quelques réserves de pétrole non négligeables pour son économie. Elle possède aussi quelques ressources minières mais dont la production reste très mineure. Elle produit en outre de l'électricité, dont une part est revendue aux pays voisins. Les progrès constatés au cours des quinze premières années de l'indépendance ont fait place à une longue période de récession, favorisée par la chute des cours mondiaux des matières premières agricoles (café-cacao) et aggravée par divers facteurs dont la crise politico-militaire déclenchée en 2002. La Côte d'Ivoire reste toutefois un poids économique important pour la sous-région ouest- africaine : elle représente 39 % de la masse monétaire et contribue pour près de 40 % au PIB de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). La monnaie du pays est le franc CFA, dont la parité avec l'euro est fixe (1 euro = 655,957 francs CFA). Sommaire [masquer] 1 Historique o 1.1 Économie précoloniale o 1.2 Mutations économiques du XIXe siècle 2 Développements récents o 2.1 « Miracle économique » o 2.2 Programmes d'ajustement structurel o 2.3 Dévaluation du franc CFA o 2.4 Impact de la crise politico-militaire 3 Ressources naturelles o 3.1 Bois o 3.2 Diamant et or o 3.3 Pétrole et gaz naturel o 3.4 Énergie électrique 4 Infrastructures o 4.1 Transport terrestre o 4.2 Transport aérien o 4.3 Télécommunications 5 Structure économique o 5.1 Secteur primaire 5.1.1 Agriculture 5.1.2 Élevage et pêche o 5.2 Secteur secondaire 5.2.1 Industrie 5.2.2 Construction et travaux publics o 5.3 Services (secteur tertiaire) 5.3.1 Entreprises du secteur 5.3.2 Secteur financier 5.3.3 Tourisme 6 Rôle de l’État o 6.1 Secteur parapublic o 6.2 Réformes fiscales et budgétaires o 6.3 Nouveau code des marchés publics 7 Relations avec le reste du monde o 7.1 Investissement étranger o 7.2 Influences étrangères o 7.3 Positions extérieures o 7.4 Orientations 2012 8 Données sociales o 8.1 Population active o 8.2 Emploi et chômage o 8.3 Pauvreté et inégalité 9 Notes et références o 9.1 Notes o 9.2 Références 10 Voir aussi o 10.1 Bibliographie 10.1.1 Bibliographie de référence 10.1.2 Autres ouvrages 10.1.2.1 Historique 10.1.2.2 Développements récents 10.1.2.3 Structure économique 10.1.2.4 Rôle de l’État 10.1.2.5 Relations avec le reste du monde 10.1.2.6 Données sociales o 10.2 Articles connexes o 10.3 Liens externes Historique[modifier | modifier le code] Article connexe : Histoire de la Côte d'Ivoire. Économie précoloniale[modifier | modifier le code] La situation politique en Côte d'Ivoire précoloniale. L’économie de la Côte d’Ivoire est caractérisée à l’origine et durant de nombreux siècles par la recherche de l’autosubsistance. Elle est axée sur l’agriculture vivrière et utilise des techniques de cultures itinérantes sur brûlis. Toutefois, à partir du XVe siècle, elle entre dans une phase mercantilisteN 1 au contact de nombreux commerçants mandés d’origine soudanaise, attirés par la kola produite dans les régions Toura, Dan, Mahou, Bété, Gouro et Anno (zones forestières des centre-ouest et nord-ouest de l'actuelle Côte-d'Ivoire)4. Ces marchands recherchent également de l’or, dans des régions essentiellement habitées par les peuples Sénoufos (autour de Kong notamment), Djiminis et Lobi (nord et nord-ouest)4. À la veille de la conquête coloniale, deux systèmes politiques cohabitent sur le territoire de l'actuelle Côte d'Ivoire et influencent fortement l'économie : le système étatique d'une part, présent au Nord et à l'Est du pays, notamment dans les royaumes de Bouna, du Kabadougou, de Kong et dans les royaumes Akans. Dans ces sociétés à pouvoir centralisé, le mode de production est caractérisé par l’existence d’une classe dirigeante qui exploite la paysannerie et une classe servile. Les échanges économiques échappent peu ou prou à des impératifs de parenté pour s'inscrire dans une logique de profit économique5. Le système des sociétés lignagères d'autre part, pratiqué notamment par les populations lagunaires, Krous et Mandés du Sud. Ces peuples ne sont pas organisés en empires ou en royaumes, mais en lignages et classes d'âge, à l'intérieur de communautés tribales ou villageoises. Dans ces sociétés à pouvoir diffus, l'unité économique de base est le lignage, véritable centre de production et de consommation, voué pour l'essentiel à l’autosubsistance5. D'une manière générale, l'économie précoloniale se structure autour de divers espaces relativement homogènes. Ceux du Nord et du Centre du territoire sont reliés par un réseau de routes commerciales comportant de nombreux marchés et diverses cités commerciales, animées par des marchands dioula ou des membres des aristocraties dirigeantes locales. Le cauri et l'or y servent de monnaie de transaction. Ceux du Sud et de l'Ouest du pays comportent de multiples villages-marchés et les biens y circulent à travers des réseaux de parenté, d'alliance ou de clientèle plus éloignée. Au sein de ces entités l’on utilise le Sombé (un type de manille) comme monnaie d'échangeN 2. Ces espaces économiques connaissent de profondes mutations au cours du XIXe siècle. Mutations économiques du XIXe siècle[modifier | modifier le code] L’installation des colons sur le territoire ivoirien commence dès la fin des premières expéditions exploratoires menées par João de Santarém et Pedro Escobar au cours des années 1470-1471, les Hollandais à la fin du XVIe siècle, puis les Français et les Anglais au XVIIe siècle6,7. À leur contact, l’agriculture locale connaît une réorientation et est désormais pratiquée en vue de la commercialisation de produits tropicaux. Un type particulier d’échanges, la traite négrière, fait même son apparition dans les zones du littoral. L'esclavage est aboli en 1848 dans les colonies françaises et cette mesure formelle a un impact économique indéniable. L'arrêt de la déportation massive d'esclaves entraîne le développement d'une traite intérieure. Il favorise en outre, au sein des colonies, l'instauration et la multiplication de rapports de production de type esclavagiste. Chez les Dioula et les Malinké, les esclaves sont redirigés vers les vastes domaines agricoles tandis que chez les Akans, ils servent à l'extraction de l'or et au portage. Le commerce des produits naturels remplace alors celui des esclaves et l’agriculture est de nouveau dynamisée. Les échanges commerciaux s'accroissent sous la poussée de la demande aussi bien européenne qu'africaine, entrainant par leur ampleur l'émergence et la consolidation de la fonction de courtier africain, intermédiaire entre Européens et Africains, mais aussi entre populations côtières et celles de l'hinterland. Pendant cette période, les échanges croissants doublés d'une concurrence de plus en plus rude entre Français et Anglais amènent les premiers à installer sur le littoral (à Assinie et Grand- Bassam en 1843) des comptoirs uploads/Finance/ la-valeur-ajoutee-en-ci.pdf
Documents similaires



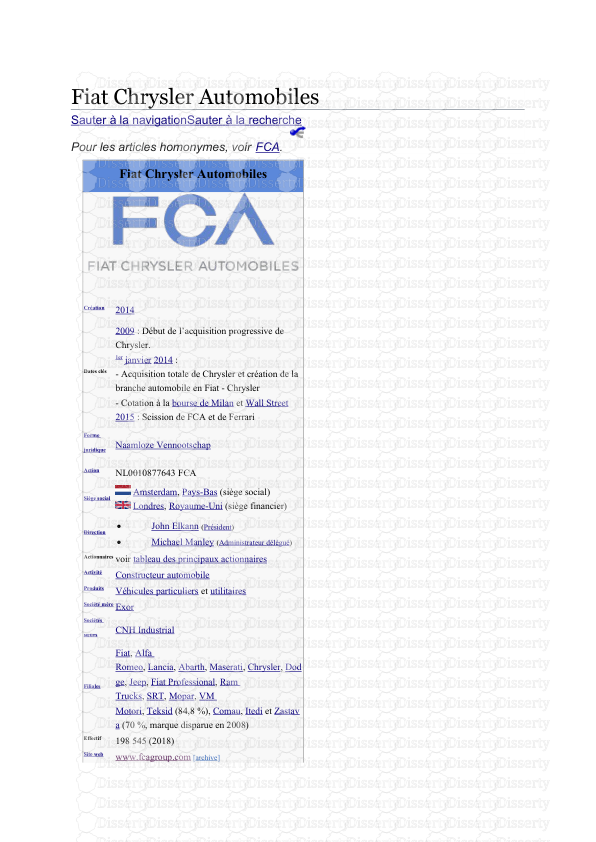




-
46
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 17, 2021
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 1.5283MB


