Les difficultés économiques des entreprises Mémoire IGS4 20/08/2010 PORBADNIK C
Les difficultés économiques des entreprises Mémoire IGS4 20/08/2010 PORBADNIK Caroline Remerciements Avant de commencer, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont, de près ou de loin, contribuer à la réalisation de ce mémoire. Je tiens d’abord à remercier Monsieur Pierre Fadheuille mon tuteur de mémoire, pour les conseils qu’il m’a donnés. Je voudrais ensuite remercier mes collègues Emmanuelle Albert, Brigitte Bouvard, Sandrine Laporte, Béatrice Tocci, ainsi que ma responsable et tutrice de stage Béatrice Santaga, pour le temps et le support qu’elles m’ont accordés. Enfin je souhaiterais remercier ma famille et mes proches pour la patience dont ils ont fait preuve et le soutien qu’ils m’ont apporté durant la réalisation de ce mémoire. AUTEUR NOM : PORBADNIK Prénom : Caroline TITRE du mémoire Les difficultés économiques des entreprises Ecole d’affiliation IGS 4 Directeur du mémoire : Pierre FADEUILHE COLLATION Nb de pages 50 Nb d’annexes Nb réf. Bibliographiques 14 TERRAIN D’ETUDE OU D’APPLICATION Potentiellement toute entreprise MOTS-CLES Défaillances d’entreprises, évolution des défaillances, loi sue la sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, prévention, mandat ad’ hoc, conciliation, procédures d’alerte, procédure de sauvegarde, procédure de redressement, liquidation judiciaire, procédures collectives, débiteurs, créanciers, tribunal de commerce, TGI, juge commissaire, représentants des salariés. RESUME : Les entreprises, au cours de leur vie, sont amenées à connaitre plusieurs difficultés, certaines pouvant conduire à leur perte. Les difficultés augmentent et de plus en plus d’entreprise les subissent. Le nombre d’entreprise faisant face à des procédures collectives ne cesse d’augmenter. C’est pourquoi l’Etat ainsi que le législateur tentent de leur venir en aide. Depuis 1984, les lois et les traitements des difficultés ont évolué. La prévention est au cœur de ce dispositif d’aide aux entreprises. Des mesures non juridiques ont ainsi été mises en places, comme l’établissement et la surveillance de certains documents et comptes comptables. Ensuite des mesures à la nature un peu floue entre une mesure juridique et contractuelle comme la conciliation. Enfin inspiré par des mesures américaines, la législation a évolué afin de permettre un traitement des difficultés avant la cessation des paiements, ce qui est totalement novateur en France. Mais dans la pratique, les entreprises développent elles aussi leurs techniques de préventions et de traitement des difficultés. Sommaire Introduction ............................................................................................................................................. 1 Partie 1 : Appréciation des difficultés économiques ............................................................................... 6 Nature et évolution des difficultés ....................................................................................................... 6 Les mesures préventives .................................................................................................................... 14 Partie 2 : Le traitement des difficultés ................................................................................................... 19 Les traitements en amont ................................................................................................................... 19 Les traitements curatifs ..................................................................................................................... 27 Partie 3 : Préconisation .......................................................................................................................... 39 La prévention par l’anticipation ........................................................................................................ 39 L’information .................................................................................................................................... 46 Conclusion ............................................................................................................................................. 48 Bibliographie ......................................................................................................................................... 51 1 Introduction La vie d’une entreprise, comme celle d’un individu, est jalonnée de plusieurs étapes essentielles comme la naissance, la croissance ou la disparition. Au cours de cette vie surviennent immanquablement des difficultés de tout ordre et de toute gravité des plus simples aux plus complexes, des plus légères aux plus graves. Une difficulté est, par définition un obstacle que l’on peut ou non surmonter. Le terme de difficulté est vaste et vague. Les difficultés qui nous intéressent ici sont d’ordres économiques, financiers et sociaux. Elles sont assez importantes pour provoquer ce que l’on appelle des défaillances d’entreprises. Ce terme juridique désigne des entreprises à l’encontre desquelles est ouverte une procédure collective telle que le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire. La matière qui nous intéresse est donc le droit des entreprises en difficulté. Il a fallu plusieurs étapes avant que ne soit consacré un droit des entreprises en difficulté. La première étape importante a été l’adoption des lois du 1er mars 1984 et du 25 janvier 1985. Ces deux lois sont à la base du droit des entreprises en difficulté tel que nous la connaissons aujourd'hui. Elles ont ensuite été améliorées par une loi du 10 juin 1994. La loi du 26 juillet 2005 vient approfondir les dispositions existantes et créer la procédure de sauvegarde. Cette dernière a été précisée par une ordonnance du 18 décembre 2008 et un décret du 12 février 2009. Les lois de 1984 et 1985 sont importantes puisqu’elles posent les bases du droit des entreprises en difficulté. La loi du 1er mars 1984 a introduit un système de prévention des difficultés et le règlement amiable, non judiciaire, de celles-ci. La loi du 25 janvier 1985, elle, a créé la procédure de redressement judiciaire destinée à sauver l’entreprise, à maintenir l’activité, à sauver les emplois et assainir le passif des entreprises, autrement dit à payer leurs dettes. La loi du 1er mars 1984, complétée par un décret de mars 1985 avait deux objectifs : un de prévention et un de règlement amiable. S’agissant de la prévention, selon le vieil adage « il vaut mieux prévenir que guérir ». Le but est donc d’agir en amont des difficultés plutôt que d’attendre la cessation des paiements. Il faut déceler les obstacles le plus tôt possible. Pour cela le législateur a mis en place un système d’information économique et d’alerte des dirigeants. Le règlement amiable est une disposition novatrice qui laisse place à un contrat plus qu’à une disposition juridique. En effet il s’agit d’un accord entre le débiteur et ses principaux créanciers. Aujourd'hui, c’est ce que l’on appelle la procédure de conciliation. La loi de janvier 1985 est la première sur le redressement et la liquidation judiciaire des entreprises. Cette loi a trois traits de caractère. Elle est économique, judiciaire et tente de dédramatiser la procédure collective. S’agissant du caractère économique le législateur utilise la phase d’observation et le plan de redressement. C’est une procédure judiciaire par trois aspects. C’est le tribunal de commerce ou le TGI qui est compétent pour ouvrir la procédure, 2 désigner les organes, autoriser les actes les plus graves et surtout il est compétent pour arrêter la solution. Il y a ensuite le juge commissaire désigné par le tribunal qui veille au bon déroulement de la procédure et dispose de prérogatives importantes. Enfin il y a le ministère public qui surveille les organes et surtout les administrateurs ainsi que le mandataire. Il est à l’origine des poursuites pénales et est informé à toutes les étapes de la procédure. Il peut également déclencher les voies de recours comme l’appel. La loi de janvier 1985 a voulu humaniser la procédure. D’abord dans la gestion, puisque le chef d’entreprise (le débiteur) n’est plus automatiquement dessaisi et ne fait pas non plus l’objet de sanctions automatiques. Pour qu’il soit condamné il faut qu’il fasse l’objet d’une faillite personnelle ou qu’il ait commis des fautes précises. Enfin depuis 1985 les salariés sont représentés dans les procédures collectives. Mais la loi de 1985 n’a pas eu le succès escompté. Globalement 10% des entreprises étaient redressées et 90% des cas de défaillances étaient des liquidations. C’est pour remédier à cela qu’est adoptée la loi du 10 juin 1994. Cette loi ne revient pas sur les choix de prévention. Cette loi accélère les procédures en réduisant les délais. Elle estime qu’il faut maintenir la prévention mais aussi l’améliorer. Cette loi a augmenté les pouvoirs du président du tribunal. Elle veut faciliter la conclusion d’accord amiable. Le législateur a voulu restaurer un peu du droit des créanciers sacrifiés pour le redressement des entreprises. Elle permet également au tribunal d’ouvrir directement une liquidation judiciaire. Ces lois ont été codifiées en 2000. Il est ainsi plus accessible. C’est à partir de cette codification qu’apparaît un droit spécial, à côté du droit commun, pour les entreprises en difficulté. A la fin des années 90 et au début des années 2000 un vent de réforme souffle sur les droits des entreprises en difficulté. En 1998 Madame Guigou, alors ministre de la justice envisage une procédure de redressement judiciaire anticipée, c'est-à-dire sans cessation des paiements ainsi qu’une procédure de liquidation accélérée pour les petites entreprises mais cette réforme n’aboutit pas. En 2004, Mr Perben découvre aux Etats-Unis une loi qui permet de saisir la justice par une procédure de sauvetage avant que l’entreprise ne soit en cessation des paiements. D’où l’idée d’une procédure de sauvegarde intégrée dans un projet de réforme. Finalement la loi du 26 juillet 2005, loi de sauvegarde des entreprises est adoptée. Il s’agit de sauver les entreprises. Cette loi n’abandonne pas les principes directeurs de 1984 et 1985. L’exposé des motifs dit « la sauvegarde des entreprises est un enjeu majeur pour notre économie et les hommes qui la développe ». Cette réforme a plusieurs fondements. D’abord le législateur considère que les lois de 1984 et 1985 ne sont plus adaptées aux années 2000. Elles trouvaient leur place dans un « principe d’économie dirigée, caractérisée par les nationalisations et l’interventionnisme de l’Etat dans la vie économique ». Or désormais nous sommes dans un modèle d’économie libérale et non plus dirigée. Ensuite les lois de 1985 sacrifiaient les droits des créanciers pour sauver les entreprises. Enfin l’attention portée aux objectifs et au déroulement de la liquidation était insuffisante. Le texte de 2005 se veut novateur, il créé la procédure de sauvegarde sans cessation des paiements, libéral car c’est le chef uploads/Finance/ memoire 11 .pdf
Documents similaires


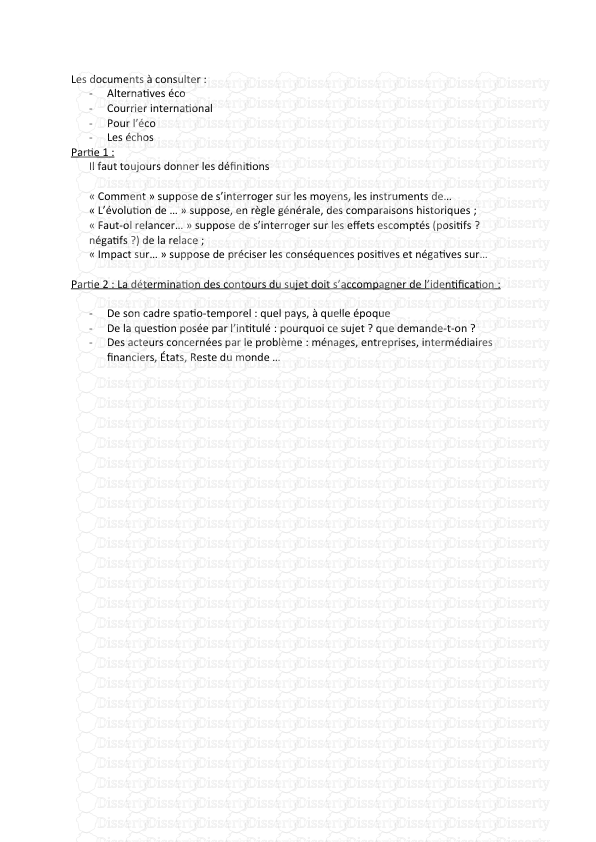


-
44
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 06, 2022
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 1.0400MB


