1 Jérôme Maucourant, HISOMA, le mercredi 2 décembre 20151 Un retour de la « que
1 Jérôme Maucourant, HISOMA, le mercredi 2 décembre 20151 Un retour de la « querelle du luxe » ? (présence de Thorstein Veblen) Introduction – Une question économique ou sociologique ? Je tiens d’abord à remercier Pierre Schneider de l’invitation qu’il me fait à participer à ces moments consacrés à la question du luxe en histoire. Sans doute a-t-il largement exagéré mes compétences d’économiste (politique) en cette question car, l’économie étant une maison aux nombreuses demeures, c’est plutôt la question de la dette et de la monnaie, plus généralement des rapports entre économie et souveraineté qui constitue mon objet de spécialisation. À cela, il faut rajouter, comme le précise mon collègue Joël Thomas Ravix - dans un article que j’ai découvert grâce à une note de P. Schneider– que les économistes ont délaissé cette question, et ceci pour des questions essentielles à la naissance même de la discipline. J’y reviendrai. C’est en vous écoutant continuer à creuser le sillon de cette affaire du luxe que je pourrais sans doute émettre des hypothèses plus solides à l’avenir. Pourquoi pas dans le cadre d’une publication si les dieux sont favorables ? Des récentes explorations que je viens de faire de cette question, il ressort deux idées – au cœur des deux parties de cet argumentaires - que je crois fondamentales et que l’on peut articuler comme je le propose ci-dessous. Pour la première : l’émancipation de l’économie comme idée vis-à-vis de la morale a impliqué, au XVIIIe siècle, de trancher le nœud de la querelle dans le sens de ce que l’on peut, rétrospectivement, dénommer « l’idéologie de la croissance ». Quant à la deuxième hypothèse : c’est la sociologie qui a pris le relais de la vieille critique du luxe, via une réflexion sur la distinction et la symbolique des objets, avant de se dissoudre quelque peu sous les coups d’approches microsociologiques ou de l’impérialisme de l’économie (néoclassique). Ainsi fut réussi le coup de force craint par Veblen, il y a tout juste un siècle : évacuer la question des goûts comme enjeu légitime de la dispute savante. Ma conclusion est la conscience d’une économie encastrée dans la nature, et non simplement dans la société, redonne toute sa place à la question du luxe, à l’opposition bannie par Mandeville et Voltaire entre le luxe et le nécessaire. Le moment Mandeville : pourquoi le luxe n’est plus (vraiment) une question économique On doit à Hayek2 le qualificatif de « Master Mind » à Mandeville qui aurait été le précurseur de la théorie de l' « ordre spontané » pour reprendre la terminologie propre aux Autrichiens. En effet, ce qui active et renforce la société, soutient Mandeville dès 1714, n’est rien d’autres que le désir de jouissance matérielle. Nul besoin de commandement divin ou d’homme sages enseignant aux hommes ce qui doit être fait. Exit la transcendance dans cette pensée de la société selon une pure immanence (économique). Ce n’est donc pas en chercheur de paradoxe que Voltaire, lecteur de Mandeville dans son « Mondain » écrira : “Le superflu, chose très nécessaire, A réuni l’un et l’autre hémisphère. [...] Tandis qu’au loin, vainqueurs des musulmans, Nos vins de France enivrent les sultans”. Ce superflu, si 1 Journée d'étude Ex oriente luxuria (II) - Maison de l'Orient et de la Méditerranée. Je remercie Fatiha Boudjalhat de sa lecture critique, ainsi qu’Olivier Brette et Bernard Drevon pour leur conseil en vue d’explorer cette terra incognita qu’est pour moi la question du luxe. Les discussions avec Bernard Drevon ont en effet été déterminantes pour la forme de la première partie. Pour ce qui de l’œuvre de Veblen et son actualité, voir les Amis de Thorstein Veblen (http://thorstein.veblen.free.fr/). 2 F. Hayek, “Lecture on a Master Mind : Dr. Bernard Mandeville”, Proceedings of the British Academy, 1966, vol. 52, p. 125-141). 2 nécessaire, c’est là secret d’une « Grande Société » (mot de Necker3 repris de facto par Hayek), une société ouverte et en mouvement perpétuel. C’est pourquoi Mandeville pourra écrire que le mot « luxe » est dépourvu pratiquement de signification4 ! Arnaud Diemer nous rappelle que Melon (L’Essai politique sur le commerce, 1734), peu après Mandeville, remarquait que le luxe est relatif à une époque et que les lois somptuaires n’ont pour seul effet que d’entraver l’industrie : il en vient même à anticiper la fameuse « loi des débouchés » de Say (1802), à savoir que les produits s’échangent contre des produits, que la production engendre la demande : la hausse du prix des biens de luxe est donc chose positive pour nos manufactures. Au même. Cantillon, dans son Essai sur le commerce en général, soulignait les effets pervers systématiques que produisent les lois entravant la circulation: elles haussent le prix de biens interdits à cause du prix croissant du risque, pour l’essentiel 5… Que nous sommes loin, alors, de Montchrestien, le fondateur de l’économie politique en son Traicté de 1614, écrivant que la source de l’œconomie politique est l’œconomie naturelle : “ Le sage politique […] doit imiter la nature, à qui jamais ne manque rien de nécessaire, à qui jamais rien de superflu ne redonde ”6. Ainsi, la politique du prince doit renvoyer l’économie “ détraquée ”, selon le propre mot de Montchrestien, à la “ nature ”. Le sens de l’adjectif naturel ne doit donc pas induire le lecteur contemporain à de fâcheuses confusions ! Le modèle de la vie domestique rappelle bien sûr l’apologie de la “ voie mitoyenne ” du grand Turc. L’œconomie politique en vient donc à condamner, à l’origine, en ce début du XVIIe sièce, la consommation démesurée des richesses. L’économie est l’objet d’une politique contrainte par des desseins moraux. La morale et les exigences de l’accumulation de métal se rejoignent heureusement parce que, selon Monchrestien, le commerce avec le Levant serait déficitaire à cause de la propension au luxe de notre élite, laquelle est “ peste publique, et ruine fatale des Monarchies ! ”7. En conclusion, je reviendrai sur cette question : la réalité d’un monde fini nous renvoie à l’économie comme la concevait Montchrestien, une économie politique que les grands libéraux avaient enterré en gagnant la querelle du luxe, en conservant ce nom d’économie politique ! La révolution est souvent bien retour à l’origine … L’on doit toutefois ne pas radicaliser la position libérale. Smith lui-même, comme Say un peu après, a continué à penser le luxe de façon ambivalente, et il n’a pas totalement éradiqué cette question comme le fit Mandeville et Hayek à sa suite. Mais, cette ambivalence repose sur un point faible de l’économie politique classique : la question du travail productif. En effet, avec Smith, les classiques vont considérer que la consommation improductive relève de la catégorie du luxe, toute hausse de 3 Ravix, p. 42 4 Diemer, p. 17. La mondialisation des années 1990 a réalisé pratiquement, plus de deux siècle après, l’empire du doux commerce sur le seul temps assez court de l’inter-siècle américain (1989-2003), ce qui n’est pas sans signification. Or, les libéraux du XVIIIe furent aussi aveugles que nos néolibéraux, faisant abstraction des conditions sociale et politique d’un tel phénomène. Il était certes difficile de nier, avant 2003, que la puissance des Etats-Unis était devenue aveuglante. Mais ceci était considéré par beaucoup comme vrai dans le seul ordre politique et, dans la mesure où cet ordre est subordonné aux mécanismes du marché mondial, cette question d’identité du dominant ultime n’avait finalement que peu d’importance. Or, comme nous le verrons en conclusion, le retour de la question du superflu sera aussi celui de la politique et d’un ordre mondial. 5 L’analyse de la politique du Portugal, montrant les effets non prévus et négatifs qui viennent troubler l’harmonie de la mécanique marchande5 est parfaitement éclairante à cet égard. Supposons que le roi de ce pays veuille, de façon artificielle, faire des économies sur les sorties de métaux précieux par des “ défenses ” inspirant de la “ terreur ” : le résultat ne sera que de faire hausser le prix des biens importés convoités, donnant ainsi davantage d’incitations à transgresser la loi ! Ainsi, s’agissant du roi : « ses sujets, même ses courtisans, paient le prix du risque qu’on cours pour rendre la défense inutile. On ne tire aucun avantage d’une pareille loi ; au contraire, elle cause un désavantage réel au Portugal parce qu’elle cause qu’il sort plus d’argent de l’Etat qu’il n’en sortirait s’il n’y avait pareille loi » Il y a là l’esquisse d’un modèle d’économie pure donnant un “ prix ” au risque et de la substance à la figure du contrevenant comme “ entrepreneur ”. Cette esquisse illustre donc les effets pervers de l’interventionnisme selon une logique qui a connu ultérieurement une bonne fortune. 6 Traicté, p. 127. 7 Ibid., p. 361. 3 celle-ci entravant l’accumulation du capital et donc la « richesse des nations » … Ceci pose deux problèmes : si un professeur de musique, par exemple, est payé en soustraction du capital, cela affecterait, toutes choses égales par ailleurs, les uploads/Finance/ un-retour-de-la-querelle-du-luxe-presenc.pdf
Documents similaires

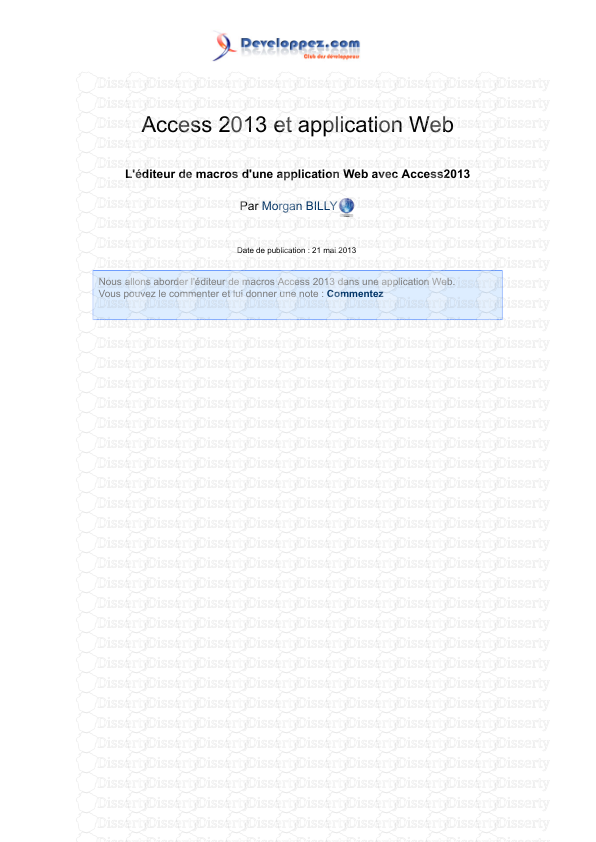








-
54
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 14, 2021
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 0.1667MB


