Commerce honteux pour négociants vertueux à Marseille au XVIIIe siècle ? Gilber
Commerce honteux pour négociants vertueux à Marseille au XVIIIe siècle ? Gilbert BUTI (Aix-Marseille Université MMSH – TELEMME -Aix-en-Provence) Bien qu’elle développât sans cesse au XVIIIe siècle son commerce avec les Iles françaises d’Amérique, Marseille, à l’inverse de Nantes, s’est peu tournée vers la traite négrière. Excentrée par rapport aux domaines océaniques et solidement ancrée dans l’espace méditerranéen, Marseille a longtemps écarté de ses pratiques le commerce triangulaire qui fut le soutien de nombreux ports du Ponant pour privilégier les voyages en droiture vers les Antilles. Cette indifférence pour le « commerce honteux » apparaît à d’aucuns tout à fait naturelle à Marseille. Un profond sentiment d’humanité y rendrait compte d’une opposition de principe et expliquerait le manque d’ardeur des négociants pour ce trafic. Pourtant, force est de reconnaître que si Marseille s’est tenue durant plusieurs décennies à l’écart de ce mouvement, elle ne l’a pas totalement ignoré. Qui plus est, à partir de 1783 quelque chose de nouveau se produit soudainement qui conduit des hommes de la boutique et du comptoir – et de nombreux intéressés dans leur sillage – à ne plus privilégier les voyages en droiture et à s’engager dans le « commerce circuiteux. » Ainsi, à la fin du XVIIIe siècle, alors que diverses voix manifestent, à Marseille comme ailleurs, une vive réaction antiesclavagiste, la traite y connaît un essor fulgurant. Si de 1698 à 1782, 39 navires marseillais ont été armés pour les côtes de Guinée et d’Angola, 77 le sont vers ces mêmes côtes et celles d’Afrique orientale de 1783 à Gilbert BUTI 200 1793. Cette brusque accélération en rien originale se retrouve dans plusieurs ports de France et d’Angleterre. Choix économiques de nouvelles figures marchandes ou modifications de stratégies de vénérables maisons de la grande place méditerranéenne ? Pourquoi, alors que Marseille se range parmi les ports négriers du royaume, les vertueux principes ont-ils brutalement fléchi ? Une sensibilité antiesclavagiste « naturelle » des Marseillais ? Antiesclavagistes marseillais En 1773, le négociant marseillais Charles Salles qui a fait assurer son brigantin, le Comte d’Estaing, pour « la traite des nègres », se retourne contre ses assureurs car le bâtiment a été perdu non loin de la Martinique et avec lui sa cargaison d’esclaves. Les assureurs qui considèrent sans fondement la requête du négociant choisissent pour défendre leur cause le jurisconsulte Balthazard-Marie Emerigon, futur auteur d’un Traité des assurances qui fera autorité et qui est parfois considéré comme un « fondateur du droit maritime en Europe1. » Dans son plaidoyer en faveur des assureurs l’avocat s’élève avec véhémence contre les exigences du négociant en une profession de foi abolitionniste : « L’homme n’est ni une chose, ni une marchandise propre à devenir la matière d’une assurance maritime (…) Dire que les esclaves noirs sont des choses et des marchandises, c’est se dégrader soi-même en dégradant la nature humaine2. » En s’opposant au principe qui faisait des esclaves des « êtres meubles » le jurisconsulte se dresse contre le Code Noir et soutient que les esclaves ont raison de repousser la force par la force. Le propos dépasse le cadre d’une affaire d’assurance maritime quand Emerigon s’interroge sur le principe même de la colonisation : « L’armateur courbé sur son comptoir règle, la plume à la main, le nombre d’attentats qu’il peut commettre sur la côte de Guinée. Il examine à loisir combien chaque nègre lui coûtera de fusils à livrer pour entretenir la guerre qui fournit les esclaves et les chaînes de fer pour les tenir 1. Balthazard-Marie EMERIGON, Traité des assurances et des contrats à la grosse aventure, Marseille, Mossy, 1783. 2. Cité par Gaston RAMBERT, Histoire du commerce de Marseille, T. VI Les colonies de 1660 à 1789, Paris, Plon, 1959, p. 174-175. Commerce honteux pour négociants vertueux 201 garrotés sur son navire. Le capitaine négrier calcule avec complaisance le droit de commission que chaque nègre acheté lui procurera et de combien d’esclaves, acquis même aux dépens des armateurs, il grossira sa pacotille. L’habitant américain calcule à son tour combien lui vaudra chaque goutte de sang dont le nègre arrosera son habitation et si la négresse donnera plus à sa terre par les travaux de ses mains que par le travail de l’enfantement. » Le tribunal de l’amirauté se montre peu sensible aux propos de Balthazard-Marie Emerigon et condamne, en mars 1776, les assureurs à payer le dédommagement réclamé ; la sentence est confirmée par le Parlement en mai 1778. Au même moment, l’Académie de Marseille, au sein de laquelle se trouvent des négociants et planteurs, couronne le Discours de l’un des siens, le négociant protestant André Liquier qui s’indigne en ces termes : « Comment passer sous silence le moyen qu’on inventa pour défricher l’Amérique, après l’avoir dévastée ? Moyen infâme et qui sera l’opprobre éternel du commerce. Quand on vit que la dépopulation du Nouveau Monde entraînait celle de l’Ancien, la cupidité féconde en ressources imagina le commerce des nègres. Barbares que nous sommes ! Nous combinons de sang-froid l’achat et l’esclavage de nos semblables et nous osons parler encore d’humanité et de vertu !Nous ventons les miracles que notre industrie opère pour l’utilité et l’agrément de la vie ; et c’est au prix de 60 000 infortunés que nous arrachons à l’Afrique, comme de vils troupeaux, dont une moitié périt de désespoir avant d’arriver en Amérique et l’autre y trouve une mort prématurée dans l’excès des travaux et des tortures. Si l’on demande maintenant, quelles mœurs ce trafic abominable a produites dans le Nouveau Monde : ici, des esclaves mutilés abrutis, succombant sous le poids de leur misère ; là, des maîtres fiers, voluptueux, plongés dans toutes sortes de dissolutions, en un mot, tout ce que la tyrannie, le caprice, la débauche, le concours de tous les vices a de plus odieux ; tel est le spectacle que nous présente un hémisphère acquis par le crime, habité par les derniers hommes et cultivé ensuite par l’esprit du commerce3. » 3. « Quelle a été dans tous les temps l’influence du commerce sur l’esprit et sur les mœurs des peuples ? », in- Recueil des pièces présentées à l’Académie de Marseille. Discours d’André Liquier, négociant de Marseille, qui a remporté le prix au Jugement de l’Académie en l’année 1777, Marseille, François Brebion, 1778. Gilbert BUTI 202 Peu de temps après, dans ses Soirées provençales éditées en 1786- 1787, Bérenger dénonce à son tour les échanges d’esclaves noirs contre du corail auxquels se livrent des Provençaux sur les côtes africaines : « Le commerce, fils de la liberté, pénètre dans les royaumes noirs et y commence l’exécrable édifice de l’esclavage américain (…) Quand cesserons-nous d’insulter la nature et d’outrager les lois (…) et ces lois qui se taisent, quand cesseront-elles d’être complices, par leur silence, de nos passions cupides et de nos abominables préjugés ?4 » En cette fin de siècle des Lumières qui a vu se forger lentement un mouvement antiesclavagiste, ces hommes se dressent en des termes forts – dont on trouve des échos ailleurs, à commencer par Nantes – contre le « commerce honteux ». Comme d’autres places marchandes européennes, Marseille a été pénétrée par le mouvement des idées développées contre ces pratiques5. Pour d’aucuns cette répugnance résulterait du « tempérament » des Marseillais. Ainsi, pour Gaston Rambert, « alors que les ports de l’Atlantique ont très vite saisi l’intérêt de la traite, c’est un fait notoire que Marseille y a longtemps répugné6. » Une répugnance locale ancienne chez les Marseillais ? Cette attitude résulterait d’une « opposition de principe » et d’un « sentiment d’humanité » propres aux Marseillais7. L’hostilité à un trafic ayant l’homme pour objet apparaîtrait naturelle dans une cité où le mot « esclavitude » aurait une résonnance profonde. En effet, la Méditerranée était encore aux XVIIe et XVIIIe siècles un vaste marché d’hommes et Marseille y payait un lourd tribut. Trop de captifs victimes des Barbaresques croupissaient dans les cachots ou ramaient sur les navires des renégats et terminaient misérablement leur vie chez l’infidèle avant d’avoir pu être rachetés par les pères de la Rédemption, Trinitaires ou Mercédaires. Dans ces conditions, « il ne faut donc pas s’étonner, pour Gaston Rambert, que le métier de négrier ait rencontré à Marseille une sorte d’opposition de principe8. » 4. M.L.P. BERENGER, Soirées provençales, Paris, 1786, tome 1, p. 126. 5. Jean EHRARD, Lumières et Esclavage. L’esclavage et l’opinion publique en France au XVIIIe siècle, Bruxelles, André Versaille, 2008. 6. Gaston RAMBERT, Histoire du commerce…, op. cit., p. 144. 7. Idem, p. 144. 8. Idem, p. 144. Commerce honteux pour négociants vertueux 203 À cette sensibilité il faudrait ajouter d’autres facteurs peu favorables aux Marseillais, à commencer par des conditions géographiques peu propices. Ainsi, par sa situation Marseille est excentrée par rapport à l’océan Atlantique et, comme le rappelle la Chambre de commerce dans un Mémoire adressé à Choiseul en 1767, « le débouquement de la Méditerranée rend nécessairement la navigation plus longue et plus précaire9. » Des incompétences locales seraient également à l’origine de ce uploads/Geographie/ 11-commerce-honteux-esclavage-marseille-18e.pdf
Documents similaires

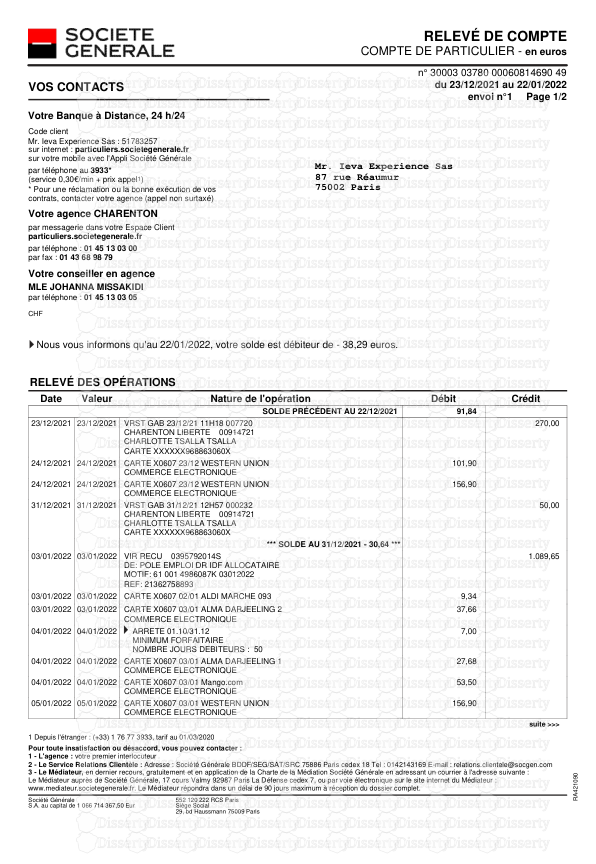








-
90
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 12, 2022
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 0.4042MB


