Alain Roger - hypothèse que j'explore et expose depuis deux décennies est résol
Alain Roger - hypothèse que j'explore et expose depuis deux décennies est résolument L culturaliste: il n'y a pas de beauté naturelle, qu'il s'agisse de la femme, naturellement "abominable", selon Baudelaire, et qui doit se usurnaniraliser" par le moyen de I'art, ou de nos paysages, qui sont des acquisitions, ou, mieux, des inventions culturelles, que nous savons dater et analyser. Je considère, d'une Façon générale, que toute notre expérience, visuelle ou non, est modelée par des modèles artistiques. La perception, historique et culturelle, de tous nos paysages -campagne, montagne, mer, désert, etc. - ne requiert aucune intervention mystique (comme s'ils descendaient du ciel) ou mystérieuse (comme s'ils montaient du sol), elle s'opère selon ce que je nomme, en reprenant un mot de Montaigne, une artialisation. Pays et paysages II existe deux façons d'artialiser un pays pour le transformer en paysage. L a première consiste à inscrire directement le code artistique dans la matérialité du lieu, sur le terrain, le socle naturel. On artialise in situ. C'est I'art millénaire des jardins, le landrrape gardening depuis le XVIIIc siècle, et, plus proche de nous, le Land art. L'auue manière est indirecre. On n'artialise plus in situ, mais in visu, on opère sur le regard collectif, on lui fournit des modèles de vision, des schèmes de perception et de délectation. Je rejoins donc le point de vue d'Oscar Wilde - c'est la nature qui imite l'an - et l'esthétique proustienne de l'artiste "oculiste". ParSrpaysage, cette distinction lexicale récente (elle ne remonte pas audelà du XV) se retrouve dans la pluparc des langues occidendes: Lrndladmpeen anglais, Lund--ch@ en allemand,paLs-p&zje en espagnol,paese-paeraggio en iralien, pd-paiwgem en portugais. Le pays, c'est, en quelque sorte, le degré dro du paysage, ce qui précède son artialisaùon, qu'elle soit directe (in s i t u ) ou indirecte (in v L n c ) . Voila ce que nous enseigne l'histoire, mais nos paysages nous sont devenus si Familiers, si "naturels", que nous avons tendance à croire que leur beauté va de soi; et c'est aux artistes qu'il appartient de nous rappeler cette vérité première, mais oubli& qu'un pays n'est pas, d'emblée, un paysage, et qu'il y a, de I'un à i'aucre, toute I'élaboration de l'm. La Rome impériaie, première société paysagère de l'histoire Dans Les Raisons dzt paysage, Augustin Berque énonce les quatre conditions ou critères de l'existence du paysage: 1) "Des représentations linguistiques: un ou des mots pour dire Paysage". 2) "Des représentations littéraires, orales ou écrites, chantant ou décrivant les beautés du paysage". 3) "Des représentations picturales, ayant pour thème le paysage". 4) "Des répresentations jardinières" ou rapportées à des jardins d'agrément. Si l'on retient ces quatre critères, le titre de "société paysagère" doit être accordé avec prudence et parcimonie: à la Chine ancienne, au moins depuis la dynastie Song (960-1279), et sans doute bien avant, ainsi qu'à l'Europe occidentale, à partir du XV siècle. Ni la Grèce antique, ni l'Europe médiévale ne sont, à strictement parler, des sociétes paysagères, puisqu'elles ne remplissent pas la première condition: elles n'ont pas de mors pour nommer le paysage. 1 1 en va différemment de la Rome ancienne et je me sépare de Berque sur ce point précis, car je considère que, au moins au début de l'ère impériale, Rome a été la première société paysagère dans l'histoire de l'humanité. Elle a des jardins d'agrément, des représentations picturales, les Fameuses fresques de Pompéi par exemple, des représentations littéraires, les Bucoliques et les Géo'grques de Virgile, par exemple, et "des mots pour le diren. On trouve en effet chez Vitnive, dans son De Architectura (Ier siècle av. J-C), un néologisme: topia, forgé a partir du grec topos (pays), et qui désigne sans conteste ce que nous nommons aujourd'hui des paysages (il est d'ailleurs significatif qu'en grec moderne 'paysagen se dise "topio"). On trouve de même dans l'Histoire nature& de Pline l'Ancien, I'expression "topiaria opera", oeuvres topiaires, paysagères, pour désigner les fresques murales qui, dans les villas impériales, représentaient des paysages, urbains ou ruraux. On aurait donc un phénomène artistique et linguistique comparable à celui qu'a connu l'occident quinze siècles plus tard: I'apparitionn d'un néologisme (ici un héllénisme), pour désigner à la fois - car il est malaisé de déterminer la priorité - la représentation artistique et l'objet naturel. Naissance du paysage occidental Notre premier paysage - la Campagne, un pays sage, un paysage ... - nous est venu du Nord (la Flandre) et non de l'Italie. L'histoire de l'art est énigmatique. Pourquoi la peinnue italienne, si novatrice au Trecento, n'a-t-elle pas inventé le paysage? Pourquoi l'audace d'un Lorenzetti est-elle restée sans lendmain? On s'accorde à voir dans Les Efè du Bon Gouvmemmt (vers 1340) l'un des premiers paysages occidentaux. On mentionne moins souvent, sans doute en raison de leur format, deux minuscules tableaux, atribués d'abord au même Lorenzetti et aujourd'hui à Sasserra, conservés à la pinacothtque de Sienne, Chateau au borddu k z et Vilk sur h m e r , dont la profondeur est assurément défèmeuse, selon les règles, codifih ultérieurement, de la perspective linéaire, mais qui témoignent d'une volonté de laîciser le pays, en le libérant de toute réHrence religieuse. On aperçoit même, dans l'angle inf6rieur droit du second tableau, une petite scène, éminemment profane: une femme nue, qui baigne ses pieds dans l'eau d'une crique . . . Mais, comme le souligne Kenneth Clark, ces paysages "demeurent sans postérité pendant presque un sieden. La question des Tanrina sanitatis, on "Traités de santé", traduits de l'arabe et publiés en Italie du Nord dans la seconde moitié du T r c e n n t o , est encore plus troublante. II s'agissait de présenter et d'illustrer les connaissances médicales de l'époque, telles que les traités arabes, d'inspiration hippocratique et galienne, les avait recensées: propriétés médicinales des plantes, des aliments carnés, etc. En fait, c'est toute la vie quotidienne en Itaiie du Nord qui se trouve ici représentée. On est impressionné par la beauté de ces planches et par leur volonté de laïcisation, comme si l'artiste, en ce domaine sans doute réservé à des lecteurs privilégiés, pouvait enfin donner libre cours à son inspiration p r o b e et paysagère. Avec le recul, nous pouvons dire que l'invention du paysage occidenml supposait la réunion de deux mndiuons. D'abord, la laïcisation des éléments namis, arbres, rochers, rivieres etc Tant qu'ils restaient soumis à la scène religieuse, ils n'étaient que des signes, distribués, ordonnés dans un espace saaé, qui, seul, leur conErait une unid C'est pourquoi, au Moyen Âge, la représentation na&e n'offre aucun indrér: elle risquerait de nui= à la )onction édifiante de l'oeuvre. II Faut donc que ces signes se détachent de la scène, redent, s'éloignent, et ce sera le rôle, évidemment d & i i de la perspective. En instituant une ~6ritable profondeur, elle met à distance ces éléments du htur paysage et, du même coup, les laïcise. Ils ne sont plus des satelites fuces, d i s p o s é s autour des icônes centrales, ils forment l'arrière-plan de la scène (au lieu du fond doré de l'art b v t i n ) , et c'est tout différenr, car l à iis se muvent à l'écart et comme à l'abri du sacré. Mais les voila condamnés à se brger leur unité. Telle est la seconde condition: il but dbrmais que les éléments naturels s'organisent eux-mêmes en un groupe autonome, au risque de nuire à l'homogénéité de l'ensemble. Cene double opération, nous en trouvons l'ébauche chez les miniaturistes du Nord, en particulier dans le dlébre "Calendrier" des Trés Riches Heures du Duc de B q , dû Pol de Limbourg (début du W). II n'y manque qu'une organisation rigoureuse de la profondeur, en raison de ce qu'on pourrait appeller la perspective U ascendante'', comme on peut le constater dans le mois de février, où les scenes supérieures, dans un souci de visibilité, fort séduisant d'ailleurs, sont situées trop haut, et donc trop prh, par rapport au premier plan, où un couple impudique se réchauffe le bas-ventre devant une cheminée. Voir aussi le mois d'octobre. Mais l'évènement décisif est certainement l'apparition de la fenêtre, cette vedzcta intérieure au tableau, mais qui l'ouvre sur l'extérieur. Cene trouvaille flamande est, tout simplement, l'invention du paysage occidental. L a fenétre, est en effet ce cadre qui, l'isolant, l'enchâssant dans le tableau, institue le pays en paysage. Une telle soustraction - extraire le monde profine de la scène sacrée - est, en réalité, une addition: le age s'ajoutant au pays; et il est vraisemblable que la premiére occurrence occidentaie du mot "paysage" - c'est-&dire "kzndrchap", en néerlandais, dans la seconde moitit du W , littéralement "bout de pays" -a désigné cette portion d'espace, délimitée par la fenêtre picturale. Quoi qu'il en fût, celle-ci dunit les deux conditions que je viens de poser. Iaicisation et unification. II suffira de la dilater aux dimensions du tableau, où elle s'ins&re encore, telle une miniature, pour obtenir le paysage occidental. D'où je conclus que celui-ci est entrt par la petite porte ou, pour mieux uploads/Geographie/ alain-roger-la-naissance-du-paysage-en-occident 1 .pdf
Documents similaires







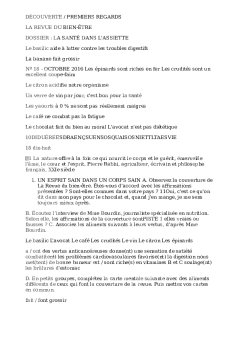


-
40
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 25, 2022
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 3.2781MB


