Revue de géographie de Lyon C. Amoros, G.-E. Petts, Hydrosystèmes fluviaux Herv
Revue de géographie de Lyon C. Amoros, G.-E. Petts, Hydrosystèmes fluviaux Hervé Piégay Citer ce document / Cite this document : Piégay Hervé. C. Amoros, G.-E. Petts, Hydrosystèmes fluviaux. In: Revue de géographie de Lyon, vol. 71, n°4, 1996. La rivière, un corridor naturel à gérer. p. 286; http://www.persee.fr/doc/geoca_0035-113x_1996_num_71_4_4357 Document généré le 24/03/2016 Compte rendu d'ouvrage Hydrosystèmes fluviaux C. AMOROS et G.-E. PETTS (coordonnateurs), 1993, Paris, Collection d'écologie n° 24, Masson, 300 p. Cet ouvrage, rédigé par une équipe franco-anglaise coordonnée par С Amoros, écologue à l'université Lyon I et G.E. Petts, géographe à l'université de Birmingham, constitue une très bonne synthèse des recherches systémiques conduites sur les grands cours d'eau. La plupart des exemples sont pris en Europe ou en Amérique du Nord; beaucoup portent sur le Haut-Rhône français. Le concept d'hydrosystème a en effet été élaboré au début des années 1980 dans le cadre du P.I.R.E.N. Rhône (AI. Roux, 19821). Il apparaît aujourd'hui comme un concept de premier ordre qui a guidé près de 15 ans de recherche en environnement dans la région Rhône-Alpes. Il s'est par ailleurs rapidement diffusé dans la communauté scientifique et parmi les gestionnaires. Surtout appliqué aux cours d'eau, ce concept est venu renforcer les notions plus globales de géosystème ou d'écosystème développées alors par les géographes et les écologues. Il identifie un système particulier, ouvert et régi par l'eau. Il est né d'une nouvelle conception de la recherche centrée sur une "approche interdisciplinaire et intégrée de l'analyse, de la modélisation et de la gestion environnementale des cours d'eau". Comme le souligne le chapitre 1 de l'ouvrage, les bases conceptuelles sont clairement définies : un système à quatre dimensions dont les dynamiques, qu'elles soient naturelles (physiques, chimiques ou biologiques), ou humaines s'expriment à diverses échelles de temps et d'espace. de l'environnement (satisfaction des usages, gestion des risques et de la ressource en eau, préservation, restauration, réhabilitation et entretien des milieux...). Le lecteur se demandera peut-être quelle est la raison qui me pousse à rédiger le compte rendu d'un ouvrage qui est sorti il y a déjà 4 ans et qui est introuvable dans les librairies. Sans conteste, sa qualité scientifique et son caractère novateur, la richesse des figures et des illustrations peuvent l'expliquer; l'ouvrage est encore aujourd'hui une référence. Mais, ce compte rendu souhaite également informer le lecteur qu'une nouvelle édition, en langue anglaise2 et coordonnée par G.-E. Petts et С Amoros, est sortie en 1996; notons que l'éditeur français pense rééditer l'ouvrage qui avait été initialement tiré à seulement 800 exemplaires. Espérons qu'il tienne promesse, car cet ouvrage bénéficie d'un large public d'étudiants de deuxième et troisième cycle issus de différentes disciplines et de gestionnaires. Beaucoup de concepts développés dans ce livre sont en effet couramment utilisés dans le monde de la gestion, notamment en France, à la suite de la loi sur l'eau de 1992. Hervé PIEGAY L'ouvrage, composé de 10 chapitres, est de fait structuré autour de trois thèmes-clés illustrant la notion d'interdépendance : les facteurs externes, les communautés vivantes et les dynamiques spatio-temporelles internes. Les facteurs de contrôle externe correspondent aux mécanismes physiques et chimiques qui contrôlent la genèse, le fonctionnement et les transformations du système. Sont ainsi tour à tour décrits, le rôle du réseau hydrographique, du climat et de sa variabilité historique, de l'hydrologie, de l'hydrochimie ou de la dynamique fluviale dans la structuration des hydrosystèmes fluviaux. Une régionalisation des caractéristiques de contrôle est développée et démontre la diversité des agencements naturels en fonction des spécificités géographiques. Les processeurs biotiques et les processus internes sont finement analysés dans les trois chapitres qui suivent. Les caractères des communautés vivantes et leur distribution spatiale sont ainsi abordés à partir de chapitres centrés sur les producteurs et les productions primaires, les invertébrés aquatiques et les peuplements de poissons. La dynamique des unités de la mosaïque qui s'exprime au sein de l'hydrosystème sous la forme d'échanges, d'interactions ou d'évolutions est l'objet du dernier ensemble de chapitres. Sont alors abordées les notions de connectivité et d'écotone c'est-à-dire d'interactions entre les unités de l'hydrosystème, de succession écologique. L'influence des activités humaines que ce soit à l'échelle du bassin versant ou du tronçon fluvial est également considérée; les auteurs montrent que les impacts humains co-agissent dans le temps et l'espace et expliquent les phénomènes de métamorphose. En guise d'épilogue, l'ouvrage aborde les problèmes de gestion de rivière dans un cadre qui reste néanmoins très théorique mais qui laisse apparaître les nouvelles préoccupations des chercheurs et explique les avancées récentes de la recherche universitaire appliquée aux problèmes 1 -ROUX A.-L. (coordinateur), 1982, Cartographie polythématique appliquée à la gestion des eaux. Etude d'un hydrosystème fluvial, le Haut-Rhône français, C.N.R.S. Lyon, 113 p. 2 -PETTS G.-E. et AMOROS C, 1996, Fluvial Hydrosystems, Chapman & Hall, 322 p. uploads/Geographie/ geoca-0035-113x-1996-num-71-4-4357.pdf
Documents similaires







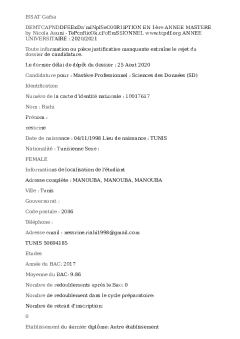


-
22
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 02, 2023
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2304MB


