'Gobert) de I'Acadkde 'fian qaiie pour l'ensemble I e son cieuwe. I S B N : 2-8
'Gobert) de I'Acadkde 'fian qaiie pour l'ensemble I e son cieuwe. I S B N : 2-84597-QS7-7 . ' Diffusion Le Seuil L'homme dans 'le paysage Dans la même collection Georges Duby, An 1000 an 2000, sur les traces de nos peurs, 1995 Michelle Perrot, Femmes publiques, 1997 Roger Chartier, Le Livre en révolutions, 1997 Jacques Le Goff, Pour l'amour des villes, 1997 Serge Berstein, La République sur le 3 1 , 1998 Denis Bruna, Piercing, sur les traces d'une infamie médiévale, 2001 O Les éditions Textuel, 2001 48 rue Vivienne 75002 Paris ISBN : 2-84597-027-7 Dépôt légal : septembre 2001 dans I L'homme ie paysage Alain Corbin Entretien avec Jean Lebrun L'homme dans le paysage 1 sommaire 7 Comment l'espace devient paysage 55 Le paysage sous influences 99 Pratiques d'espace 129 Paysage et météores 147 L'homme et la préservation du paysage 183 Notes 187 Table des illustrations Comment l'espace devient Comment l'espace devient paysage Le paysage est façon d'éprouver et d'appré- cier l'espace. Or, cette lecture, qui varie selon les individus et les groupes, ne cesse de se modifier au fil du temps. Il faut donc prendre conscience de cette historicité quand on aborde le sujet. Ainsi, la manière de regarder s'est profondément transformée depuis la Renaissance. La notion de panorama, comme la mécanique du regard qui conditionne l'ad- miration suscitée par le jardin anglais, appartient à l'histoire. Mais le paysage ne se réduit pas à un spectacle. Le toucher, l'odo- rat, l'ouïe surtout, sont aussi concernés par la saisie de l'espace. Tous les sens contribuent à construire les émotions que celui-ci procure. 1 Comment i'espace devient paysage Commençons par définir le paysage. Il convient, en effet, de préciser ce dont nous allons par- ler, tant la notion de paysage est floue. Les géographes, quand ils l'évoquent, décrivent ce qui s'impose avec le plus d'évidence ; c'est-à-dire ce qui ressortit à la morphologie et à l'écologie. Pour eux, l'histoire des paysages est celle de la manière dont ils se sont formés et dont ils ont évo- lué, selon la tectonique, le modelé, l'évolution des milieux naturels, celle de la flore et de la faune, les systèmes de production et d'échange ainsi que, plus généralement, selon les modes d'intervention de l'homme. Il existe toute une bibliothèque consacrée aux paysages conçus selon cette acception. La fascination exercée sur les géographes par la photographie aérienne a traduit le triomphalisme d'une science avide d'objectivité. Longtemps a dominé cette notion de paysage défini par sa matérialité, puis la réflexion s'est compliquée grâce à l'intervention des phi- losophes, des sociologues, des anthropologues1. Le paysage est manière de lire et d'analyser l'espace, de se le représenter, au besoin en dehors de la saisie sen- sorielle, de le schématiser afin de l'offrir à l'appréciation esthétique, de le charger de signfications et d'émotions. En bref, le paysage est une lecture, indissociable de la personne qui contemple l'espace considéré. Évacuons donc, ici, la notion d'objectivité. L'homme dans le paysage Lappréciation individuelle peut se référer à une lecture collective. Toute société a besoin de s'adapter au monde qui l'entoure. Pour ce faire, il lui faut continuellement fabriquer des représentations du milieu au sein duquel elle vit. Ces représentations collectives permettent de maîtriser l'environnement, de l'ordonner, de le peupler de symboles de soi, d'en faire le lieu de son bonheur, de sa prospérité et de sa sécurité. Il faut, en outre, tenir compte de l'irruption de l'autre : soldat, marchand, savant, agent du pouvoir central ou simple voyageur, qui intervient avec ses propres systèmes d'images, qui élabore de nouveaux paysages, de nouvelles figures de l'aventure spatiale suggérées par de multiples quêtes. Il anive que ces diverses lectures entrent en connit. C'est ce que Catherine Bertho2 assure à propose des pay- sages de la Bretagne au cours de la première moitié du XIX~ siècle : Lamartine, Michelet et bien d'autres voyageurs parisiens partis à la découverte de la province imposent alors leur lecture de l'espace. Puis certains membres des élites bretonnes, regroupés autour de La Villemarqué, s'ef- forcent de produire une contre-image de leur province. Alors que celle de Michelet était noire, fondée sur un accord supposé entre l'Armorique des tempêtes et le carac- tère d'individus violents perçus comme des transparents révélateurs du fond des âges, La Villemaqué et son entou- 1 Comment i'espace devient paysage rage ont dessiné de la Bretagne intérieure une image arca- dienne inspirée des poètes, notamment de Brizeux. Pour revenir à notre définition, le paysage est donc une lecture ou, le plus souvent, un entrelacs de lectures dont la diver- sité peut susciter le conflit. Mais les géographes disaient déjà qu'il n'existe pas de paysages naturels et qu'il n ' y a que des paysages culturels ... Ils ont reconnu, bien entendu, les traces de l'interven- tion humaine, surtout dans la perspective de la géogra- phie française sur laquelle Vidal de la Blache a imprimé sa marque. Mais les géographes, avant une date récente, n'avaient pas souligné l'historicité des gnlles de lecture. Or, nous y reviendrons, les systèmes d'appréciation, constitutifs du paysage, sont en permanente évolution. Un espace considéré comme beau à un certain moment peut paraître laid à tel autre. Vous recommandez donc l'appréhension de l'espace par la géographie, l'histoire, l'esthétique, la philosophie. Je suis, en effet, persuadé que la multiplicité des recours est nécessaire à toute histoire du paysage. Si celui-ci est une lecture de l'espace, se pose le problème de sa mort éventuelle. Il peut subsister dans sa matérialité mais dis- paraître parce que personne ne l'apprécie plus et donc L'homme dans le paysage ne le contemple plus.. . Il s'agit là d'un problème essen- tiel, que nous retrouverons à propos de la conservation. On comprend donc mieux l'objet de ces entretiens: si les manières d'apprécier l'espace évoluent, celui que tente d'élaborer une histoire des paysages est obligé de pratiquer l'immersion successive. Il lui faut, en préalable, tenter de retrouver le système d'appréciation tel qu'il s'imposait à telle époque, face à un même espace, indé- pendamment des modifications apportées à l'aspect de celui-ci. Considérons, par exemple, la pointe du Raz. Elle n'a certainement pas été profondément transformée dans sa morphologie. Cependant, il existe une histoire du pay- sage de la pointe du Raz. Au début du X I X ~ siècle, celle- ci subit l'influence d'un système d'appréciation produit en Écosse, à propos des Hébrides et de la grotte de Fingal, aisément transposé en France du fait de la relative sirni- litude des formes. Ce que vous recommandez est donc une méthode expérimentale. Il s'agit de se mettre dans une situation d'excursion - vous dites d'immersion ? François Ellenberger3 a relaté des expériences très inté- ressantes menées avec des étudiants. Il les a invités à regarder le même paysage à divers moments de la jour- née, selon des codes qui correspondaient à des siècles 1 Comment I'espace devient paysage différents. On pourrait très bien se livrer à ce jeu en haut du mont Ventoux. Je choisis cet exemple puisque l'on considère bien souvent que l'ascension effectuée par Pétrarque à son sommet constitue l'un des événements fondateurs de l'histoire des paysages. On sait bien ce qu'est une excursion de géographe, qui s'en va observer, dans le paysage, la stratification géologique, chercher des traces de l'homme, enregistrer les noms de lieux, etc. Mais qu'est-ce que l'excursion d'un historien du paysage ? Pour me faire comprendre, je choisirai l'exemple de ce que j'ai pratiqué: cela consiste à se rendre sur le bord de la mer, là où abondent les rochers, les éboulis, les blocs erratiques, et à essayer de reconstituer le ou les regards des hommes de la fin du XVIII~ siècle. Ce que la quasi- totalité des individus de ce temps pouvait contempler en un tel endroit constituait, à leurs yeux, des restes du déluge. Au lendemain de cette catastrophe, la terre avait été, pensaient-ils, complètement bouleversée. Les grands rochers qu'ils percevaient étaient demeurés en place lorsque les eaux s'étaient retirées. Mais, à la même date, certains savants, tel Giraud-Soulavie, partisans des modi- fications graduelles de la morphologie, pensant que l'unité de mesure n'était pas le millier mais le million d'années, pouvaient déjà lire ce même espace comme L'homme dans le paysage le résultat de l'érosion. La modification est fondamen- tale. Nous sommes tous, depuis l'enfance, assurés du tra- vail de l'érosion et nous regardons l'espace en fonction de cette conviction scientsque. De ce fait, nous ne voyons pas la même chose que des individus qui vivaient il y a deux ou trois cents ans. Le même espace ne nous inspire plus les mêmes méditations et ne nous suggère plus le même type de contemplation. Que peut-on faire, quand on escalade le Ventoux, pour épouser le regard de Pétrarque ? Cela nécessite, évidemment, une connaissance de l'œuvre de Pétrarque, du système de représentations du monde qui était le sien et de ceux qui l'entouraient. Il s'agit là, j'en ai bien conscience, d'un travail considérable, mais c'est la seule façon d'éviter l'anachronisme psychologique. On s'imagine trop souvent que, depuis deux ou trois siècles, les voyageurs ou les uploads/Geographie/ histoire-corbin-alain-l-x27-homme-dans-le-paysage-textuel-2002.pdf
Documents similaires

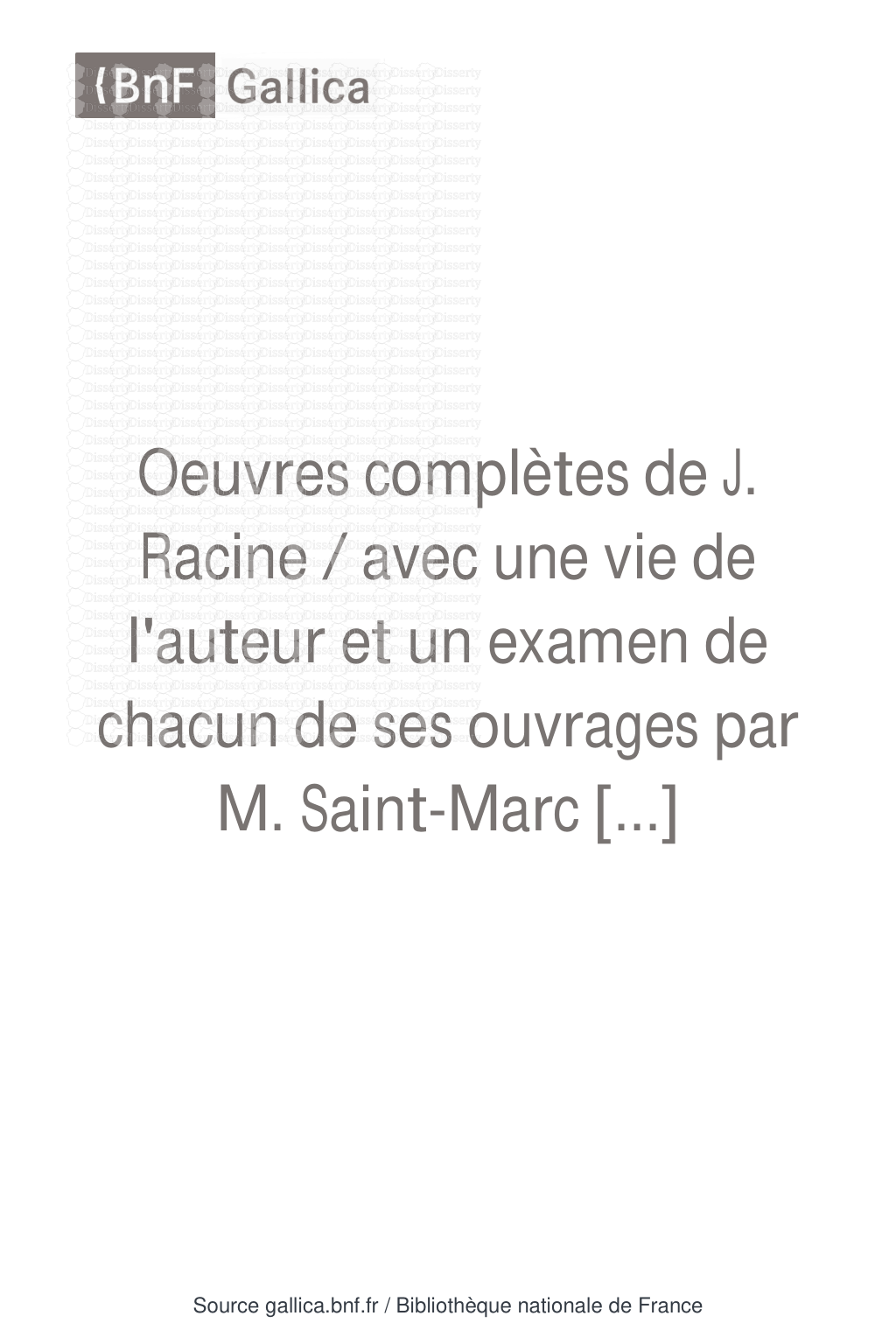








-
73
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 25, 2021
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 7.7871MB


