Journée Mondiale de l’Habitat 2010 Université d’ANTANANARIVO, le 4 octobre 2010
Journée Mondiale de l’Habitat 2010 Université d’ANTANANARIVO, le 4 octobre 2010 1 PENSER, GERER, AIDER LA VILLE A MADAGASCAR: UNE TRIPLE FAILLITE UNE TENTATIVE DE REPONSE : LE PROGRAMME D’AMELIORATION DE LA MOBILITE URBAINE D’ANTANANARIVO (PAMU) Jean-Jacques HELLUIN Directeur de l’Institut des Métiers de la Ville Commune Urbaine d’Antananarivo jj.helluin@yahoo.fr Mesdames, Messieurs, Chers étudiants, Je vais vous présenter le Programme d’Amélioration de la Mobilité Urbaine d’Antananarivo (PAMU). Il s’agit d’une initiative unique en son genre à Madagascar et remarquable en Afrique Sub-saharienne, et dont l’objectif est de démontrer qu’on peut réussir ici à avancer dans le sens du développement urbain durable. Mais d’abord, à la suite de la présentation d’ONU HABITAT, je veux dire quelques mots sur ce thème crucial qu’est le développement urbain malgache. En effet ce Programme d’Amélioration de la Mobilité Urbaine est une tentative audacieuse mais presque désespérée devant la situation. Aux nombreux étudiants qui sont ici, et que je félicite pour leur intérêt sur ce sujet, nous devons dire la vérité, toute la vérité, sous une forme claire. Il ne faut pas le cacher, le moment est grave. Madagascar est maintenant en pleine transition urbaine. D’environ 5 millions d’urbains aujourd’hui, ce nombre va passer à plus de 20 millions (la population totale actuelle) dans les 30 prochaines années. Qu’on le veuille ou non, comme tous les pays du monde, Madagascar va s’urbaniser, et ce sera à rythme rapide. L'agglomération d'Antananarivo, qui a aujourd'hui 2.5 millions d'habitants, gagne plus de 100 000 nouveaux habitants par an. Et cela va augmenter, encore une fois, qu’on le veuille ou non. Cette urbanisation peut et doit être une opportunité unique dans l’histoire du pays, et il n’y aura qu’une occasion – maintenant - pour la saisir. Tous les pays qui sont devenus riches depuis 50 ans l’ont fait en s’urbanisant. Quasiment toute leur croissance vient de l’industrie et des services, c'est-à-dire des villes[1]. Vous pouvez le vérifier facilement en regardant les données détaillées. L’enjeu essentiel de l’urbanisation de Madagascar est de faire des villes malgaches un moteur performant de l’économie, qui puisse tirer le développement de tout le reste, notamment du monde rural. Ce n’est pas le monde rural qui sortira ce pays de la misère. Je rappelle que la France, grande « puissance agricole », ne doit que 2% de son PIB et de son emploi à l’agriculture…En Chine, un paysan qui part travailler en ville multiplie en moyenne par 5 ou 6 sa productivité. A Antananarivo, la valeur ajoutée par habitant ou « productivité » est de 1.9 million d’Ariary / habitant, soit 2.6 fois supérieure à la moyenne des autres villes (0.7 million d’Ariary) et 3.8 fois la moyenne du milieu rural (0.5 Journée Mondiale de l’Habitat 2010 Université d’ANTANANARIVO, le 4 octobre 2010 2 million d’Ariary) [2]. On peut raconter tout ce que l’on veut, c’est cela la raison fondamentale de l’urbanisation : les économies d’échelle, la bien plus forte productivité et créativité des urbains[3]. Il faut y ajouter la fuite du mode de vie traditionnel de la brousse, dont de plus en plus d’êtres humains, notamment les femmes, ne veulent plus. Statistiquement, les migrants du rural vers l’urbain ont bien raison : même s’ils vont souvent grossir les effectifs d’un bidonville insalubre, à terme ils vont fortement améliorer leur niveau de vie, et si ce n’est pas pour eux ce sera pour leurs enfants. Un film qui est passé il y a quelques années ici au CCAC d’Antananarivo raconte un processus similaire : le gone du Chaâba[4], et rappelle qu’il y a encore peu de temps il y avait des bidonvilles en périphérie des grandes villes françaises. Il n’est pas impossible de passer son enfance dans un bidonville et de devenir chercheur, écrivain et ministre, comme l’auteur de l’ouvrage dont est tiré le film. La ville est capable d’offrir de nombreuses opportunités aux pauvres, impensables en brousse, à condition qu’on la laisse devenir une véritable ville. Les malgaches ne sont pas idiots, ils ont de bonnes raisons de migrer vers les villes, et ils savent bien mieux que l’Etat où est leur intérêt et celui de leurs enfants. Données Banque Mondiale, Traitement Gapminder (www.gapminder.org) Aujourd’hui Antananarivo produit 42% du PIB de tout le pays (étude INSTAT 2009 financée par l’IMV, 29 % selon le SNAT). Mais cette ville pourrait faire beaucoup plus pour le pays si elle n’était pas bridée dans sa productivité, actuelle et future, par la faiblesse flagrante des Les points de ce graphique représentent les pays du monde, avec une taille proportionnelle à leur population, en évolution entre 1960 et 2006. La corrélation entre urbanisation (en x) et PIB/Habitant (en y) est très forte. Madagascar est un des rares pays qui s’urbanise pour l’instant sans croissance économique (1), à l’opposé de trajectoires comme celles de la Corée du Sud ou du Brésil par exemple (2). 1 2 Journée Mondiale de l’Habitat 2010 Université d’ANTANANARIVO, le 4 octobre 2010 3 investissements dans les infrastructures de base. Juste un exemple : les deux seuls tunnels d’Antananarivo ont été construits en 1924 et 1938 ! Pourtant il y a grand besoin, et depuis longtemps, d’autres tunnels dont la rentabilité économique, sociale et environnementale serait énorme. Nous sommes en 2010, et il n’a toujours pas été possible d’en financer un. Même chose avec le train urbain. Un don de la Suisse a permis à la Commune, il y a quelques années, de se doter de locomotives et de rames de train. Mais les coûts de l’adaptation du matériel roulant et de l’exploitation s’avèrent trop importants, et pourtant une emprise ferrée, datant de la colonisation, traverse une bonne partie de la ville. Le matériel stocké se dégrade petit à petit. Il en est de même en infrastructures routières. Chaque jour on peut constater à Antananarivo le coût extrême de l'absence de planification et d'investissement en infrastructures routières, d'immenses quartiers étant desservis par un unique et étroit chemin, surchargé, inondé, souvent aménagé par les habitants eux-mêmes. En fait la Commune Urbaine d’Antananarivo, avec un budget annuel d’environ 9 millions d’euros (soit environ 500 fois moins que celui d’une commune française de même population et sans intercommunalité) et 3000 agents à payer (4 fois moins d’agent par habitant qu’à Lyon par exemple), n’a quasiment aucune marge de manœuvre en investissement. Pour expliquer comment on en est arrivé là, afin d’essayer de dépasser ces blocages, il faut constater une faillite totale de la pensée et de l’action sur l’urbanisation à Madagascar : Tout d’abord il y a faillite des universitaires, des intellectuels et des experts du développement œuvrant à Madagascar pour comprendre et analyser ce qui est réellement en jeu, à sortir des modèles et du prêt à penser du développement et de l’aménagement du territoire du milieu du XXème siècle. Il n’existe toujours pas à Madagascar de formation spécifique à l’urbanisme, même si l’on découvre, ici ou là, quelques rares initiations, en géographie et architecture par exemple. En matière de recherche, inutile d’espérer trouver quelques publications significatives en économie urbaine ou sociologie urbaine par exemple. A titre d'illustration, jamais aucune communication traitant de Madagascar n'a été présentée, ou même soumise, aux Symposiums mondiaux de la recherche urbaine organisés régulièrement par la Banque Mondiale. On constate la quasi absence de spécialistes en questions urbaines, alors qu’on a des armées d’universitaires et spécialistes du rural et du développement agricole. Il faut dire que les (rares) étudiants qui ont eu l’audace de s’intéresser à l’urbain ont bien du mal à trouver du travail dans ce domaine, et se recyclent souvent dans le rural, où se trouve la demande des employeurs (ONGs, bailleurs…). L’IMV a lancé en 2010 un prix du meilleur mémoire universitaire sur la ville malgache, en prenant tous les mémoires soutenus pendant ces 10 dernières années. Il est sidérant de constater que, toutes disciplines confondues, il n’y a qu’une quinzaine de travaux qui sont recevables. Ce qui est grave également sur le plan de la pensée est qu’on trouve de nombreuses idées fausses sur la ville à Madagascar, qui ne sont pas débattues et encore moins combattues. Les Journée Mondiale de l’Habitat 2010 Université d’ANTANANARIVO, le 4 octobre 2010 4 politiques publiques n’ont pas le support intellectuel pour être correctement orientées. On a encore entendu, ce matin, ici à l’Université, au département de Géographie, deux de ces idées à la fois fausses et dangereuses: l’idée qu’il faudrait limiter ou empêcher les migrations du rural vers l’urbain, et l’idée de la « macrocéphalie » de Tana. Jamais aucun pays n’a réussi à empêcher ces migrations du rural vers l’urbain, même avec des régimes très autoritaires. Il suffit de regarder les exemples de l’Afrique du Sud, de la Chine, ou plus anciennement des colonies africaines ou des zones sous influence soviétique, pour s’en convaincre. Mais surtout ces migrations, que les idéologues qualifient "d'exode", sont fondamentalement positives puisqu’elles sont intimement liées au processus de développement lui-même. Il faut oser le dire, il serait absurde d’essayer de combattre ces migrations, et de toute manière les autorités malgaches n’auraient aucun moyen de le faire. Il uploads/Geographie/ la-triple-faillite.pdf
Documents similaires








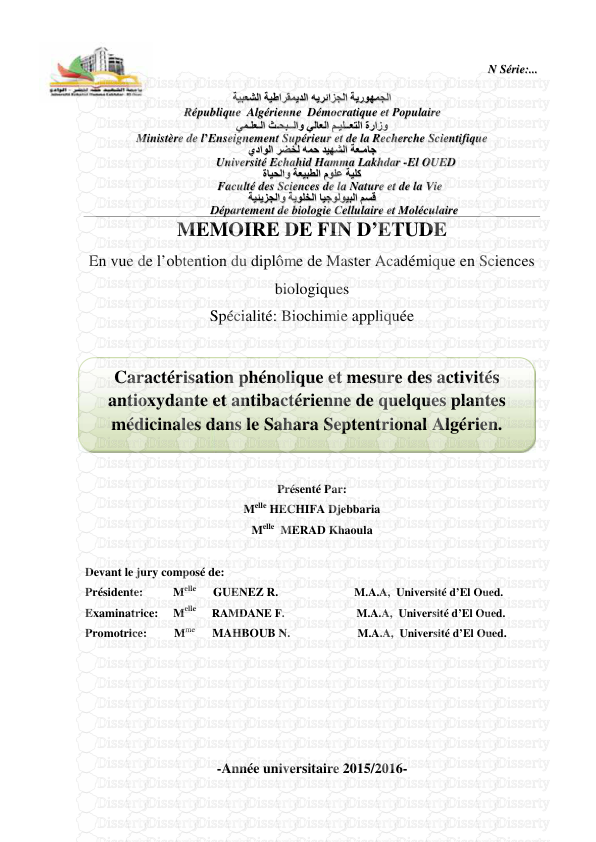

-
48
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 14, 2022
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2006MB


