28/12/2021 20:24 Le Maghreb dans les relations internationales - Du Maghreb des
28/12/2021 20:24 Le Maghreb dans les relations internationales - Du Maghreb des États-nations au Maghreb des régions - CNRS Éditions https://books.openedition.org/editionscnrs/22707 1/14 1 CNRS Éditions Le Maghreb dans les relations internationales | Khadija Mohsen-Finan Du Maghreb des États-nations au Maghreb des régions Benjamin Stora p. 19-29 Texte intégral Le Maghreb, espace et frontières Les pays du Maghreb semblent aujourd’hui enfermés dans des frontières nationales déterminées, figées par l’histoire ou la géographie. Le concept de « régions » n’arrive pas vraiment à s’enraciner dans les discours politiques de partis 28/12/2021 20:24 Le Maghreb dans les relations internationales - Du Maghreb des États-nations au Maghreb des régions - CNRS Éditions https://books.openedition.org/editionscnrs/22707 2/14 2 3 ou dans les sociétés civiles, se heurtant à la force des nationalismes centralisateurs. Cela n’a pas toujours été le cas, loin s’en faut. Le vaste espace de l’Afrique du Nord est certes un espace homogène, mais aussi un lieu d’expressions de sensibilités, et d’histoires régionales différentes. L’entité est bien délimitée par des frontières naturelles : au nord, la Méditerranée et l’Arc latin (quatorze kilomètres à peine séparent le Maghreb de l’Europe par le détroit de Gibraltar2) ; au sud, le Sahara ou la porte de l’Afrique noire, qui dessine les limites avec le Sénégal, le Mali, le Niger et le Tchad ; à l’est, les frontières naturelles apparaissent avec le désert égyptien et le Soudan ; et à l’ouest, avec l’océan Atlantique. On le sait, cette situation « d’enfermement » ou d’encerclement par des barrières naturelles difficilement franchissables a poussé les géographes arabes à qualifier le Maghreb de Jarizet el Maghrib : l’île du Maghreb. À l’intérieur de ce vaste espace, des entités régionales existent bien, pourtant, avec leurs langages, habitudes, coutumes religieuses ou rites culinaires. Lorsque l’on évoque le Rif, les Aurès, ou la Kabylie, c’est bien de régions singulières qu’il s’agit, avec leurs personnages emblématiques : l’Émir Abdelkrim dans le Rif, la figure de Mostéfa Ben Boulaid dans les Aurès pendant la guerre d’indépendance contre la France, ou Amirouche en Kabylie... Pour l’Europe, et principalement la France, le Maghreb évoque essentiellement l’Afrique du Nord, et se compose de trois pays anciennement colonisés : l’Algérie, le Maroc et la Tunisie. Le système colonial avait bien tenté, à plusieurs reprises, d’instrumentaliser le sentiment régional pour asseoir sa domination en empêchant des réunifications dangereuses pour sa présence. Mais, de la « politique kabyle » en Algérie au « Dahir berbère » au Maroc, cette politique n’a jamais réussi à favoriser un réel basculement des sociétés vers l’acceptation de la présence coloniale française. Bien au contraire. Au xxe siècle, le nom « Maghreb » a été imposé dans le vocabulaire géopolitique par les mouvements nationalistes, très influencés par l’idéologie du nationalisme arabe, se méfiant de la 28/12/2021 20:24 Le Maghreb dans les relations internationales - Du Maghreb des États-nations au Maghreb des régions - CNRS Éditions https://books.openedition.org/editionscnrs/22707 3/14 4 5idéeunitaire désignation des origines berbères de la région3. Les nationalismes ont rejeté dans l’ombre les appartenances régionales, sans toutefois les faire disparaître. Pourtant, on a vu par exemple avec quelle force, en avril 1980, vingt ans après l’indépendance de l’Algérie, « le printemps berbère » en Kabylie a bousculé l’ensemble du système étatique algérien, très centralisé. Quels sont aujourd’hui les pays qui composent cette région ? Le « Maghreb » désigne les territoires de cinq États : Algérie, Libye, Tunisie, Maroc et Mauritanie. Ces États forment le « Grand Maghreb », concept politique revendiqué par les Maghrébins lorsqu’ils affirment leur spécificité face au Machrek, l’Orient arabe4. Pourtant, le débat est loin d’être clos lorsqu’il s’agit de délimiter l’espace politique, et pas simplement géographique, maghrébin. S’il est certain qu’il est composé du Maroc, de l’Algérie et de la Tunisie (Maghreb central), on peut se demander si la Libye et la Mauritanie en font partie. L’adage local selon lequel le Maghreb commence « là où se mange le couscous et se porte le burnous » (selon le mot attribué au grand savant Ibn Khaldoun) n’est pas d’un grand secours scientifique ou historique. Une chose est sûre : aucun des trois pays centraux ne possède de frontières naturelles. Celles qui prévalent actuellement, et dont certaines sont contestées – notamment par le Maroc pour ce qui est de sa frontière avec l’Algérie –, sont l’œuvre des présences étrangères (turque, française) sur la terre maghrébine. L’histoire sur la longue durée nous dit ainsi que l’espace maghrébin formé et découpé par ses frontières actuelles est une construction récente, datant du xxe siècle5. Constitué d’une addition d’États-nations apparus au lendemain des indépendances, le Maghreb a-t-il réussi à préserver son espace de circulation et ses appartenances régionales ? à construire une unité politique lui permettant de sortir de son isolement, entre d’un côté la barrière saharienne, derrière laquelle s’étend un continent africain qui ne parvient décidément pas à s’arracher au sous- développement, et de l’autre les miradors édifiés par l’Europe ? 28/12/2021 20:24 Le Maghreb dans les relations internationales - Du Maghreb des États-nations au Maghreb des régions - CNRS Éditions https://books.openedition.org/editionscnrs/22707 4/14 6 7 L’idée unitaire L’Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie n’ont pas de marché commun, et pas le plus petit début d’intégration économique. Ils apparaissent très différents les uns des autres. Ils ont certes, par exemple, signé la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, mais ils ne tolèrent guère la contestation. « La situation n’est pas très florissante », constate Bruno Callies de Salies, auteur d’un essai sur les cinq États, qui relève « assez peu de points communs6 » entre eux. Et pourtant… Depuis longtemps, l’unité de toute l’Afrique du Nord est un rêve que caressent les populations, les sociétés de cette région particulière de la Méditerranée. Le point commun à tous les pays reste avant tout l’islam. De rite malékite, il constitue la religion de 95 % de la population et l’on prie à Casablanca de la même manière qu’à Tunis ou Alger, sans d’ailleurs connaître les mêmes divisions ou schismes qu’en Orient. Ensuite, la langue arabe agit comme un outil unificateur, même s’il existe au Maroc et en Algérie de fortes minorités berbérophones (mais n’est-ce pas là aussi un point commun ?). Cette langue parlée, cet arabe dialectal est aisément compris d’un pays à l’autre, malgré les nuances et les subtilités. Autre point commun : la langue française, très répandue dans les trois pays centraux, sans oublier la Mauritanie. Les pays d’Afrique du Nord partagent aussi un héritage de durs combats pour l’indépendance, émaillés d’une série d’actes de solidarité et de partage, comme le soutien des Marocains et des Tunisiens à l’Algérie en armes. La présence coloniale française, très longue en Algérie (près d’un siècle et demi, de 1830 à 1962), plus courte au Maroc (près d’une cinquantaine d’années, de 1912 à 1956), a pesé, on le sait, dans la délimitation de l’espace national de ces deux pays, qui sont les principaux du Maghreb. Le tracé des frontières, voulu par le colonisateur, a freiné la circulation des populations et des biens dans cet espace pourtant fluide. De ce fait, les revendications territoriales ont joué très vite, dès l’accession aux indépendances, un rôle décisif dans 28/12/2021 20:24 Le Maghreb dans les relations internationales - Du Maghreb des États-nations au Maghreb des régions - CNRS Éditions https://books.openedition.org/editionscnrs/22707 5/14 8 9 D’autres traits communs l’affirmation identitaire nationale et l’animosité entre le Maroc et l’Algérie, alors que rien, historiquement, ne laissait prévoir une telle opposition. En effet, différentes générations politiques se sont succédé au Maghreb tout au long du xxe siècle ; elles se connaissaient et ont combattu contre le colonialisme, côte à côte. Il suffit de mentionner la profonde solidarité algérienne avec les insurgés du Rif dans les années 1920, la création de l’Étoile nord-africaine qui demande dès 1926 l’indépendance des trois pays d’Afrique du Nord, la création au Caire, en 1948, du Comité de libération du Maghreb arabe, présidé par Abdelkrim El Khattabi, ou la Conférence de Tanger en avril 1958, réunissant l’Istiqlal marocain, le Front de libération nationale (FLN) algérien et le Néo-Destour tunisien. Des liens personnels très forts se sont créés entre tous les dirigeants de ces partis nationalistes. Une jeunesse nombreuse, souvent sans emploi, est aussi à compter parmi les ressemblances. Le chauvinisme, exacerbation d’un nationalisme sourcilleux qui a conduit les trois pays à l’indépendance, caractérise aussi les habitants du Maghreb, qu’il s’agisse des couches populaires ou, peut- être plus encore, des élites. Enfin, et c’est peut-être le plus important, les Maghrébins partagent dans leur ensemble les mêmes interrogations quant à leur identité, le même désir de modernité, et ils ont une même aspiration générale au mieux-être qui peut parfois nourrir les extrémismes, notamment islamistes, les plus violents. L’idée unitaire au Maghreb est donc ancienne, et enracinée dans la pensée collective des sociétés. Les Maghrébins ont longtemps envisagé cette unité comme une entente mutuelle et une forte solidarité pour agir contre les puissances extérieures qui ont envahi leurs contrées. L’origine d’une telle idée, dominante et vivace, tient simplement au fait que ces sociétés ont plusieurs points uploads/Geographie/ le-maghreb-dans-les-relations-internationales-du-maghreb-des-etats-nations-au-maghreb-des-regions-cnrs-editions1.pdf
Documents similaires
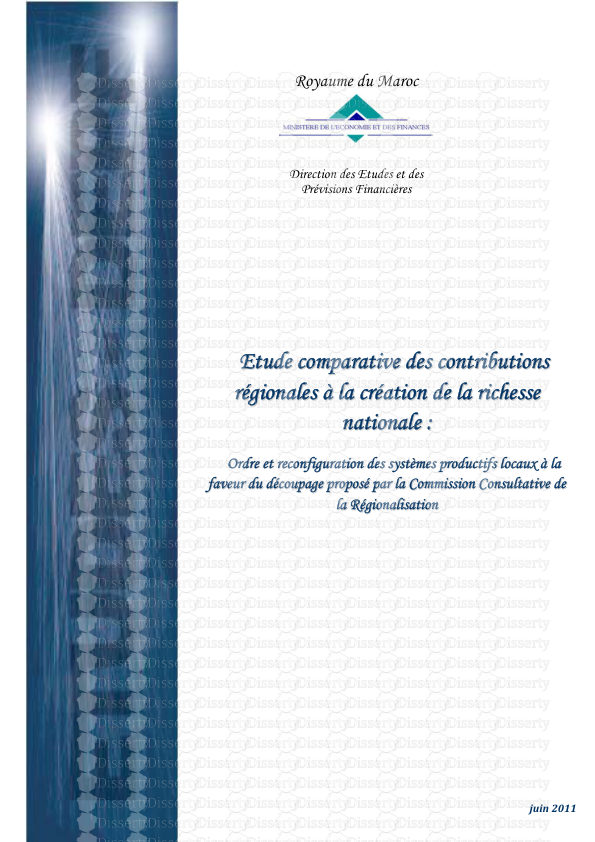









-
62
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 27, 2022
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 0.3184MB


