Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Universit
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université Ziane Achour –Djelfa Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie Département d’aménagement Spécialité Aménagement Thème Réaliser par : professeur : Chaiche Aymen Dr. Laid Kamel Slimani Tarek Année universitaire: 2019/2020 Utilisation des SIG dans le domaine de : Gestion des risques 1 La composante Sciences de l’information géographique et risques naturels du module « Risques » a, pour objectif, de donner un cadre théorique, conceptuel et méthodologique pour l’utilisation de la géomatique et, plus particulièrement, des systèmes d’informations géographiques (SIG) pour l’analyse des risques naturels et environnementaux en s’appuyant sur un large champ d’exemples et d’applications. Cet enseignement aborde les dimensions multi scalaires, à la fois, globales et particulières de la complexité des processus territoriaux et environnementaux que permet d’embrasser la géomatique au travers du lien SIG – territoire – risques – modélisation, tout autant que les limites de telles démarches. Introduction : sciences de l’information géographique, géomatique et systèmes d’informations géographiques Bien qu’en apparence sémantiquement similaires, les termes Sciences de l’information géographique (SIGs), géomatique et systèmes d’informations géographiques (SIG) regroupent des disciplines et des champs d’applications différents qui ont en commun la production, le traitement et la figuration de l’information géographique (IG). En d’autres termes, les sciences de l’information géographique, la géomatique, les systèmes d’informations géographiques désignent des objets, des disciplines, des champs d’études et d’applications différents ayant comme objets et/ou dénominateurs communs l’information géographique que ce soient sa production, sa génération à partir de bases de données géographiques et spatiales ou d’images de télédétection, son traitement, ses figurations et ses représentations. Bien que leurs champs disciplinaires se recoupent dans une large mesure sur de nombreux aspects (information géographique, logiciels, etc.), SIGs, géomatique et SIG se définissent et se différencient par rapport à leurs champs d’études, d’utilisations et d’applications : production de données et d’informations spatiales et géographiques, structuration et traitement de l’information, analyse et gestion des risques, modélisation des processus géographiques, identification des dynamiques et des structures territoriales. Les Sciences de l’information géographique, terme générique, rassemble les disciplines ayant attrait aux méthodes et outils produisant, traitant et représentant spatialement et temporellement les données et informations géographiques : télédétections spatiales et aéroportées, photogrammétrie, photo-interprétation, géodésie, SIG, simulation spatiale, cartographie. Les SIGs, comme méthodes et outils de production spatio-temporelle de données géographiques constituent en géographie et en géologie, pour l’essentiel, une des bases informationnelles de l’analyse des risques naturels de par la nécessité de prendre en compte l’espace géographique, le territoire, de spatialiser et de géographier les aléas. Cependant, si le fait de disposer de bases de données géographiques et de méthodes permettant de mesurer, décrire et représenter un ou plusieurs aspects d’un territoire ou d’une portion de l’espace géographique, l’analyse des risques, l’étude des structures, des dynamiques et des processus territoriaux soumis ou liés aux risques se font à partir des outils de traitement de l’information et des modèles géographiques qui sont formalisés grâce aux démarches et méthodologies de la géographie –informatique (géomatique) et implémentés dans des systèmes de stockage, de structuration, de traitement, de modélisation et de représentation de l’information géographique, les SIG. Terme inventé dans les années 1960 par Bernard Dubuisson, la géomatique a pour objets la mesure, l’analyse, la modélisation et la représentation des structures, processus, dynamiques géographiques physiques et humains à la surface de la Terre. Elle utilise, pour ce faire, la télédétection spatiale et aéroportée, les SIG, les bases de données, la géostatistique, l’analyse et la modélisation spatiale, la géovisualisation et la cartographie pour étudier les structures, phénomènes et processus géographiques, souvent complexes et en interactions les uns aux autres. L’emploi de systèmes d’analyses de l’espace géographie et de sa complexité associés au terme, système d’information géographique, permet dans la plupart des cas « d’éclater la 2 complexité d’un phénomène en autant de couches descriptives thématiques et spatiales, de combiner ces couches pour en extraire des informations nouvelles, plus synthétiques et de leur appliquer des requêtes et des traitements d’analyse spatiale de façon interactive » (Prospeck-Zimmermann, 2003). Les SIG constituent, avec la télédétection et la modélisation spatiale, l’un des outils de la géomatique (géographie informatique) pour l’étude des risques naturels et industriels. Pertinence de la géomatique Géomatique, gestion et suivi du risque La pertinence de la géomatique comme moyen et outil intégrateur et générateur de prévention, d’alerte, de suivi, de modélisation des impacts et des conséquences humaines et matérielles d’un évènement naturel ou industriel, qu’il s’agisse d’un séisme, d’une inondation ou encore d’un glissement de terrain, peut-être analysée dans le cadre des systèmes d’alerte précoce (early warning systems), de la modélisation de l’évolution des territoires et de la constitution de bases de données géographiques en rendant compte du suivi des évènements météorologiques en temps quasi réel, de l’information géographique mise à disposition aux populations et à l’évaluation spatialisée des biens et des personnes atteints. La diversité des approches avec la géomatique comme outil informationnel ou comme démarche spatiale et géographique de prévention et d’analyse des conséquences des catastrophes naturelles rend, à la fois compte, de la multiplicité des risques naturels et industriels auxquels populations et territoires sont assujettis et de la complexité de leurs modélisations. Elle traduit différentes phases de l’analyse, de l’évaluation et de la modélisation des impacts et de leurs conséquences, phases dans lesquelles les outils géomatiques forment le noyau des systèmes de prévention, d’alerte, de suivi et de spatialisation des zones pouvant être affectées et des dégâts. Elle concerne la prévention d’évènements climatiques ou météorologiques, sismiques ou géomorphologiques comme facteurs déclenchant d’une catastrophe naturelle. Elle fait généralement appel aux données de télédétections spatiales météorologiques optiques et radar qui sont corrélées aux stations de mesures au sol et à des modèles prévisionnels mais, également, aux systèmes d’informations géographiques (SIG) avec la préparation de bases de données géographiques et de leur mise à jour (en fonction du niveau et de la vitesse de transformation des territoires) sur des zones identifiées comme présentant un risque potentiel majeur. Le suivi de l’évènement naturel, météo climatique, sismique, géomorphologique ou des conséquences d’un accident industriel sur les populations et l’environnement, tout comme la cartographie de l’intensité et de l’étendue des conséquences et des dégâts, font également appel à la télédétection spatiale et aéroportée, aux SIG et à la modélisation spatiale. Disparité des systèmes d’informations géographiques pour l’analyse et la prévention des risques Les systèmes participant à la prévention des risques naturels pouvant affecter les territoires et les populations et utilisant les outils et les méthodologies d’analyses géomatiques concernent et comprennent : les cartographies des plans de prévention des risques (PPR) et des plans d’évaluation des risques (PER) dans lesquels sont figurés le zonage des portions de territoire soumises à un risque naturel majeur indiquant le niveau de vulnérabilité et leurs 3 étendues possibles. Il pose le problème de la cartographie de l’aléa et l’incertitude sur les tracés des limites des zones soumises aux risques industriels ou naturels. les modèles de simulations hydro géographiques, sismiques, géomorphologiques rendant compte de l’évolution d’un cours d’eau, des formes d’un relief et de ses conséquences possibles sur les populations et les infrastructures. Ces modèles, à la fois dynamiques et prédictifs, sont encore relativement peu utilisés pour la modélisation des risques et la cartographie de leurs étendues. Cependant, seuls quelques modèles hydrographiques et d’écoulement des avalanches sont utilisés pour simuler les étendues et les intensités possibles d’une crue, d’un mouvement de terrain ou d’une avalanche. les modèles simulant l’étendue d’un incident industriel sur l’environnement et les populations. Ils sont généralement basés sur la modélisation de l’étendue maximale d’une explosion d’un produit dangereux, elle-même corrélée aux conditions météorologiques locales (vent, hydrométrie, etc.) et combinée avec les bases de données géographiques d’occupation du sol pour évaluer les impacts sur les populations et l’environnement : nombre d’habitants touchés, lieux, dégâts, conséquences sur le milieu, etc. Ces modèles sont rattachés aux sites industriels classés Seveso. les systèmes de production de bases de données géographiques qui sont censés représenter l’occupation et l’utilisation du sol, les dynamiques de transformation des territoires courant un risque. Ces bases de données forment le socle informationnel des quatre autres systèmes d’informations géographiques qui sont ici décrits. Elles renseignent sur les portions de l’espace géographique, alimentent et affinent les modèles de simulation et contribuent à déterminer les zones de risques et à leur mise à jour. les satellites d’observation de la Terre, optiques ou radar, de type Landsat, Spot, IRS, Pléiade, Cartosat, etc., permettent de générer des bases de données géographiques et spatiales élémentaires sur les territoires à risques ou soumis aux aléas et aux risques : cartographie d’occupation du sol, paysages, visualisation 3D, etc. Les images satellites permettent également de produire de l’information géographique sur la nature, l’étendue et les conséquences d’un incident industriel, des évènements naturels pouvant toucher les populations et les territoires. La mobilisation rapide des systèmes d’observations spatiaux, l’étendue des zones couvertes par les images satellites, les fréquences de revisites sur les portions d’espaces touchées par une catastrophe naturelle ou industrielle en font une des pierres angulaires des systèmes d’informations uploads/Geographie/ sig-gestion-des-risques-pdf.pdf
Documents similaires






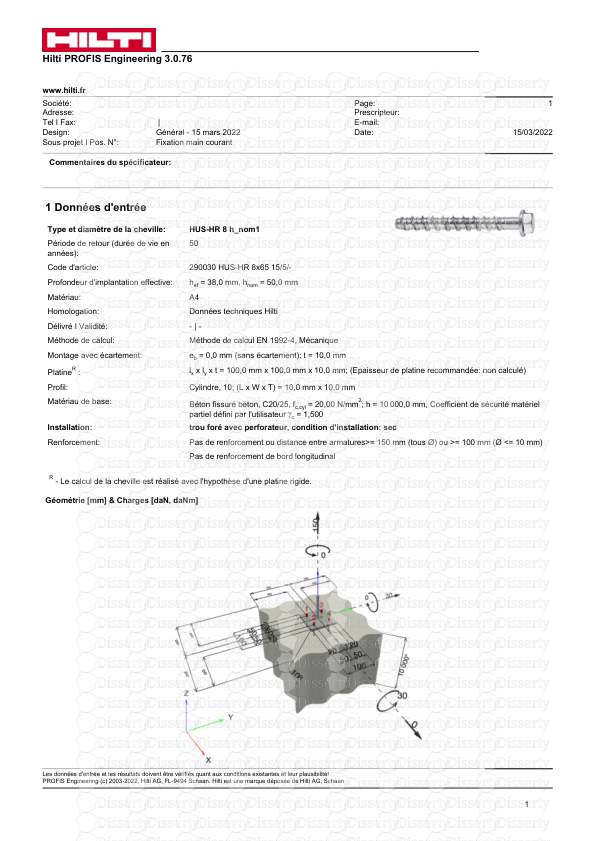



-
64
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 05, 2023
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1785MB


