TRAVAIL PERSONNEL QUOTIDIEN DE L’APPRENANT DANS LE CADRE DE L’ENSEIGNEMENT MUSI
TRAVAIL PERSONNEL QUOTIDIEN DE L’APPRENANT DANS LE CADRE DE L’ENSEIGNEMENT MUSICAL SPECIALISE ROLE ET PERSPECTIVES DU PROFESSEUR Florent AILLAUD Directeur de mémoire : M. Pascal TERRIEN Juin 2019 Formation au Certificat d’Aptitude de Professeur d’Enseignement Artistique (discipline guitare) — Promotion 2016-2019 C.N.S.M.D.P. 1 2 REMERCIEMENTS Avant toute chose, je souhaite remercier tout particulièrement mon Directeur de recherche, M. Pascal Terrien, pour sa patience, son exigence, ainsi que pour le temps précieux qu’il m’a accordé afin d’effectuer ce travail de recherche et élaborer ce mémoire. Les semestres de cours de Sciences de l’Education qu’il anime au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris ont été et sont toujours, en outre, une source de questionnements pour moi en tant qu’enseignant et ces cours ainsi que la littératie que nous avons étudiée ont été une motivation supplémentaire pour travailler sous sa direction. Je remercie également l’ensemble du corps enseignant de la Formation au Certificat d’Aptitude du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, qui ont nourri ma réflexion au sein des séminaires suivis pendant mon cursus. Je veux adresser aussi mes remerciements à Ambre et Eléanore, qui m’ont permis d’expérimenter les points que j’ai pu développer dans ce mémoire de recherche. Je tiens enfin à exprimer toute ma gratitude envers Margot, Léna, Amaury, Alain et mes parents, pour le soutien inconditionnel qu’ils m’ont toujours adressé. 3 4 SOMMAIRE REMERCIEMENTS INTRODUCTION p. 1 I — PARTIE THEORIQUE DEVOIRS DE L’APPRENANT, AUTONOMIE ET MOTIVATION p. 5 1. Devoirs p. 5 1.1 Devoirs de l’apprenant dans le cadre scolaire p. 6 1.2 « Devoirs » de l’apprenant dans le cadre de l’enseignement musical spécialisé p. 10 1.3 Discontinuités liées au travail personnel quotidien de l’apprenant p. 16 2. Autonomie p. 24 2.1 Considérations générales p. 24 2.2 Favoriser l’autonomie par l’évaluation p. 31 2.3 Perspectives méthodologiques p. 40 3. Motivation p. 45 3.1 Définitions p. 45 3.2 Présentation de deux théories de la motivation p. 47 3.3 Intérêt pédagogique pour l’enseignant en vue du travail personnel quotidien de l’apprenant p. 54 3.4 Synthèse de la première partie : l’autonomie et la motivation en question p. 60 II — PARTIE EXPERIMENTALE p. 61 4. Hypothèse et méthodologie p. 61 4.1 Hypothèse générale p. 61 4.2 Méthodologie générale p. 63 5. Description de l’expérimentation p. 64 5.1 Description du contexte général p. 64 5.2 Recueil des données p. 66 5 6. Collecte des résultats et analyse des données p. 67 6.1 Le cas d’Ambre p. 67 6.2 Le cas d’Eléanore p. 76 III — DISCUSSION p. 81 CONCLUSION p. 85 BIBLIOGRAPHIE p. 91 ANNEXES p. 101 TABLE DES MATIERES p. 121 6 INTRODUCTION L’effort de travail personnel effectué par l’apprenant est généralement compris dans le milieu éducatif — qu’il concerne une discipline scolaire, artistique ou même sportive — comme un facteur déterminant de réussite. Or, comme le note Olivier Rey (2018), l’enseignant ne dispose aujourd’hui que de peu de textes lui permettant d’appréhender des stratégies qui lui permettent d’y contribuer : L’examen de la littérature existante montre pourtant que ce sujet est finalement peu traité sous cette forme et, surtout, qu’il existe peu de travaux susceptibles d’éclairer et d’aider les acteurs éducatifs dans ce domaine. Certes, ce travail apparaît comme la finalité naturelle dès lors que l’on s’interroge sur les dispositifs pédagogiques, sur les processus didactiques ou sur le métier enseignant. Il n’en reste pas moins qu’il apparaît trop souvent comme une conséquence mécanique et finalement non problématique de la forme scolaire. (Rey, 2018) . 1 De la même manière, dans le cadre de l’enseignement musical spécialisé, une réflexion approfondie sur la nature et l’efficacité du travail instrumental effectué par l’apprenant à la maison et des questions que celui-ci soulève semble essentielle. Elle fait montre, aussi, d’une certaine complexité dans la mesure où, par définition, le professeur n’est pas présent physiquement pour accompagner la pratique musicale de l’élève en dehors des locaux du conservatoire ; s’il élabore effectivement une didactique du savoir musical qu’il met en oeuvre dans sa classe, l’efficacité du travail de l’élève réalisé à la maison dans le prolongement du cours peut lui échapper. A titre personnel, j’ai souvent remarqué en discutant avec des pairs, des élèves, ou encore en consultant leurs bulletins, que nombre d’enseignants préconisaient arbitrairement une durée de pratique instrumentale quotidienne à leurs élèves en fonction de leur avancement dans le cursus de l’établissement. Cet axiome, verbalisé et parfois également transcrit, paraît pourtant de ne pas prendre en compte tout un ensemble de paramètres importants, notamment l’appréhension de l’individualité de l’apprenti-musicien, sa motivation à l’instant t, ou encore ses disponibilités en dehors des autres activités scolaires et extra-scolaires auxquelles il s’adonne pendant la semaine. Gageons, cependant, que le URL : http://perso.ens-lyon.fr/olivier.rey/travail-personnel-de-leleve-et-devoirs/. Consulté le 23 1 septembre 2018. 1 caractère péremptoire — voire même moralisateur — de cette prescription d’une durée de travail peut non seulement être perçue par l’élève de manière violente s’il ne l’a, au bout du compte, pas respectée, mais qu’elle est aussi en mesure de mettre à mal la relation pédagogique et humaine entre l’enseignant et l’apprenant, dans la mesure où elle instaure un rapport de force inapproprié à la situation d’apprentissage, d’autant plus au sujet d’un élément que seul l’un des deux protagonistes peut véritablement contrôler. Il semble important d’ajouter, d’ailleurs, que la légitimité sociale des activités extra-scolaires — communément regroupées, par opposition aux disciplines scolaires, sous l’appellation de « loisirs » — représente, peut-être encore davantage dans le cas d’une discipline artistique comme la musique, la danse ou le théâtre, une singularité, dans la mesure où l’apprentissage d’un instrument de musique ne relève ni tout à fait du loisir, ni de l’apprentissage scolaire, duquel il paraît néanmoins plus proche, sous certains aspects : Parmi tous les apprentissages auxquels est soumis le collégien, un certain nombre d’entre eux se réalisent hors de l’école. Ils se caractérisent parfois par des situations éducatives s’appuyant sur la répétition, le respect des règles strictes inhérentes à ces apprentissages ainsi que des règles inhérentes à l’organisation de la situation d’apprentissage […] C’est le cas par exemple de la danse et de la musique classiques. […] Il y a donc une complexification et une diffusion de l’ordre scolaire et des modèles qu’il véhicule au-delà de l’école elle-même. C’est dans cet enchevêtrement que l’on peut en fait distinguer ce qui est de l’ordre des loisirs au sens premier du terme et ce qui est de l’ordre des activités se déroulant hors du temps de classe mais qui restent dans les limites des fonts baptismaux de l’école. Par ce biais, on aboutit à une distinction entre certaines pratiques à peine organisées et reposant véritablement sur une éthique du divertissement (Pais, 1993) et des pratiques qui, loin d’être désorganisées, sont porteuses d’une dimension de renforcement de l’ethos du travail scolaire. (Zaffran, 2001, p. 151). Par conséquent, soulignons que la pratique instrumentale effectuée en l’absence du professeur par l’élève-musicien souffre d’autant plus de son statut hybride, moins proche du « loisir » à proprement parler (qui par définition ne nécessite pas ou très peu d’effort de travail personnel lorsqu’il n’est pas pratiqué à un haut niveau) que de l’apprentissage scolaire, sans pour autant en avoir la même légitimité sociale. Cette notion semble d’ailleurs loin d’être anodine, car si l’apprenant ne perçoit pas la discipline musicale comme étant légitime, nous sommes en mesure de nous demander comment donner du sens, sinon de l’intérêt, à son travail quotidien. 2 Ainsi, nous émettons ici une première hypothèse selon laquelle le temps de pratique quotidienne de l’apprenant est loin d’être l’unique facteur permettant une progression efficace à moyen et long termes ; son degré d’autonomie, la manière de s’exercer ou encore l’intérêt qu’il porte à son travail semblent être, au moins de prime abord, tout aussi importants. La demande de travail dépassant largement le cadre de la classe, les rapports aux savoirs […] ne se bâtissent pas exclusivement au sein de l’établissement. Au rythme contraignant et collectif de l’école, s’oppose alors le caractère irrégulier et libre du travail à la maison. Le travail personnel s’inscrit ainsi entre deux espaces de temps et de lieu, nécessitant une organisation pour les élèves. Cette double localité du travail scolaire explique également le fait que l'essentiel du travail des élèves reste un domaine peu connu, notamment pour les enseignants. Cette méconnaissance fonde en partie le discours basé sur un supposé manque de travail. (Glasman et Besson, 2004, p. 30). Dans ce mémoire de recherche, je souhaite questionner, dans le cadre de l’enseignement musical spécialisé, la manière dont le professeur peut engager ses élèves dans une pratique quotidienne à la maison. Je fais l’hypothèse que les indicateurs du travail fait à la maison dans le cadre scolaire sont valables pour le travail de l’instrument. Il s’agira, dans une première partie qui tiendra lieu de cadre théorique à cette étude, de nous pencher sur des notions-clés auxquelles renvoie notre sujet. Parmi celles-ci, le travail personnel quotidien de l’apprenti-musicien apparaît comme un élément central : pour le définir, on prendra comme point de uploads/Geographie/ travail-personnel-quotidien-de-l-x27-apprenant-dans-le-cadre-de-l-x27-enseignement-musical-specialise-role-et-perspectives-du-professeur.pdf
Documents similaires









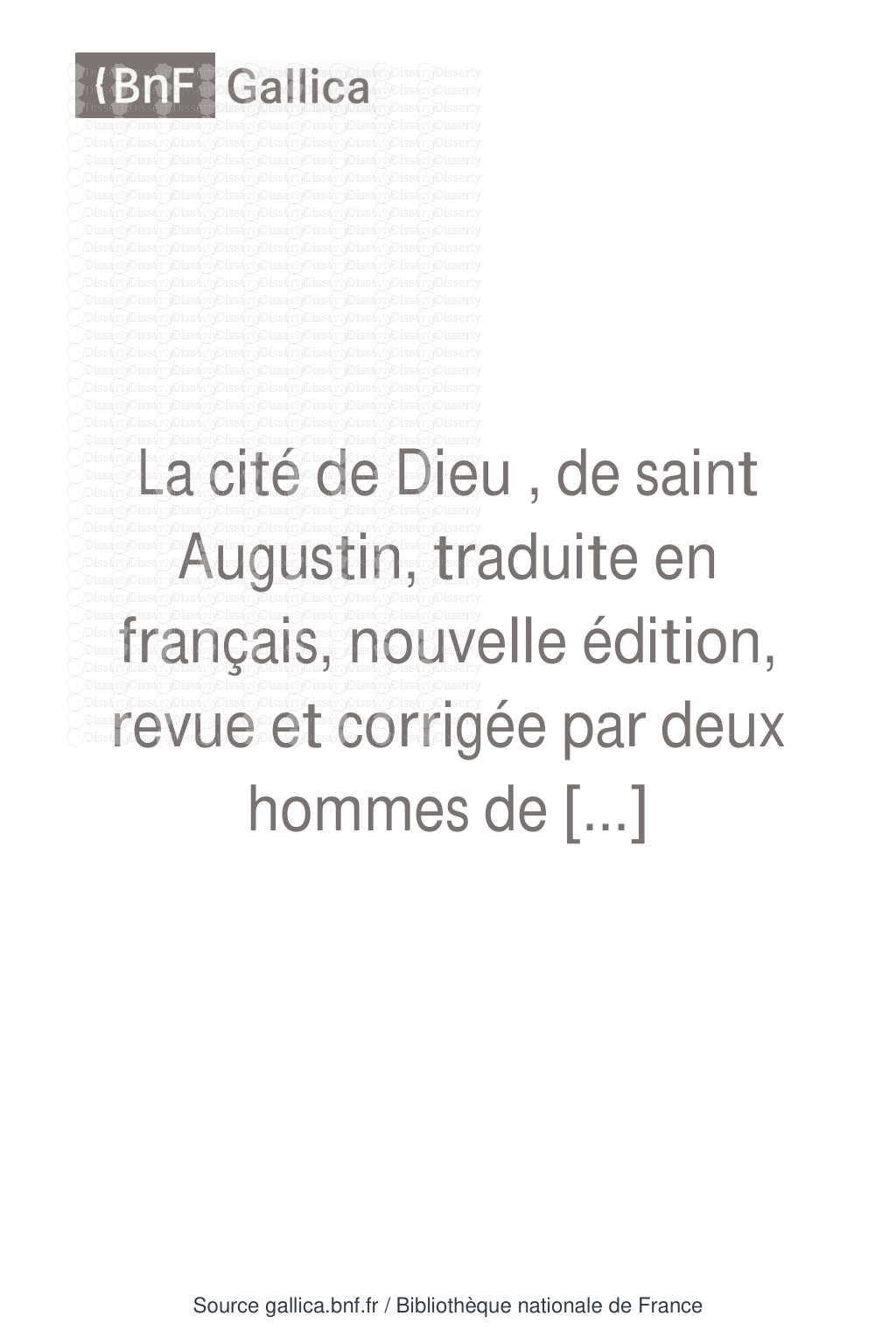
-
103
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 21, 2022
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 3.3523MB


