INFLUENCE DU CHAUFFAGE SUR LE FACTEUR ANTIBIOTIQUE PRÉSENT DANS LES MIELS M. GO
INFLUENCE DU CHAUFFAGE SUR LE FACTEUR ANTIBIOTIQUE PRÉSENT DANS LES MIELS M. GONNET P. LAVIE 5tatiom expérimentale d’Apiculture, Montfavet. I)epuis très longtemps les propriétés antiseptiques du miel sont connues et, au cours de l’histoire, l’homme s’est fréquemment servi de ce produit naturel soit pour conserver des d.enrées alimentaires durant l’hiver ou au cours des grands voyages sur mer, soit pour soigner diverses affections. Dans des temps plus anciens les homtnes se servaient du miel pour embaumer les cadavres. Le miel, qui devrait être pollué de germes innombrables, ne fermente pas habituellement cependant dans la ruche où la température (voisine de 34 0 en certains points), l’hygrométrie et l’obscurité sont autant de facteurs favorables au dé- veloppement bactérien et fongique. Des essais ultérieurs, au laboratoire, ont confirmé également ces constatations. Plus récemment des observa- tions ont montré que le nombre de germes trouvés dans le miel est toujou y s peu élevé. On ne rencontre en effet, en dehors des champignons et des levures, aucune bactérie sous sa forme végétative. Dès igo6, W HITE cons- tatait la stérilité du miel provenant d’une ruche saine. I,es spores de bac- téries présentes dans le miel (G ABBERT , 193 6) sont très souvent des germes banaux du type subtilis, plus rarement des diplocoques non pathogè- nes, mais l’on n’y trouve jamais d’entérobactériacées. Les propriétés antiputrides du miel connues empiriquement sont depuis une trentaine d’années vérifiées scientifiquement, principalement grâce aux travaux fort nombreux de l’Ecole allemande. C’est alors que l’on a rejeté l’hypothèse qui attribuait la stabilité du miel à la seule influence des sucres ou à l’acidité et que l’on a établi la présence d’un facteur antibiotique dans le miel, nommé par D OLD « l’inhibine ». Il semblait au premier examen que le sujet fut en partie épuisé, mais ayant repris la question depuis quelques années nous nous sommes aperçus qu’il n’en était rien et < l ue l’étude du facteur antibiotique du miel est complexe et se présente sous de multiples aspects. On peut envisager plusieurs directions de recherches importantes : origine du facteur anti- biotique, sa constance dans les différents miels, modes d’extraction et de fractionnement, influence des facteurs physiques externes, conservation lors du vieillissement du miel, influence du pH, action antagoniste d’un facteur de croissance. Nous avons entrepris des recherches sur l’ensemble de la question ( I ). les résultats obtenus dès à présent, à notre surprise ne cadrent pas avec ce qui semblait bien établi depuis de nombreuses années. Cette note ne traitera que d’un sujet unique, très important, à savoir : la thermostabilité dit facteur antibiotique dans les miels. A. - TRAVAUX ANTÉRIEURS. En ce qui concerne le facteur antibiotique des miels, les notions de t6aermostabilité et de photolabilité ont été mises en évidence par D OLD et reprises ensuite par de nombreux auteurs : D OLD ; Du et D ZIAO ; D OLD et K NAPP ; D OLD et WiTZENHAUSËN ; SC HUI ,B R . et V O GEI, ; FRANCO : FRANCO et SA R T OR I ; DU I SBD R G et GEB E LE I N ; VERGE ; P O T HMANN ; S C H ADE, MA R SH et F,CKE R 1’. Seuls I)oi!i), Du et D Z IA O donnent des tableaux précis et semblent avoir étudié d’une manière systématique la température et le temps de chauffage. I,es tableaux I et II indiquent quelques résultats obtenus par ces auteurs. D’après D OLD , Du et D ZIAO ( 193 8) voici la sensibilité de l’inhibine à l’élévation de température. Un chauffage de 30 minutes à 5 6 0 C. suffit à détruire l’inhibine. De même, Un chauffage d.e 10 minutes à 70 0 C. suffit à détruire d’inhibine, Un chauffage de 5 minutes à 8 0 °C. suffit à détruire l’inhibine, Un chauffage de 2 minutes à ioo c. conduit à une destruction au moins partielle de l’inhibine. Signalons encore que les auteurs ont mis en évidence l’inactivation de l’inhibine après exposition pendant i heure à la lumière solaire directe. D’après eux également, à l’obscurité et à la température ordinaire du labo- ratoire, la conservation de l’inhibine est très bonne ; mais déjà à 37 ’1 elle diminue de façon perceptible après 7 à 35 jours félonies souches éprouvées. lorsque le miel est dilué à 5 o p. 100 dans du sérum physiologique, l’in- hibine disparaît rapidement, en 24 à 144 heures à l’obscurité et à la la température ordinaire. Les épreuves sur les bactéries ont été réalisées dans la plupart des cas de la manière suivante : on mélangeait directement le miel à essayer à un milieu gélosé et on ensemençait sur boîtes de pétri. Un autre test a également servi pour le miel : le produit était exposé aux cond.itions naturelles de décomposition à l’air libre. Les auteurs pou- vaient alors montrer qu’un miel chauffé se défendait moins bien contre la décomposition qu’un miel frais. Cependant, il convient de faire très attention au fait que les auteurs allemands ont dilué le miel à 5 o p. 100 dans le sérum physiologique dans leurs expériences et c’est cette dilutioia qiii était chauffée et non le miel pur pour rechercher l’influence d’une élévation de température sur l’inhibine. Or ils admettent eux-mêmes qu’une destruction de l’inhibine à tempéra- ture ordinaire est très rapide si le miel est dilué dans le sérum physiolo- gique. Nous reviendrons d’ailleurs sur cette questions lors de l’exposé de nos travaux personnels. Les auteurs précités ont également montré que la présence d’inhibine n’est pas constante dans les ntiels et qu’elle peut même manquer totalement. Des épreuves témoins ont été effectuées avec du « miel artificiel u (mélange de glucose et de lévulose rappelant la composition d’un miel). Ce miel artificiel (cru ou chauffé même en con- centration de 2 6 p. 100 dans le milieu, n’est jamais inhibiteur pour le développement des bactéries. I,orsqu’en 195 6, nous avons repris quelques essais sur la valeur antibiotique du miel, nous avons été frappé très vivement par le fait que des extraits acétoniques de miel, mélaugés à un milieu de culture et autoclavés zl.! d’lae 2 rve à 120 , empêchaient le développement des brzc- téries ensemencées stzr ce milieu. Cependant, tous les travaux antérieurs mentionnaient une thermola- bilité de l’inhibiue. Nous avons travaillé pourtant au moins pour une part, avec les mêmes souches que les auteurs précédents, il convenait donc d’étudier cette question plus en détail. B. - TRAVAUX PERSONNELS. m Méthodes employées. Dans les premières séries d’expériences, nous nous servions de l’extrait acétonique de miel. Le miel était trituré, à froid dans un mortier, avec son volume d’acétone. L’opération était renouvelée par trois fois. La totalité de l’extrait obtenu était ensuite évaporé et repris par l’eau. Cet extrait en phase aqueuse était ajouté à un milieu de culture coulé en tubes par quantité de zoCm 3 . Ce milieu était composé de : I!au.............................. 1000 cm Peptone .......................... 10 g Getose............................ .&dquo; 25 9 L’ensemble était ensuite autoclavé (à 120 0 pendant 1/4 d’heure) ou non avant l’ensemencement et l’on notait les résultats après 12 H à l’étuve à 37 °C. Les différences obtenues étaient négligeables entre les extraits autoclavés et ceux qui ne l’étaient pas. Ces résultats portaient sur une trentaine de souches bactériennes répertoriées au tableau III. C’est alors que, d’autre part, nous avons trouvé que les extraits alcooliques de miel sont beaucoup plus actifs que les extraits acétoniques. La substance antibiotique du miel passe en effet presque en totalité dans l’alcool, tandis que l’acétone en laisse une certaine partie. Nous utilisons donc depuis plus de i an soit des extraits alcooliques de miel en Phase aqueuse, soit du miel pur. Pour mettre en évidence, la différence de la valeur antibiotique des miels crus ou chauffés nous avons employé dans ses grandes lignes la méthode de Dot,D et ’UITZENHAL!SEN : on verse stérilement dans des boîtes de Pétri le milieu gélosé (déjà décrit ci-dessus) additionné de miel, ou d’extrait alcoolique de miel (préalable- ment chauffé ou non). I,e mélange est calculé pour obtenir des concen- trations correspondant à 25 p. 100, 20 p. 100, z5 p. 100,10 p. 100 et p. 100 en miel dans le milieu. Les boîtes témoins reçoivent le miel ou l’extrait de miel tandis que les autres reçoivent des extraits ou des miels (suivant l’expérience) soumis à des élévations de température bien déterminées. Après refroidissement on ensemence en surface et l’on porte à l’étuve à 37°C. pendant 12 à 24 heures. L’examen après 12 ou 24 heures permet de noter les résultats et d’évaluer les différences d’action antibiotique entre les miels crus et les miels chauffés. Il est possible de noter l’activité, de la substance de o à 5 en se basant sur les données suivantes : Inhibition avec 5 p. 100 de miel dans le milieu note 5 Inhibition avec 10 p. 100 de miel dans le milieu note 4 Inhibition avec z 5 p. 100 de miel dans le milieu note 3 Inhibition avec uploads/Geographie/hal-00890141.pdf
Documents similaires







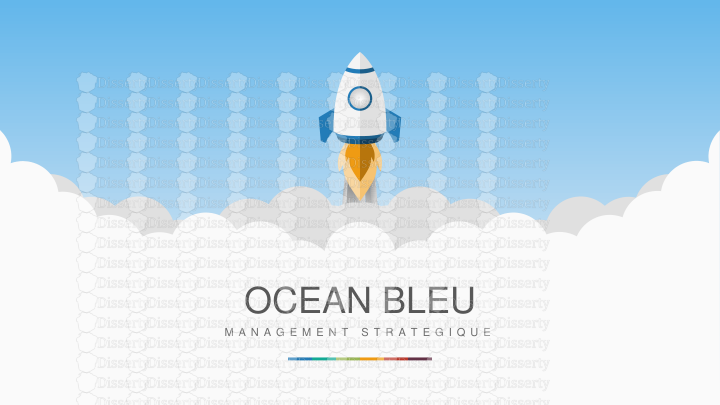


-
32
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 12, 2021
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 0.7842MB


