ENCYCLOPÉDIE BERBÈRE DIRECTEUR DE LA PUBLICATION GABRIEL CAMPS professeur émèri
ENCYCLOPÉDIE BERBÈRE DIRECTEUR DE LA PUBLICATION GABRIEL CAMPS professeur émèrite à l’Université de Provence L.A.P.M.O., Aix-en-Provence CONSEILLERS SCIENTIFIQUES G. CAMPS (Protohistoire et Histoire) H. CAMPS-FABRER (Préhistoire et Technologie) S. CHAKER (Linguistique) J. DESANGES (Histoire ancienne) O. DUTOUR (Anthropobiologie) M. GAST (Anthropologie) COMITÉ DE RÉDACTION M. ARKOUN (Islam) E. BERNUS (Touaregs) D. CHAMPAULT (Ethnologie) R. CHENORKIAN (Préhistoire) M. FANTAR (Punique) E. GELLNER (Sociétés marocaines) J.-M. LASSERE (Sociétés antiques) J. LECLANT (Égypte) T. LEWICKI (Moyen Age) K.G. PRASSE (Linguistique) L. SERRA (Linguistique) G. SOUVILLE (Préhistoire) P. TROUSSET (Antiquité romaine) M.-J. VIGUERA-MOLINS (Al Andalus) UNION INTERNATIONALE DES SCIENCES PRÉ- ET PROTOHISTORIQUES UNION INTERNATIONALE DES SCIENCES ANTHROPOLOGIQUES ET ETHNOLOGIQUES LABORATOIRE D’ANTHROPOLOGIE ET DE PRÉHISTOIRE DES PAYS DE LA MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE INSTITUT DE RECHERCHES ET D’ÉTUDES SUR LE MONDE ARABE ET MUSULMAN ENCYCLOPEDIE BERBÈRE xv Daphnitae - Djado Publié avec le concours du Centre National du Livre (CNL) et sur la recommandation du Conseil international de la Philosophie et des Sciences humaines (UNESCO) ÉDISUD La Calade, 13090 Aix-en-Provence, France ISBN 2-85744-201-7 et 2-85744-808-2 La loi du 11 mars 1957 n’autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article 41, d’une part, «que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage du copiste et non des tinées à une utilisation collective » et, d’autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de ses auteurs ou des ses ayants-droit ou ayants-cause, est illicite» (alinéa 1 er de l’article 40). Cette représentation ou reproduction par quelque pro cédé que ce soit constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et sui vants du Code pénal. ©EDISUD, 1995. Secrétariat : Laboratoire d’Anthropologie et de Préhistoire des pays de la Méditerranée occi dentale, Maison de la Méditerranée, 5 bd Pasteur, 13100 Aix-en-Provence. Dar bel Ouar I 2223 D11. DAPHNITAE Selon Ptolémée (IV, 6, 6, Müller, p. 745), les Daphnitae sont une tribu mineure de la Libye Intérieure, au voisinage des Salathi* et du mont Mandron, d’où coule le fleuve Salathos (actuel Bou Regreg), cf. Id., IV, 6, 2, p. 731 ; 6, 3, p. 735. La série d’ethnonymes cités à la suite des Daphnitae s’égrène jusqu’aux Ethiopiens Nigri- tes* proches de l’Atlas marocain. Il est difficile de préciser l’aire d’implantation des Daphnitae, qui toutefois ne devait pas être très éloignée de la limite méridionale de la province de Tingitane. L’ethnonyme, dans sa transcription grecque, semble formé sur le nom grec du laurier (daphnē), comme celui des Asphodelōdeis* sur celui de l’asphodèle. J. DESANGES D12. DAPSOLIBUES Les Dapsolibues sont mentionnés par Nicoles de Damas (Fragm. hist. Graec, III, p. 462, n° 135), à l’époque d’Auguste. On ignore leur localisation. Mais ils nous valent le premier témoignage sur la pratique de la « nuit de l’erreur »* : selon Nicolas, certain jour après le coucher des Pléiades, donc vers l’époque des semailles, à la tombée de la nuit les femmes se retiraient et restaient dans l’obscurité. Les hommes allaient les rejoindre, chacun possédant celle à qui le hasard l’unissait. Il s’agit là d’un rite de fécondité, qui a du reste longtemps subsisté en Berbérie. C’est pourquoi nous proposons de corriger le nom des Dapsolibues, qui semble corrompu (cf. St. Gsell, H.A.A.N., V, p. 32, n. 4), en Daps[il]olibues ou « Libyens magnifiques » (pour la formation, cf. Melanogaitouloi/M.éla.nogétules*). J. DESANGES D13. DAR BEL OUAR (voir Enfida) L’une des plus importantes nécropoles mégalithiques de l’Enfida* (Tunisie orientale). En 1875, Rebatel et Tirant décrivaient cette nécropole et y dénom- braient 250 à 300 dolmens « en parfait état de conservation ». En 1881, plusieurs de ces monuments furent fouillés par le capitaine Bordier; l’année suivante l’aide- major Chopinet visite à son tour cette nécropole qu’il décrit sous le nom d’Enfida. Cette dénomination est insuffisante car elle s’applique, en fait, à toute la région bordée par la courbe sud du golfe de Hamamet et dont Dar bel Ouar est approximativement le centre. Il faut dire que l’imprécision toponymique est grande : Dar bel Ouar (orthographié parfois Dar Bellouar) est aussi appelé Bordj Bel Ouar, Menzel Bel Ouar et même Hadjar bel Ouar. C’est ce dernier nom que connaissent Cagnat en 1885 et Hamy en 1904. La description la plus complète est donnée par le Dr Hamy, qui fut le seul auteur à avoir séjourné dans la région, encore n’y resta-t-il qu’une dizaine de jours. Les dolmens de l’Enfida appartiennent au type des dolmens* littoraux du Maghreb, c’est dire qu’ils possèdent une enceinte circulaire faite généralement d’une seule rangée de pierres et un couloir à ciel ouvert. La chambre et parfois le couloir peuvent être dallés. Le Dr Hamy précise que les dolmens encore debout ont un orthostate monolithique sur trois côtés de la chambre ; le quatrième, qui est à l’est, est aujourd’hui béant mais à l’origine, ce côté était constitué d’un muret en pierres sèches. Le couloir aboutit à cette ouverture de la chambre, il est le plus souvent perpendiculaire à ce petit côté, mais il peut être plus ou moins oblique lorsque le monument réunit dans la même enceinte plusieurs chambres qui conservent chacune leur couloir. Le cercle de pierres est plus ou moins régulier suivant la qualité ou la taille des blocs utilisés. 2224 / Dar bel Ouar Dolmen multiple de Dar Bel Ouar, aujourd’hui complètement détruit (Photo E.-G. Gobert, vers 1950) Comme dans les autres nécropoles de l’Enfida, d’autres types de tombes peuvent être associés aux dolmens, ce sont principalement des bazinas*, les unes cylindro- tronconiques surbaissées, les autres à degrés de très faible hauteur. Elles ont entre 7 et 8 m de diamètre, ce qui est aussi celui des enceintes des dolmens. Certaines bazinas ont leur chambre complètement enterrée, le couloir est alors en pente, voire remplacé par un véritable escalier. Ces monuments si nombreux n’ont livré aux fouilleurs qu’un mobilier misé- rable : une demi-douzaine de vases modelés et mal cuits, dont un gobelet à anse, forme plutôt archaïque dans la céramique protohistorique du Maghreb. Les ossements découverts dans ces tombes mégalithiques n’ont pu être conservés mais on a pu reconnaître que les corps avaient été déposés en décubitus latéral fléchi ; constatation qui depuis a été confirmée dans les autres sépultures proto- historiques de l’ensemble du Sahel. Les Libyens restaient encore fidèles à cette position à la fin des temps puniques. L’estimation du nombre des monuments constituant la nécropole de Dar bel Ouar est sujette à des variations considérables. Pour Rebatel et Tirant, il y aurait eu 250 à 300 dolmens dans la nécropole, en 1875 ; Chopinet en compte une centaine encore debout en 1882, mais il estime à 3 000 le nombre des dolmens ruinés ; deux ans plus tard, Cagnat parlait encore d’un « immense champ de dolmens sur un espace d’un kilomètre carré au moins»; en 1886, Rouire attribuait à la nécropole 800 monuments occupant une aire de 250 ha. Quelque soit le nombre exact de monuments, il est sûr que la nécropole de Dar bel Ouar comptait parmi les plus importantes de l’Afrique du Nord or il n’en reste plus aujourd’hui que quelques dalles éparses et un seul dolmen ruiné à Dar bel Ouar même, village de création récente dont la construction s’est faite aux dépens de la nécropole mégalithique dans l’indifférence générale. Les rédacteurs de la feuille de Sousse de l’Atlas préhistorique de Tunisie n’ont pu, ces dernières années, que constater les dégâts irrémédiables. La destruction totale de la nécropole de Dar Dar bel Ouar / 2225 2226 / Dar bel Ouar bel Ouar, ainsi que de la plupart des tombes mégalithiques de l’Enfida, est incontestablement un désastre archéologique. BIBLIOGRAPHIE REBATEL et TIRANT, « Voyage dans la régence de Tunisie », Le Tour du Monde, 1 e r semestre 1875, p. 318. CHOPINET Dr., «Une colonne dans l’Enfida de Tunisie», Bull, de la Soc. de Géogr. de Toulouse, n° 7, 1882, p. 212-213. CAGNAT R.,« Rapport sur une mission en Tunisie », Archives des Missions, 3 e série, t. XI, 1885, p. 35-37. ROUIRE Dr., «Notes sur les dolmens de l’Enfida», Rev. d’Ethnogr. t. V, 1886, p. 441-448. HAMY M.T., « Cités et nécropoles berbères de l’Enfida », Bull, de Géogr. hist, et descript., n° 1, 1904, p. 33-68. DEYROLLE Dr., « Note sur les dolmens de Dar Bel Ouar et leur mobilier funéraire », Bull, de la soc. archéol. de Sousse, 1908, p. 60-61. Atlas préhistorique de la Tunisie. Feuille de Sousse, n° 8 Dar Bel Ouar. Ecole franc, de Rome et INAA de Tunis. Rome 1992. G . CAMPS D14. D A R ES-SOLTANE Important site préhistorique du Maroc, proche de Rabat, comptant plusieurs gisements. Grotte I Elle est située à 600 m de l’ancien pavillon d’été du Sultan, à 300 m du rivage actuel. Cette grotte, qui s’ouvre dans une falaise morte, fut fouillée en 1937 et 1938 par A. Ruhlmann. L’entrée était occupée par un amas coquillier et la cavité était comblée jusqu’au plafond en grès dunaire. A. Ruhlmann y distingua 13 niveaux Jatte campaniforme de Dar uploads/Histoire/ encyclopedie-berbere-volume-15.pdf
Documents similaires






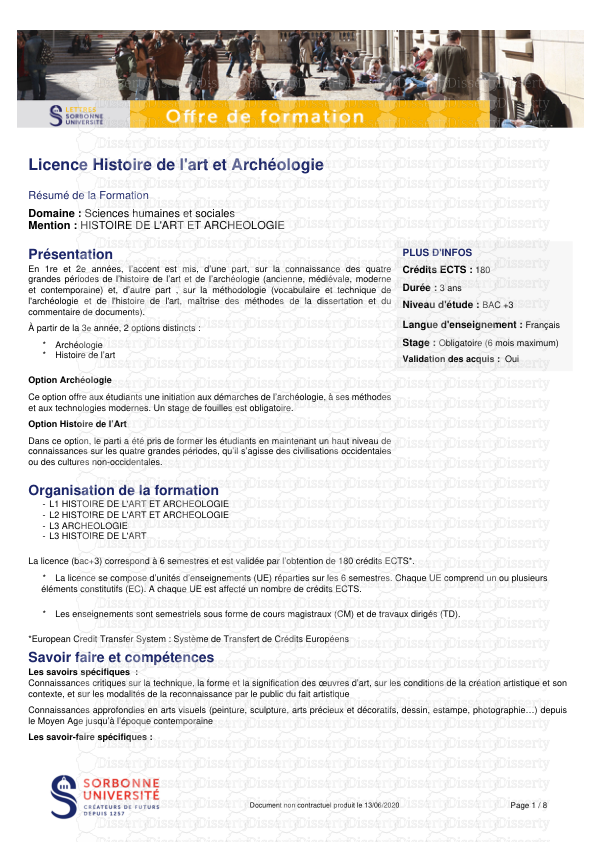



-
88
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 28, 2022
- Catégorie History / Histoire
- Langue French
- Taille du fichier 15.2855MB


