1 François Perroux l'oppose au développement qui induit une modification des st
1 François Perroux l'oppose au développement qui induit une modification des structures et dont l'analyse implique la prise en compte d'éléments qualitatifs INTRODUCTION A LA THEORIE DE LA CROISSANCE Définition : La croissance économique est définie comme l'augmentation quantitative d'un indicateur économique, généralement le PIB ou le PNB réel total ou par habitant Mesure : On raisonne en général en terme de taux de croissance Il est nécessaire de bien préciser la période de base sur laquelle le taux de croissance est défini Ce sera le plus souvent l'année Ce taux de croissance annuel peut être décomposé en taux de croissance trimestriel, mensuel etc. Le passage de taux de croissance trimestriels au taux annuel exige quelques précautions. Soit r le taux trimestriel et R le taux annuel. On a: (1 + r1) (1 + r2) (1 + r3) (1 + r4) = 1 + R le taux trimestriel moyen rm est tel que: (1 + rm)4 = 1 + R rm = (1 + R)1/4 - 1 ou encore rm = [(1 + r1) (1 + r2) (1 + r3) (1 + r4)]1/4 - 1. Le taux de croissance moyen est donc la moyenne géométrique des taux de croissance. 2 Dans les modèles théoriques on raisonne très souvent en temps continu St = S0 (1 + G)t = S0 (1 + g/m)mt = S0(1 + g/m)mgt/g lim m→∞ S0(1 + g/m)mgt/g = S0 egt car lim k→∞ (1 + 1/k)k = e Quand on mesure la croissance sur une période donnée - disons de 1870 à 1939 avec un taux annuel, on fait bien sûr référence à un taux annuel moyen sur l'ensemble de la période. Lorsqu'on parle de croissance, on fait implicitement référence à un phénomène de longue période. Le tableau qui suit donne ce résultat Dans cette optique de longue période une notion importante est celle de doublement. Compte tenu du taux de croissance moyen annuel, combien faut-il d'années avant que la variable ait doublée ? Taux de croissance annuel moyen Période de doublement 1 % 1,5 % 2 % 3 % 4 % 5 % 7 % 10 % 70 ans 47 ans 35 ans 23 ans 17 ans 15 ans 10 ans 7 ans 3 - Les agrégats de mesure : On raisonne toujours en terme réel et les mesures statistiques sont faites à partir d'agrégats nominaux que l'on corrige pour tenir compte de l'inflation. Le PIB est une bonne mesure du produit global alors que le PNB mesure plutôt le revenu des facteurs. - S'agissant des mesures sur longue période se posent des problèmes de changement de base des séries statistiques et de la modification des structures. Mais, mesure-t-on convenablement l'activité économique ou, en se ramenant au produit par tête, le bien être de la population ? - Le calcul du PIB ne prend pas en compte les services gratuits à l'intérieur des ménages qui selon certaines estimations pourraient représenter jusqu'à 50 % du PIB. - La consommation de services collectifs est mal appréhendée. - Les méthodes utilisées par les différents pays ne sont pas les mêmes rendant délicates les comparaisons internationales. - Enfin, si on raisonne en terme de bien être, ces agrégats ne prennent pas en compte les phénomènes de pollution et de destruction du patrimoine naturel. De plus, il s'agit d'un taux moyen qui n'intègre aucunement les modifications des inégalités de revenu. 4 La croissance est un phénomène récent et les travaux de Madison (1981) donnent les résultats suivants : Histoire : - Les faits : Période Population PIB/h PIB total Agraire 500-1500 0 0 0 Agraire progressive 1550-1700 0,2 0,1 0,3 Capitalisme commercial 1700-1820 0,4 0,2 0,6 Capitalisme 0,9 1,6 2,5 Ce taux moyen tombe à 3 % de 73 à 79 et 1,2 % jusqu'en 85. Il se situe dans les années 90 à 1-2 % pour l'Europe. Les trente glorieuses (J. Fourastié) ont donc un caractère exceptionnel Au XIXème siècle, le taux moyenne est de 2 à 3 % en GB et de 2 % en France; de 1839 à 1959 il est de 3,6 % aux EU. De 1950 à 1970 il est de 5 % dans les pays industriels avec un minimum de 3 % en GB et un maximum de 11 % au Japon. La France enregistre une croissance de 5,5 %. 5 Compte tenu des fortes inégalités de revenu et de l'espérance moyenne de vie, la croissance est un phénomène peu perceptible pour la population pendant tout le XIXème siècle, contrairement aux mouvements conjoncturels. Il s'agit toutefois d'un phénomène capital et on estime (cf. Madison) que de 1870 à 1980 le PIB est multiplié par 60 au japon (18 pour le PIB/h) et 43 et 7,5 aux EU. Les faits stylisés Kaldor (1961) dégage de l ’étude de la croissance à long terme différents constats qu ’il appelle faits stylisés et que toute théorie de la croissance doit nécessairement expliquer: 1. Le revenu par tête croît de façon continue 2.Le capital par tête est croissant 3. Le taux de rendement du capital est constant Oui si même niveau de développement Très variable par sous périodes (30 glorieuses) Vérifiable à partir des années 50 4. Le ratio capital produit est constant 5. Les parts du capital et du travail dans le revenu national sont constantes 6. Les pays ont des taux de croissance de productivité différents Vrai pour EU et RFA Faux pour France, GB, japon Approximativement vrai Vrai 6 - Les idées Les premières analyses de la Croissance : les classiques (A. Smith, Ricardo, Malthus). Ils assistent à la révolution industrielle et s'intéressent aux conditions du progrès qui repose directement sur le développement matériel de la société. Trois questions sont posées: - Quelles sont les forces qui gouvernent le développement de l'activité économique ? - Peut-on dégager les tendances à long terme d'un tel développement ? - Comment asseoir l'action politique pour favoriser le progrès ? 1. Les forces : le progrès technique et la croissance de la population (qui accroît la quantité de travail disponible). 2. La tendance à long terme : la marche vers l'état stationnaire. 3. L'action : s'attaquer aux privilèges et aux monopoles. 3. La division du travail est limitée par la taille du marché. A. Smith : on résumera son apport en 3 propositions. 1. L'opulence naît de la division du travail - augmentation de l'habileté par la spécialisation (manufacture d'épingle) - gains de temps (limite les pertes dues au passage d'une tâche à l'autre) - progrès technique par invention de machines 2. La division du travail est la conséquence de l'échange. -Tendance naturelle à l'échange pour se procurer ce qu'on a pas en produisant en excès ce qu'on sait bien produire. - C'est l'égoïsme de chacun qui fait le bien être de tous (fondement du libéralisme). 7 - les capitalistes, véritables organisateurs de la production, achètent les facteurs de production, c'est à dire le travail et les services de la terre et vendent leur production. L'écart constitue leur rémunération, c'est à dire le profit qui apparaît comme résiduel. Ce profit est intégralement accumulé et vient grossir le stock de capital dont ils disposent pour acheter les facteurs de production. D. Ricardo : L'économie est constituée de trois classes: - les propriétaires fonciers qui touchent une rente. Compte tenu de la loi des rendements décroissants (la terre est le seul facteur rare) et du développement de la population, la rente voit sa part dans le revenu total s'accroître avec le temps. Le produit net de rente Y, qui est partagé entre les deux autres classes, croît donc à taux décroissant. « La dynamique grandiose des Classiques » (Schumpeter) - les salariés vendent leur force de travail aux capitalistes et touchent un salaire w. Celui-ci résulte de la concurrence que se livrent les capitalistes; mais dès qu'il dépasse le niveau de subsistance ws, on assiste à un accroissement de la population qui accroît l'offre de travail et fait baisser w jusqu'à sa valeur d'équilibre ws. En raisonnant en terme de produit net de rente et dans une économie à un seul bien, le blé, la production ne dépend que du facteur travail (N) et le capital apparaît comme un fonds de subsistance ou fonds des salaires permettant d'entretenir la main d'œuvre pendant la durée du processus de production. Le modèle s'écrit : 8 Nt+1 = Kt+1/ws. La loi de population est telle que cette dernière augmente aussi longtemps que le salaire se situe au-dessus du niveau de subsistance Yt = f(Nt) avec f’ > 0 et f” < 0 fonction de production à un seul facteur Yt = rt Kt + wt Nt le produit net de rente est réparti entre les capitalistes et les salariés Kt+1 = (1 + rt) Kt l'intégralité du profit est accumulé par les capitalistes wt = Kt+1/Nt le taux de salaire courant dépend du stock de capital et du niveau de la population Etat Stationnaire K1 K0 Π0 Profits Produit net ws N0 N1 N* Y N W0 Salaires 9 qui conduit inexorablement à un uploads/Histoire/ macroeco-dynamique-polycomplet.pdf
Documents similaires




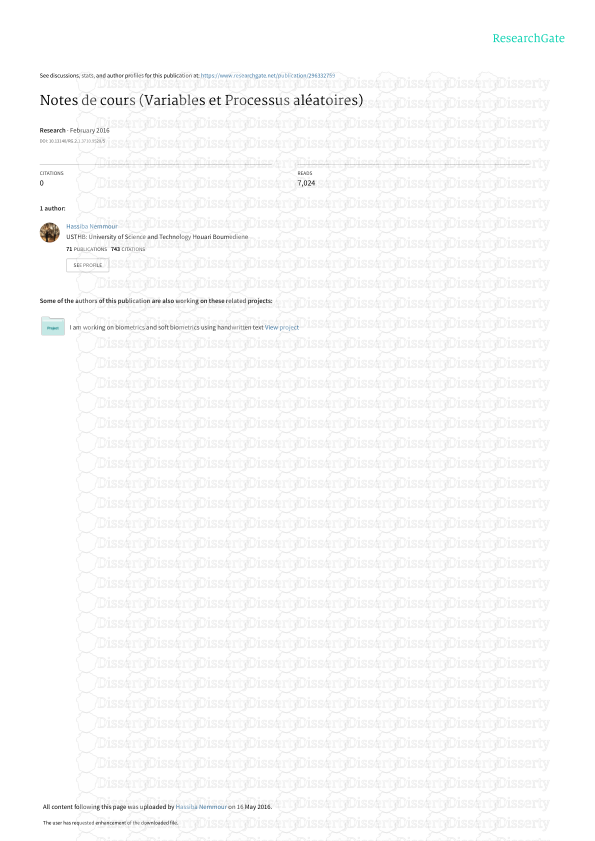





-
83
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 29, 2021
- Catégorie History / Histoire
- Langue French
- Taille du fichier 0.5576MB


