Académie des technologies Le biogaz Rapport de l’Académie des technologies Impr
Académie des technologies Le biogaz Rapport de l’Académie des technologies Imprimé en France ISBN : 978-2-7598-1850-1 Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction par tous procédés, réservés pour tous pays. La loi du 11 mars 1957 n’autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article 41, d’une part, que les « copies ou reproductions stric- tement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective », et d’autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, « toute représentation intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (alinéa 1er de l’article 40). Cette représentation ou reproduction, par quelque pro- cédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du code pénal. © EDP Sciences 2016 III PRÉFACE Le biogaz, dont les principes de production datent du milieu du XIXe siècle, connaît depuis une quinzaine d’années un retour sur la scène mondiale comme source d’énergie renouvelable d’origine naturelle. Son exploitation industrielle permet le bouclage d’un cycle d’économie circulaire des ordures ménagères et des déchets organiques industriels ou agricoles. Elle peut aussi être intensifiée, à l’image du système allemand de production fermentaire qui utilisait jusqu’à très récemment le maïs comme source de matière première. L’Académie des technologies a entrepris depuis plusieurs années une revue systématique et sans concessions des technologies de production des éner- gies renouvelables, sur les plans technique, économique et réglementaire en cherchant à faire partager au lecteur intéressé l’état des lieux qu’elle a établi. Le Groupe de travail, qui sous la présidence du regretté Daniel Thomas, s’est chargé de la réalisation de ce rapport, a auditionné les meilleurs spécialistes français du domaine, tant les chercheurs du secteur académique que les industriels présents dans ce secteur en cours de développement. Technologie « mûre », la production du biogaz fait également l’objet de recherches poussées, dont le Groupe a tenté de mesurer les perspectives. C’est dans ce cadre que s’inscrit ce rapport sur le biogaz. Ce dernier a été adopté par l’Assemblée le 13 mai 2015. Alain Bugat, Président de l’Académie des technologies V INTRODUCTION QU’EST CE QUE LE « BIOGAZ » ? Le biogaz est le produit de la dégradation de la matière organique, d’origine animale ou végétale, par des microorganismes dans des conditions dites « anaé- robies » c’est-à-dire en l’absence d’oxygène. Le phénomène est très largement observable dans la nature. Le savant italien Alessandro Volta (1745-1823) a été le premier à décrire et à analyser la composition du « gaz des marais ». En 1776 il en isole le composant majeur : le méthane. Les archaebactéries méthanogènes, qui sont présentes dans la nature, sont les organismes vivants producteurs du méthane. Ces mêmes bactéries ont produit le méthane conservé dans les ter- rains sédimentaires qui est extrait sous forme de « gaz naturel ». Ce procédé de production fermentaire est appelé méthanisation. La composition du biogaz varie de façon importante selon les types de matières organiques digérées et les conditions de leur dégradation. Typiquement, le biogaz extrait des décharges d’ordures, où il est naturellement produit, est com- posé de 35 à 65 % de méthane, 15 à 50 % de gaz carbonique, 4 à 40 % d’azote et 0 à 5 % d’oxygène. Le gaz carbonique est un coproduit normal des réactions qui conduisent à la formation du méthane. Dans certaines conditions, les réactions peuvent aussi accumuler de l’hydrogène et certains gaz mineurs comme le sulfure d’hydrogène, produit de dégradation des protéines. La composition du biogaz VI Rapport de l’Académie des technologies Le biogaz produit dans les conditions maitrisées et contrôlées des digesteurs anaérobies industriels peut atteindre 45 à 75 % de méthane, 30 à 40 % de gaz carbonique et quelques traces d’azote (<0,2 %). La méthanisation par l’écosystème anaérobie est un processus naturel que l’on retrouve dans le côlon de l’homme et dans le système digestif d’autres espèces, en particulier les espèces ruminantes. Le rumen et le côlon contiennent des mil- liers d’espèces bactériennes anaérobies qui travaillent ensemble à dégrader les macromolécules présentes dans les cellules des végétaux absorbés par l’animal dont une partie sera méthanisée. Très peu de ces bactéries ont été isolées et cultivées séparément. VII SOMMAIRE 01 Production industrielle du biogaz 01 1.1 Historique de la production du biogaz 02 1.2 L’extraction du biogaz des décharges de déchets non dangereux 06 1.3 La fermentation anaérobie industrielle 12 1.4 Le cas des boues de stations d’épuration 13 1.5 La purification du biogaz 17 1.6 Les co-produits (digestats) 19 1.7 Les risques liés à la production de biogaz 20 1.8 Les technologies thermochimiques : la méthanation 23 À quoi sert le biogaz ? 23 2.1 La production directe d’énergie 24 2.2 Les utilisations du bio-méthane 27 La place du biogaz dans le monde et en Europe 27 3.1 Dans le monde 29 3.2. Aux USA 29 3.3. En Europe 31 3.4 Le modèle allemand 33 Le biogaz en France 33 4.1 Pourquoi la France a-t-elle commencé tardivement à s’intéresser au biogaz ? 35 4.2 La place du biogaz en France 41 Conclusion 45 Annexes 49 Membres du Groupe de travail 51 Publications de l’Académie 01 Chapitre 1 PRODUCTION INDUSTRIELLE DU BIOGAZ 1.1 HISTORIQUE DE LA PRODUCTION DU BIOGAZ Développée initialement pour des applications de traitement des pollutions (invention française de la fosse d’aisance par Louis Moras en 1881), la métha- nisation est ensuite étudiée dans le cas du fumier, dont la production spontanée de biogaz ou « gaz de fumier » à partir des déchets animaux est aussi vieille que l’élevage. En 1884, l’agronome Ulysse Gayon y observe la présence de « gaz car- burés forméniques » et démontre leur pouvoir énergétique pour des applications au chauffage et à l’éclairage. Développée pour traiter les pollutions, la digestion anaérobie allait ainsi pro- gressivement être associée à la valorisation énergétique du biogaz produit. Pour preuve, en 1897 en Inde, un premier digesteur fut construit par les Anglais sur une léproserie à Matunga, près de Bombay, avec l’objectif de produire du carburant véhicule. Ce fut finalement un petit moteur qui fut installé sur le site en 1907 pour produire un peu d’électricité et de chaleur. Mais c’est surtout entre les deux guerres que de nombreux travaux font pro- gresser la digestion anaérobie des boues des stations d’épuration, en particulier en Grande-Bretagne, en Allemagne et aux États-Unis. Illustration de ces progrès, de nombreux digesteurs entrent en service dans les années 1930-40 sur des stations d’épuration, avec le souci d’optimisation énergé- tique du biogaz produit, souligné par les nombreuses études sur la réinjection du 02 Rapport de l’Académie des technologies Le biogaz méthane en réseau. En France, la récupération du biogaz à la ferme date de la fin des années 1930 avec la mise au point par les enseignants Isman et Ducellier d’un digesteur breveté basé sur un système rechargeable avec une pré-fermentation aérobie, pour éviter l’acidogénèse lors du démarrage de la réaction biologique1. Dans les années 1980, c’est sur la base du brevet déposé par Isman et Ducellier que les premiers essais de digestion anaérobie des ordures ménagères furent conduits en France par la société Valorga. De nos jours, le biogaz est produit industriellement de trois manières dif- férentes qui vont être décrites de façon un peu approfondie : (i) par extraction des gaz de décharge des ordures ménagères ; (ii) par fermentation anaérobie de matières organiques diverses ; (iii) ou par gazéification des matières premières organiques et production catalytique de syngaz. 1.2 L’EXTRACTION DU BIOGAZ DES DÉCHARGES DE DÉCHETS NON DANGEREUX Les installations de stockage des déchets non dangereux (ISDND) de classe 2 sont des installations construites pour recevoir des déchets ménagers ou indus- triels assimilables à des déchets ménagers. Les seuls déchets autorisés à y être enfouis sont les déchets dits « ultimes », c’est-à-dire ceux qui ne peuvent pas être valorisés dans les conditions techniques et économiques du moment. Il s’agit d’installations classées soumises à autorisation et réglementées. Le procédé Des casiers sont creusés dans le sol dans lesquels on déverse les déchets. Le volume de ces casiers est délimité par une digue stable et étanche dont la géo- métrie permet d’éviter le débordement des lixiviats d’un casier à l’autre. Le fond et 1 Pour une note historique plus complète lire http://www.biogazrhonealpes.org/doc/ Presse_et_Edition/Topo_biogaz_RhoneAlpesEnergie_biomethane.pdf 03 Production industrielle du biogaz les flancs des casiers sont munis d’une géomembrane surmontée d’une couche de drainage. Pour limiter l’action de l’eau sur les déchets et donc la production de lixiviats on creuse des fossés pour éliminer les eaux pluviales. Les lixiviats collec- tés par le système d’étanchéité et de drainage sont traités séparément dans une installation particulière. Une fois la capacité maximale de l’installation atteinte, on procède à la fermeture des casiers en privilégiant un recouvrement étanche de terre qui encourage le développement de la végétation. Le gaz, issu de la digestion anaé- robie spontanée des matières organiques présentes dans les déchets est capté en insérant des conduites ou puits à aspiration uploads/Industriel/ biogaz-internet-important.pdf
Documents similaires


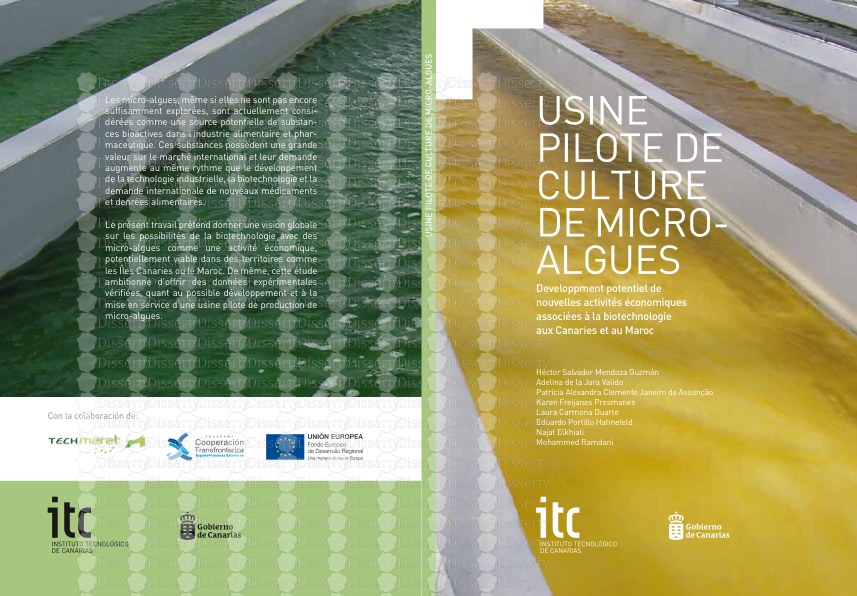







-
104
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 17, 2022
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 1.2506MB


