Table des matières Table des matières..........................................
Table des matières Table des matières.........................................................................................................................................1 I- LA POLITIQUE INDUSTRIELLE : DE L’INDEPENDANCE A L’AJUSTEMENT.............................4 1- La politique industrielle de 1956 à 1972...................................................................................................4 2- La politique industrielle de 1973 à 1983...................................................................................................5 II- LA NOUVELLE POLITIQUE INDUSTRIELLE ..................................................................................6 2- La politique des prix et de la concurrence.................................................................................................6 3- L'assouplissement de l'encadrement administratif des entreprises............................................................6 2. la Politique de protection et d'incitation ...................................................................................................7 3- Les limites du programme d'ajustement industriel et commercial............................................................7 4- Politique industrielle et stratégie d'industrialisation..................................................................................8 III- LE PROGRAMME EMERGENCE......................................................................................................10 1- Ciblage volontariste sur 7 secteurs – moteurs de la croissance, par ordre d’importance en terme de potentiel : ....................................................................................................................................................10 2- Modernisation compétitive de l’ensemble des tissus d’acteurs - tous secteurs confondus, par :............10 3- Persévérance sur les chantiers fondamentaux de longue haleine :..........................................................10 4- Discontinuité dans la méthode et les moyens..........................................................................................11 IV- Potentiel et contraintes de l’industrialisation .......................................................................................11 V- La régionalisation de l’industrie ...........................................................................................................16 a. Les principaux noyaux industriels...........................................................................................................16 b. Les petites villes industrielles : une meilleure décentralisation...............................................................18 CH 3/ LE SECTEUR INDUSTRIEL : COMPETITIVITE ET LIBRE-ECHANGE Le secteur industriel constitue la 2ème activité d’importance après l’agriculture et avant le tourisme. Sa contribution à la croissance du PIB n'a pas sensiblement augmenté au cours des vingt dernières années. La part de la production manufacturière dans le PIB est restée de l'ordre de 18%. Or un pays tel que le Maroc devrait générer plus de 25% de sa production dans le secteur manufacturier. Cependant son rôle dans les échanges extérieurs et les investissements est primordial. En 1997, il a exporté pour plus de 34 Mds DH (soit 70% des exportations totales), investi plus de 8 Mds DH et employé près de 500.000 personnes (dont 1/3 de saisonniers).. Autrefois axé sur la production de biens de consommation, le secteur manufacturier s'est orienté vers la fabrication de biens intermédiaires et d'équipement qui constitue une part croissante de la production industrielle. Sous l'effet de la forte expansion de la chimie (principalement, produits dérivés des phosphates) et de la fabrication de machines, la part de l'industrie lourde dans le total de la production manufacturière - environ un tiers - est approximativement égale à celle des produits alimentaires. En outre, la production de biens intermédiaires légers a connu une forte progression. Il existe quatre grandes branches des industries de transformation : - Les industries agro-alimentaires qui font 1/3 de la production industrielle, concernent un très vaste champ d'activités allant du simple conditionnement à la transformation. Activités complémentaires de la production agricole, elles permettent de valoriser des produits végétaux ou animaux, de répondre aux besoins alimentaires de la population et de contribuer à l'apport de devises par le biais des exportations. Elles se composent d’une dizaine de sous secteurs d'inégale importance dominés par l'industrie sucrière et par la transformation des céréales, viennent ensuite, la conserverie, la fabrication de corps gras d'origine végétale ou animale et l'industrie du lait. - Le secteur des industries chimiques et parachimiques contribue pour 1/3 à la production du secteur, et fortement aux échanges extérieurs et à l'emploi. L'industrie chimique de base est essentiellement constituée par les activités de pétrochimie et de la transformation des phosphates. La production d'acide phosphorique. La parachimie fournit des produits d'usage courant destinés principalement au marché national telle l'industrie pharmaceutique. - Le secteur des industries textile, de l'habillement et du cuir (17% de la VA) occupe un des premiers rangs aussi bien en terme d’investissements et d’emplois créés que de ses exportations (1/5 des exportations de marchandises). - Le secteur des industries mécaniques, métallurgiques, électriques et électroniques (13%) est à la fois fournisseur de biens d'équipement et utilisateur d'une proportion non négligeable de sa propre production. Il occupe une position stratégique dans le processus de développement industriel marocain. La croissance industrielle de 1980 à 1991 a été tirée principalement par les exportations. L'élargissement du marché des exportations industrielles du Maroc est alimenté par le processus de délocalisation de l'appareil productif des économies industrialisées L'industrie marocaine semble régresser, en termes relatifs dans des secteurs de biens d'équipement et de biens intermédiaires pour se concentrer sur les biens de consommation. Du point de vue sectoriel, il y a un désengagement relatif vis-à-vis des secteurs de la Chimie et des IMME au profit des secteurs textile et des industries alimentaires. I- LA POLITIQUE INDUSTRIELLE : DE L’INDEPENDANCE A L’AJUSTEMENT La constitution du tissu industriel marocain a connu trois phases distinctes. • La première (1956/72) correspond à la politique de substitution des importations qui se traduit par la création d’industries locales pour atténuer la dépendance nationale vis à vis de l’étranger. • La deuxième (1973/83) va jouer sur un mixage des politiques de substitution et de promotion des exportations. • La troisième phase vise à permettre au Maroc d’être un pôle d’attraction pour les investissements étrangers, et surtout de se positionner dans le nouveau système productif international qu’offre la globalisation de l’économie mondiale. Elle correspond au développement des industries basées sur l’exploitation des avantages comparatifs, l’amélioration qualitative et quantitative du produit. 1- La politique industrielle de 1956 à 1972 De 1956 à 1973, la stratégie de développement visait l'édification d'une économie moderne par la formation des cadres, la mise en place des infrastructures de base et des institutions d’accompagnement (banques et OFS). Cependant, malgré les orientations industrialistes des premières années, « le bilan de l'industrialisation du Maroc depuis l'indépendance apparaît plutôt maigre » selon A.Belal. En effet, les objectifs du plan 1960-64 étaient axées sur une industrialisation reposant sur la création d'industries de base. Le taux de croissance assigné par le Plan au secteur industriel était de 10 %, contre 6,5 % pour l'ensemble de l'économie. Cependant, le plan 1965-67 va reléguer l'industrie au second rang. Et dès 1964 le BEPI ne jouera plus son rôle. Le secteur privé restera embryonnaire. A l'exception du textile et des industries alimentaires, les investissements industriels sont très insuffisants Le plan 1968-72 va adopter une politique d'import-substitution avec une préférence aux industries agro-alimentaires et aux industries manufacturières légères orientées vers la satisfaction du marché intérieur. Néanmoins, la politique industrielle gardera les mêmes fondements (protection, incitation, investissement public), et privilégiera l'approche coûts- avantages, en particulier le critère du coût en devises des investissements. Durant la décennie 1960, le souci de développer les exportations a été associé à l'objectif de valorisation des ressources naturelles locales (agricoles, halieutiques et minières) ou encore d'appuyer le processus d'import-substitution. 2- La politique industrielle de 1973 à 1983 Dans une deuxième phase, débutant avec le plan 1973-77, l'Etat adopta comme objectif principal la diversification des industries d'exportation, sans pour autant rompre avec la stratégie d'import-substitution. D’autres objectifs nouveaux furent proclamés : la promotion diversifiée des exportations, la régionalisation de l'investissement industriel et la marocanisation des entreprises. La politique de marocanisation visait l'instauration de la souveraineté économique nationale, et l’aide à la formation de groupes privés nationaux. Sur le plan des méthodes, l’Etat privilégia les projets publics pour promouvoir de nouveaux secteurs d'activité industrielle. Et pour pallier les carences du secteur privé, il créa l’ODI et chercha à combiner encouragements à l'exportation et protection locale dans une perspective d'import-substitution. Cette période est marquée par : • la volonté de promotion d’une classe d’entrepreneurs ; • une intervention directe de l’Etat dans le processus d’industrialisation; • l’encouragement de la valorisation des ressources agricoles et minières ; • la protection du marché intérieur et l’import-substitution; • la promotion des exportations à partir du milieu des années 70. Le résultat de cette politique été le développement de quelques exportations de biens manufacturés, handicapées par la surévaluation du dirham et la politique des prix et des incitations, et une très légère diversification du tissu industriel. II- LA NOUVELLE POLITIQUE INDUSTRIELLE A partir de 1983, l'Etat a opté pour un modèle de croissance de l'industrie dont les principes de base sont : • le renforcement de la flexibilité des structures productives • l'introduction de la concurrence interne afin de rationaliser la gestion des entreprises, et améliorer la productivité; • la correction du système incitatif pour encourager les activités économisant des devises ; • une politique de la propriété du capital visant une mobilisation accrue des ressources en faveur des investissements industriels. • Le renforcement de la flexibilité des structures productives Il a été recherché à travers des actions visant à assouplir le régime des prix et l'encadrement administratif des entreprises. Les réformes des procédures de l'administration économique introduites visaient à faciliter les opérations des entreprises, tant au niveau de l'investissement que du fonctionnement. 2- La politique des prix et de la concurrence Mise en place en 1971, elle visait la réglementation des prix afin de protéger le consommateur, éviter les ententes et prévenir les dérapages inflationnistes. Cependant, la plupart des biens n'étaient pas soumis à réglementation. A partir de 1973, l’inflation à deux chiffres et l'accroissement de l'instabilité des prix des matières premières ont rendu la gestion administrée des prix quasiment impraticable. Pourtant, la libéralisation des prix n’a été entamée à partir de 1982 et étendue à presque tous les secteurs industriels en 1986. L'exception concerne les produits agro-industriels et les prix de certains matériaux de construction. 3- uploads/Industriel/ ch-5-industrie-maroc.pdf
Documents similaires





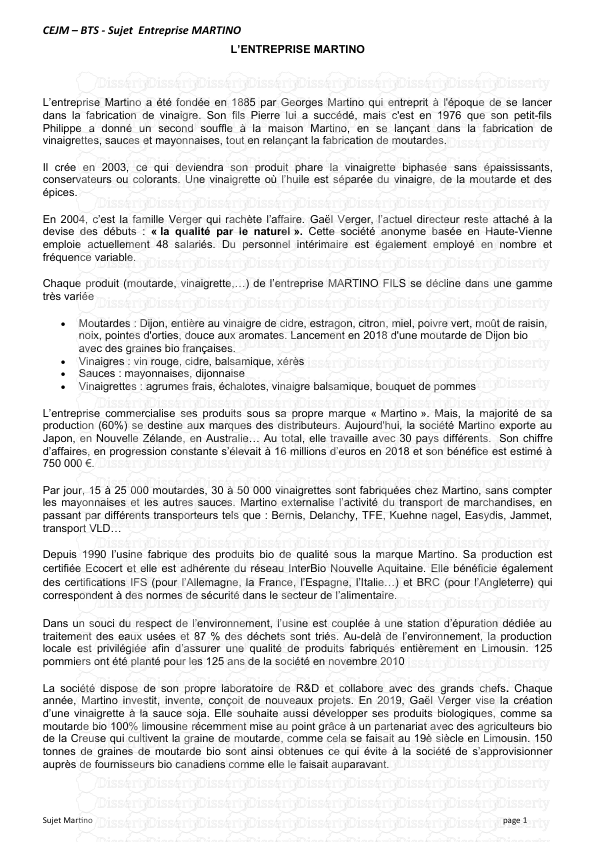




-
52
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 18, 2021
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1226MB


