´ Economie Politique Christina Pawlowitsch christina.pawlowitsch@u-paris2.fr Un
´ Economie Politique Christina Pawlowitsch christina.pawlowitsch@u-paris2.fr Universit´ e Panth´ eon-Assas, Paris II Licence de Droit, 1` ere ann´ ee 2020–21 1 / 132 It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker, that we expect our dinner, but from their regard to their own interest. We address ourselves, not to their humanity but to their self-love, and never talk to them of our own necessities but of their advantages. Ce n’est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bi` ere et du boulanger, que nous attendons notre dˆ ıner, mais bien du soin qu’ils apportent ` a leurs int´ erˆ ets. Nous ne nous adressons pas ` a leur humanit´ e, mais ` a leur ´ ego¨ ısme ; et ce n’est jamais de nos besoins que nous leur parlons, c’est toujours de leur avantage. (Smith, Wealth of Nations, book 1, chapt. 2) 2 / 132 As every individual, therefore, endeavours as much as he can both to employ his capital in the support of domestic industry, and so to direct that industry that its produce may be of the greatest value ; every individual necessarily labours to render the annual revenue of the society as great as he can. He generally, indeed, neither intends to promote the public interest, nor knows how much he is promoting it. By preferring the support of domestic to that of foreign industry, he intends only his own security ; and by directing that industry in such a manner as its produce may be of the greatest value, he intends only his own gain, and he is in this, as in many other cases, led by an invisible hand to promote an end which was no part of his intention ... 3 / 132 Par cons´ equent, puisque chaque individu tˆ ache, le plus qu’il peut, 1◦d’employer son capital ` a faire valoir l’industrie nationale, et – 2◦de diriger cette industrie de mani` ere ` a lui faire produire la plus grande valeur possible, chaque individu travaille n´ ecessairement ` a rendre aussi grand que possible le revenu annuel de la soci´ et´ e. ` A la v´ erit´ e, son intention, en g´ en´ eral, n’est pas en cela de servir l’int´ erˆ et public, et il ne sait mˆ eme pas jusqu’` a quel point il peut ˆ etre utile ` a la soci´ et´ e. En pr´ ef´ erant le succ` es de l’industrie nationale ` a celui de l’industrie ´ etrang` ere, il ne pense qu’` a se donner personnellement une plus grande sˆ uret´ e ; et en dirigeant cette industrie de mani` ere ` a ce que son produit ait le plus de valeur possible, il ne pense qu’` a son propre gain ; en cela, comme dans beaucoup d’autres cas, il est conduit par une main invisible ` a remplir une fin qui n’entre nullement dans ses intentions ... (Smith, Wealth of Nations, book 4, chapt. 2 ; c’est nous qui soulignons) 4 / 132 Programme du cours Introduction ` a l’´ economie politique. Deux parties : • th` emes relevant de la macro´ economie (Lotz) • th` emes relevant de la micro´ economie (Pawlowitsch) Site du Cours 5 / 132 Chapitre 1 Adam Smith : pr´ ecurseur de l’individualisme m´ ethodologique 6 / 132 ≪´ Economie politique ≫: terme polyphonique Utilis´ e, pendant toute une p´ eriode, comme terme g´ en´ erique pour ce que l’on appelle aujourd’hui les ≪sciences ´ economiques ≫ou bien ≪´ economie ≫tout court. C’´ etait le temps des classiques : Smith (1723–1790), Ricardo (1772–1823), Malthus (1761–1834), Say (1767–1832), ... 7 / 132 D’o` u une certaine coloration du terme : ≪´ economie politique ≫ fait penser ` a ces grands ouvrages dont le but ´ etait d’expliquer l’´ economie en tout – l’´ economie comme un grand syst` eme qui repose sur ses propres lois. ≪Politique ≫dans le sens de polis : cit´ e-´ Etat, communaut´ e de citoyens libres et autonomes. 8 / 132 Adam Smith (1723–1790) Philosophe et ´ economiste ´ ecossais des Lumi` eres, le ≪p` ere des sciences ´ economiques ≫. ´ Etudes ` a Glasgow (1737–40), ´ el` eve de Francis Hutcheson (sens interne de la morale ; l’un des premiers ` a enseigner en anglais, et non en latin) ; ensuite ` a Oxford (1740–46). Enseigne ` a l’universit´ e d’´ Edimbourg (1748–51) ; rencontre avec David Hume. Professeur de logique (1751–1752) et ensuite de philosophie morale ` a l’universit´ e de Glasgow (1752–1764). 1959 : The Theory of Moral Sentiments – Th´ eorie des sentiments moraux (2` eme ´ edition 1761 ; r´ eponse ` a Hume). 9 / 132 A Glasgow, Smith donne aussi un cours sur la rh´ etorique et les belles-lettres (1762-63). Dans la troisi` eme ´ edition de la Th´ eorie des sentiments moraux (1766) se trouve en annexe un article intitul´ e ≪Considerations Concerning the First Formation of Languages ≫. Dans son cours ` a Glasgow, on trouve d´ ej` a une partie sur l’´ economie politique ; une autre sur le droit. L’un de ses ´ el` eves : John Millar ; plus tard, professeur de droit ` a Glasgow (d´ eveloppe l’analyse de Smith sur l’autorit´ e sociale et le droit). 10 / 132 1764 : Smith accepte un poste de tuteur du fils d’une famille de la noblesse ´ ecossaise (le duc de Buccleuch) ; dans cette fonction, voyage en France. Grˆ ace ` a la recommandation de Hume, rencontre avec Helv´ etius, Holbach, d’Alambert, Turgot, Voltaire et Quesnay. 1766 : retour en Angleterre (vit de sa pension alimentaire de sa position de tuteur). 1767 : An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations – Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations. (Book IV. Of Systems of political economy (Des syst` emes d’´ economie politique). 11 / 132 Membre de la Royal Society de Londres ; renseigne plusieurs gouvernements sur des questions d’impˆ ots et de commerce international. 1778 : commissaire des douanes ` a ´ Edimbourg. Inspire les grands ´ economistes suivants. Ses livres – d´ ej` a de son vivant – sont un succ` es commercial. Une anecdote veut qu’il n’ait jamais parl´ e de ses recherches en compagnie – pour ne pas empˆ echer la vente de ces livres. 12 / 132 Smith en quelques mots-cl´ e The Theory of Moral Sentiments – Th´ eorie des sentiments moraux (1759) An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations – Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations (1776) La Main invisible (the Invisible Hand) Division du travail Th´ eorie de la valeur travail command´ e 13 / 132 La main invisible (the Invisible Hand) ´ Evoqu´ ee d´ ej` a dans la Th´ eorie des sentiments moraux (1759), mais aussi dans la Richesse des nations (1976). Terme employ´ e aujourd’hui comme m´ etaphore d´ esignant la th´ eorie selon laquelle l’ensemble des actions individuelles des acteurs (´ economiques), guid´ ees par l’int´ erˆ et propre de chacun, fait ´ emerger le bien commun et la richesse. 14 / 132 Th´ eorie des sentiments moraux (1759) Smith cherche ` a d´ ecrire les principes de la nature humaine pour comprendre comment ils suscitent la cr´ eation des institutions et du comportement social. S’interroge notamment sur l’origine de la capacit´ e qu’ont les individus de porter des jugements moraux sur les autres mais aussi sur leur propre attitude. Propose une th´ eorie de la ≪sympathie ≫: en observant les autres et les jugements qu’ils portent sur autrui et eux-mˆ emes, nous nous rendons compte de nous-mˆ emes mais aussi du fait que nous sommes observ´ es par les autres. 15 / 132 Chacun de nous a en lui-mˆ eme un ≪homme int´ erieur ≫( ≪the man within ≫), capable de se placer ` a distance de ses propres passions et int´ erˆ ets, afin de se constituer en ≪observateur impartial ≫(≪impartial spectator ≫) de soi-mˆ eme, capable de t´ emoigner son approbation ou sa d´ esapprobation morale ` a l’´ egard de ses propres actes. Il en r´ esulte une sympathie mutuelle (mutual sympathy of sentiments) de laquelle ´ emerge des habitudes et des principes de comportement. 16 / 132 Partie I, section I, chapitre I, De la sympathie : Pity and compassion are words appropriated to signify our fellow-feeling with the sorrow of others. Sympathy, though its meaning was, perhaps, originally the same, may now, however, without much impropriety, be made use of to denote our fellow-feeling with any passion whatever ... Sympathy, therefore, does not arise so much from the view of the passion, as from that of the situation which excites it. We sometimes feel for another, a passion of which he himself seems to be altogether incapable ; because, when we put ourselves in his case, that passion arises in our breast from the imagination, though it does uploads/Industriel/ 2021-economie-politique-cours-final.pdf
Documents similaires
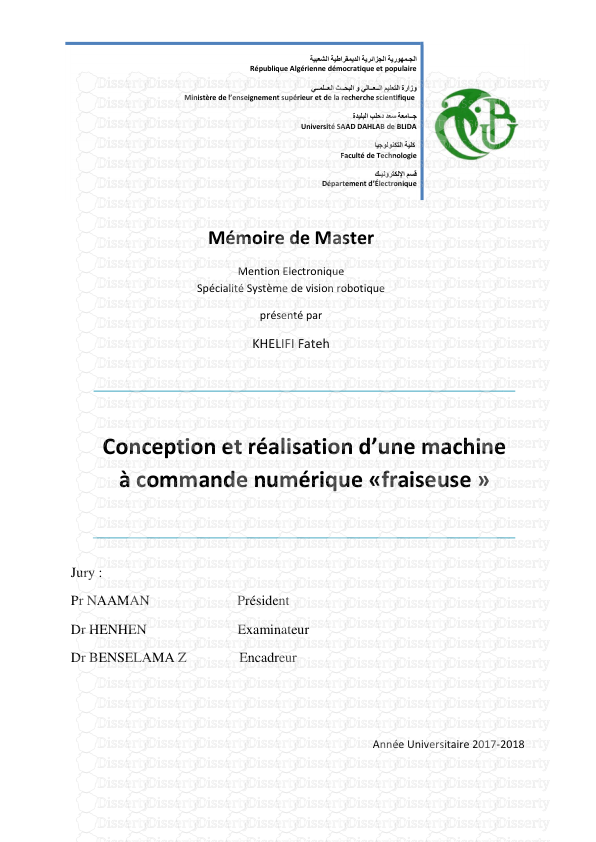









-
97
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 19, 2022
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2789MB


