47 D É C O U V E R T E N ° 3 4 4 - 3 4 5 J A N V I E R - F É V R I E R 2 0 0 7
47 D É C O U V E R T E N ° 3 4 4 - 3 4 5 J A N V I E R - F É V R I E R 2 0 0 7 DANIEL LINCOT Directeur de recherches au CNRS L 0a Terre baigne dans l’énergie solaire, une énergie évidente, tellement évidente qu’on l’oublie souvent. Pourtant avec 1,56.1018 kWh/an, l’énergie solaire incidente représente plus de 10 000 fois la consommation mondiale d’énergie (environ 1,1.1014 kWh ). Il s’agit donc d’une énergie abondante, renouvelable, qui pourrait parfaitement couvrir la totalité ou une grande part de nos besoins énergétiques futurs, comme elle l’a fait durant des milliers d’années. Dans le contexte actuel de prise de conscience généralisée des incertitudes énergétiques et de la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique, un recours massif à l’énergie solaire sous toutes ses formes, directes (photovoltaïque, thermique) ou indirectes (éolien, biomasse) doit s’imposer comme une priorité, une évidence. La conversion photovoltaïque de l’énergie solaire Parc solaire de 10 MWc installé à Pocking (Allemagne) capable d’alimenter 3 300 maisons en électricité. © www.martin-bucher.de, Stuttgart/Germany D É C O U V E R T E N ° 3 4 4 - 3 4 5 J A N V I E R - F É V R I E R 2 0 0 7 48 kwh/m² 1850-1950 1750-1850 1650-1750 1550-1650 1450-1550 1350-1450 1250-1350 1150-1250 1050-1150 950-1050 850-950 750-850 / kwh/ FIGURE 1 Irradiance s solaire m moyenne annuelle. Database Meteonorm (www.meteonorm.com) © Meteotest (Bern, Suisse). Énergie solaire et modules photovoltaïques Même si l’énergie solaire est maintenant de mieux en mieux reconnue dans de nombreux pays et auprès de l’opinion publique, cette re- connaissance n’a pas été facile et a dû (et doit toujours) faire face à de nombreuses opposi- tions sur des bases parfois étonnamment ré- ductrices. On reproche par exemple à l’énergie solaire, et à ses modes d’exploitation directe en électricité en particulier, d’être in- termittente (jour, nuit, saisons), diffuse et non concentrée, en oubliant que toute notre ali- mentation, que le pétrole lui-même, sont basés sur ce mode de production énergétique. C’est comme si nous mettions sur le même plan, société de consommation oblige, le fait de se servir dans un réfrigérateur alimenté au- tomatiquement et celui de produire les ali- ments eux-mêmes. La question du caractère non concentré de cette énergie est aussi mise en avant, une centrale électrique de plusieurs centaines de MW n’occupant que quelques km2 au sol. Pour autant faut-il, comme je l’ai lu, la comparer avec une bande de 100 mètres de large, le long des plages françaises et ten- ter de démontrer ainsi l’impossibilité du re- cours massif à cette énergie ! On peut très bien imaginer de mettre cette bande un peu plus loin de la plage et pourquoi pas de la ré- partir où cela ne gène pas ! Là encore c’est un peu comme si on refusait de manger du pain sous prétexte qu’il a fallu des centaines de mètres carrés pour le produire. Il est utile d’étayer cette démonstration sur la base de données concrètes. Dans le cas de la France, la quantité d’énergie reçue en moyenne par an et par mètre carré varie entre 1,2 MWh et 1,5 MWh (la puissance lu- mineuse incidente de référence en plein midi face au Soleil est de 1 kW/m2). Cette valeur varie suivant la localisation géographique comme le montre, pour l’Europe la carte ci- après (fig. 1). Elle atteint 2,7 MWh dans le Sahara. 49 D É C O U V E R T E N ° 3 4 4 - 3 4 5 J A N V I E R - F É V R I E R 2 0 0 7 Si on considère une option tout à fait raisonnable de modules photovoltaïques de 10 % de rendement électrique, l’énergie pro- duite sera d’environ 130 kWh/an/m2. Pour at- teindre la production électrique française d’environ 550 TWh/an (1 Tera = 1012) il faudrait donc couvrir environ 5 000 km2 de surface. Cela peut paraître beaucoup, mais sait-on que la surface bâtie en France représentait 10 700 km2 en 1997, et que les in- frastructures routières près de 16 300 km2 et donc que l’équipement d’une fraction de cette surface pourrait produire massivement de l’énergie solaire photovoltaïque contraire- ment aux idées reçues. Ces analyses trouvent leur prolongement dans les programmes ambitieux de « toits photovoltaïques » en Allemagne ou au Japon, développés avec succès depuis plusieurs an- nées. Aux États-Unis aussi, les choses évolu- ent avec par exemple la nouvelle loi en Californie, adoptée l’été dernier, autour de l’objectif « un million de toits solaires ». La puissance normalisée d’un module photo- voltaïque s’exprime en Watt crête (noté Wc) et correspond à la puissance électrique qu’il délivre sous un éclairement solaire normalisé de 1 kW/m2, correspondant à l’énergie reçue en plein midi face au Soleil par temps clair sous la latitude de l’Espagne. À côté des équipements des toitures, l’installation de cen- trales photovoltaïques ayant des puissances al- lant de la centaine de kWc à quelques MWc se développe rapidement (fig. 2). La question du coût élevé de l’électricité photovoltaïque est aussi souvent avancée, à juste titre, comme un frein. Cependant ce coût, aujourd’hui à environ trois euros par Wc, baisse régulièrement avec l’objectif de passer dans quelques années sous la barre symbolique de un euro par Wc. Les effets d’échelle et l’amélioration des technologies FIGURE 2 Exemples d’installations c comportant des m modules p photovoltaïques : : a) Installation mc-Si. © Fondation Énergies pour le monde. b) Installation au CIS 50 kWc,45 MWh/an. © Würth Solar. c) Installation mc-Si ,750 kWc. © Photowatt. a) b) c) D É C O U V E R T E N ° 3 4 4 - 3 4 5 J A N V I E R - F É V R I E R 2 0 0 7 50 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 1993 0 250 500 750 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 69,44 77,6 88,6 154,9 199,9 288,5 401,4 557,8 759,0 1 195,0 1 727,0 125,8 69,09 FIGURE 3 Évolution d de l la production m mondiale d de cellules photovoltaïques (en M MWc). Source : EurObserv'ER, PV News, mars 2006. sont à la base de ces progrès constants. Dans ces conditions, la compétitivité de l’énergie photovoltaïque, qui pointe déjà dans des pays tels que le Japon où l’électricité est chère, est un objectif réalisable dans les prochaines an- nées, en particulier dans un contexte d’aug- mentation des cours du pétrole. L’accélération de ce processus fait l’objet de politiques volontaristes de nombreux États, accordant à la production d’électricité photovoltaïque, fournie au réseau électrique, des coûts de rachat incitatifs. La France, qui revient de loin, vient récemment, avec la loi de juillet 2006, de rejoindre le peloton de tête avec l’Allemagne, le Japon et l’Espagne, permet- tant un coût de rachat à 0,55 euros du kWh. Ainsi, l’énergie photovoltaïque apparaît, contrairement aux idées reçues, comme une source d’énergie renouvelable incontournable et apte à couvrir dans l’avenir une proportion significative et croissante des besoins énergé- tiques, aux cotés d’autres sources d’énergie. L’évolution de la production annuelle de mod- ules photovoltaïques (fig. 3) connaît une croissance exceptionnelle avec un taux de croissance de 30 à 40 % par an depuis plusieurs années, avec en 2005 une produc- tion d’environ 1 800 MWc. C’est donc un domaine industriel en plein développement, créateur de milliers d’em- plois, qui faisait titrer à un magazine en 2003 « Énergie photovoltaïque : une industrie est née ». Cependant cette progression spectacu- laire ne doit pas faire oublier que cette puis- sance, de l’ordre de celle d’une tranche de centrale nucléaire, reste négligeable dans le paysage énergétique et par rapport aux be- soins. Une projection des évolutions com- parées au niveau mondial de l’énergie consommée et de l’énergie photovoltaïque (fig. 4), montre que cette dernière pourrait at- teindre 10 à 20 % en 2050 (auxquels il faut ajouter les autres énergies renouvelables). Il faut donc poursuivre et même amplifier cette progression. C’est un vrai défi à la fois vital et passionnant. Dans la suite de cet article, nous verrons plus en détail l’origine de l’effet photo- voltaïque, l’état de l’art des technologies et des acteurs, puis nous ouvrirons une fenêtre « découverte » avec les perspectives fasci- nantes en matière de recherche et de développement de cette source d’énergie. La conversion photovoltaïque de l’énergie solaire : comment ça marche ? Où en est on ? Le rayonnement solaire est constitué de photons dont la longueur d’onde s’étend de l’ultraviolet (0,2 micron) à l’infrarouge loin- 51 D É C O U V E R T E N ° 3 4 4 - 3 4 5 J A N V I E R - F É V R I E R 2 0 0 7 Lorsqu’un photon est absorbé, il éjecte un électron d’un niveau d’énergie inférieur, vers un niveau d’énergie plus élevé, uploads/Industriel/ 344-345-conversion-photovoltaique-pdf.pdf
Documents similaires





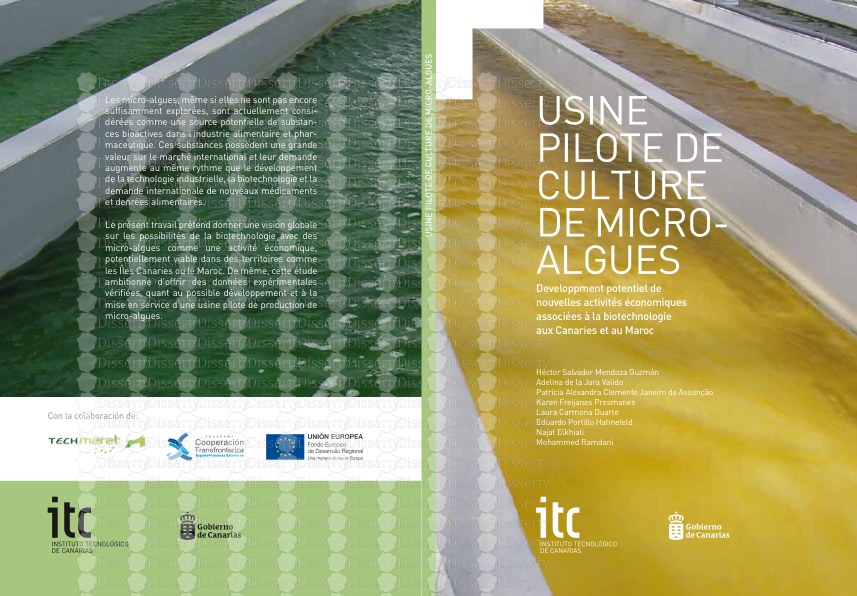


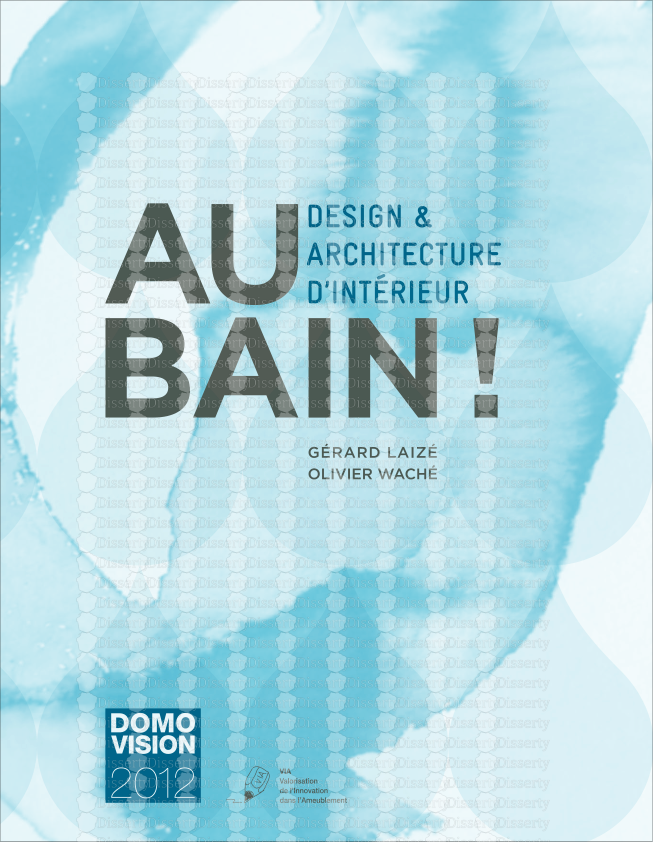

-
30
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 18, 2021
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 0.7105MB


