COURS DE DROIT DE L’ENERGIE ET DE L’INDUSTRIE INTRODUCTION GÉNÉRALE L’on ne peu
COURS DE DROIT DE L’ENERGIE ET DE L’INDUSTRIE INTRODUCTION GÉNÉRALE L’on ne peut parler du droit de l’énergie et de l’industrie sans envisager le droit de la propriété industrielle qui la caractérise même. La propriété industrielle est l’ensemble des règles juridiques relatives aux dessins et modèles industriels, aux brevets d’invention, aux marques et aux appellations d’origine et indications de provenance. A- La catégorisation de la propriété industrielle La propriété industrielle regroupe différents droits de propriété incorporelle pouvant éventuellement faire partie d’un fonds de commerce : a) titres récompensant des créations techniques ou esthétiques, mais à usage industriel au sens large : brevets d’invention, dessins et modèles industriels ; b) signes distinctifs acquis par l’usage ou, plus fréquemment, par le dépôt : marques de fabrique, de commerce et de service, diverses indications géographiques telles les appellations d’origine et indications de provenance. La propriété industrielle se divise en deux catégories : les droits sur les créations industrielles, d’une part, et les droits sur les signes distinctifs, d’autre part. Les droits de propriété intellectuelle sont des droits subjectifs. De cette nature ils tiennent leur structure. B– Les objets de la propriété industrielle : les créations industrielles et les signes distinctifs Il y a d’abord des créations de l’esprit à vocation industrielle. L’objet du droit de brevet est l’invention. Les dessins et modèles utilisés dans l’industrie constituent l’objet d’un autre droit de propriété industrielle qui ne porte pas de nom particulier, distinct du droit d’auteur et cumulable avec lui. Il y a ensuite des signes distinctifs tels que les marques, les appellations d’origine et les indications de provenance. Les marques, qui correspondent à des droits d’occupation, sont des signes susceptibles de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une entreprise. Les appellations d’origine et les indications de provenance sont des dénominations géographiques servant à désigner un produit qui provient d’une aire géographique déterminée ; elles ont un élément en commun : la mention d’un lieu géographique dans lequel sont obtenus ou fabriqués les produits. Mais les appellations d’origine se distinguent par un élément supplémentaire : elles constituent une garantie de qualité des produits (ex. Champagne) alors que les indications de provenance sont de simples mentions informatives (ex. artisanat de la Drôme, article de Paris). Appellations d’origine et indications de provenance sont appelées à être peu à peu remplacées par des signes européens, valable dans l’ensemble de l’Union Européenne : AOP (appellations d’origine protégée) et IGP (indications géographiques protégées). Contrairement aux droits sur les brevets et sur les dessins et modèles, les titulaires de droits sur les signes distinctifs ne sont pas des créateurs car ils n’ont pas développé une activité inventive ou artistique. Ils se sont contentés, au contraire, d’intégrer à leur entreprise certains signes permettant d’attirer la clientèle et dont ils ne sont pas les auteurs. C) Les droits des inventeurs Le droit de brevet comprend essentiellement un « droit exclusif d’exploitation » donc un droit pécuniaire ou patrimonial. Il consiste pour l’inventeur à : – exploiter lui-même l’objet ou le procédé inventé ; – autoriser une ou plusieurs personnes à l’exploiter à sa place ou concurremment, enfin ; – céder purement et simplement son droit à un tiers. Mais, l’invention résultant d’un travail créatif, l’inventeur est aussi investi d’un droit moral, cependant réduit à deux prérogatives : – le droit de divulgation et – le droit à la paternité. CHAPITRE I : LES DESSINS ET MODÈLES Les unes sont des créations purement utilitaires, les autres, des créations ornementales. C’est d’ailleurs là le critère de distinction des brevets et des dessins et modèles. Tandis que les brevets récompensent les créateurs de produits et procédés nouveaux, le droit des dessins et modèles encourage la présentation nouvelle de produits connus1. Dans ce second cas, « la création a pour objet l’agrément et non l’utilité ». Nous commencerons néanmoins par les dessins et modèles car ils font le lien entre le droit d’auteur et la propriété industrielle qu’ils peuvent se voir appliquer cumulativement. La protection juridique de l’aspect extérieur d’un produit est un enjeu majeur de la création industrielle dans une société où les produits sont de plus en plus esthétisés. Le droit des dessins et modèles offre une réservation privative spécifique, au titre de la propriété industrielle, sur l’apparence donnée à un produit, indépendamment de la protection par le droit d’auteur sur la forme originale du produit. PARTIE I : LES CRÉATIONS INDUSTRIELLES Outre les conditions de fond, le Code de la propriété intellectuelle impose une condition de dépôt. Section 1. Les conditions de fond La protection légale est réservée à certaines personnes sur certains objets qui correspondent à la catégorie juridique appelée dessins et modèles. Paragraphe 1 : Le titulaire des droits A – Règle de fond Créateur – Le titulaire des droits sur un dessin ou sur un modèle est le créateur. C’est bien lui le titulaire naturel ; Le droit de propriété sur les dessins et modèles est transmissible entre vifs ou à cause de mort. Une personne morale peut être titulaire originaire (initial) des droits à condition qu’il s’agisse d’une œuvre collective. L’œuvre collective est celle qui est réalisée à l’initiative d’une personne qui rassemble les contributions de plusieurs auteurs, lesquels ne se sont pas concertés mais ont travaillé en parallèle (séparément, sans collaboration). La plupart des œuvres collectives sont des créations de salariés. Exemples d’œuvres collectives : un vêtement de ski ; des éléments de carrosserie; une affiche; Dès qu’une œuvre est le fait d’un studio de création, par exemple dans l’univers de la mode, ou d’un bureau de style, notamment dans l’industrie automobile, il y a de fortes chances que le juge la qualifie d’œuvre collective. Enfin, un groupe de créateurs peut effectuer un dépôt en copropriété. On dit qu’ils sont coauteurs d’une œuvre de collaboration. 1) Règle de preuve a) Présomption simple au profit du déposant Le titulaire des droits est normalement le créateur lui-même. Mais la preuve de cette qualité est souvent difficile à établir. Aussi le Code de la propriété intellectuelle pose-t-il une présomption selon laquelle le premier déposant est considéré comme le bénéficiaire de la protection. Or il peut s’agir d’une personne morale et celle-ci n’est aucunement contrainte de prouver qu’elle est cessionnaire des droits d’une personne physique ou qu’elle est à l’origine de la création d’une œuvre collective. b) La présomption est simple (réfragable) La présomption est simple lorsqu’elle peut être renversée par tous moyens (par exemple, un dépôt officieux sous forme d’enveloppe Soleau, chez un notaire ou un huissier, par une expertise révélant la marque du style du créateur dans sa création). Il se peut, en effet, qu’un tiers ait usurpé la qualité de créateur en déposant un dessin ou modèle qui n’est pas le sien. Le véritable propriétaire (véritable créateur) pourra intenter l’action en revendication. Si le tiers déposant est de mauvaise foi (hypothèse la plus vraisemblable), le délai de prescription, de cinq ans, court à compter de l’expiration du titre ; sinon, à compter de la publication de l’enregistrement du dessin ou modèle. Dès lors que la présomption n’est pas renversée, tout pourra donc se passer comme si un tiers, personne physique ou personne morale, était investi à titre originaire des droits, même si la création en question est l’œuvre d’une personne physique. Quant à la protection du dessin ou modèle par le droit d’auteur, la titularité des droits est déterminée de la même façon que pour les autres œuvres. a) Définition positive et définition négative Le dessin ou le modèle protégé est une création de forme ornementale, nouvelle, présentant un caractère propre et apparent. Certains dessins et modèles sont expressément exclus de la protection : - la première exclusion ne pose pas de problème particulier : il s’agit de ceux qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Il ne faut donc pas confondre le produit et le dessin ou modèle. Par exemple, le conditionnement d’un produit stupéfiant pourrait être licite alors que c’est le produit qui est interdit à la consommation et à la vente. D’autre part, il y a peu de dessins ou modèles en eux-mêmes contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Seraient considérés comme tels ceux qui portent atteinte à des droits de la personnalité (comme le droit à l’honneur, par exemple des caricatures outrageantes, des dessins grossiers ou choquants) ; – la seconde exclusion porte sur la forme exclusivement fonctionnelle Elle se borne à appliquer l’exigence de caractère ornemental et sera par conséquent étudiée avec elle. C’est d’ailleurs pourquoi l’on a dit plus haut s’agissant de la définition du dessin ou modèle protégé, qu’il est une création de forme ornementale, nouvelle, ayant un caractère propre et apparent. b) Une création de forme Principe identique au droit d’auteur, Le dessin ou le modèle protégé doit résulter d’un effort créateur concrétisé. L’exigence d’une activité créatrice résulte de l’emploi du mot « créateur » par le législateur. c) Le caractère ornemental ou esthétique Le dessin ou le modèle doit avoir un caractère esthétique ou ornemental et non pas purement utilitaire. Il ne faut uploads/Industriel/ cours-droit-de-l-x27-energie-et-de-l-x27-industrie-2021 1 .pdf
Documents similaires





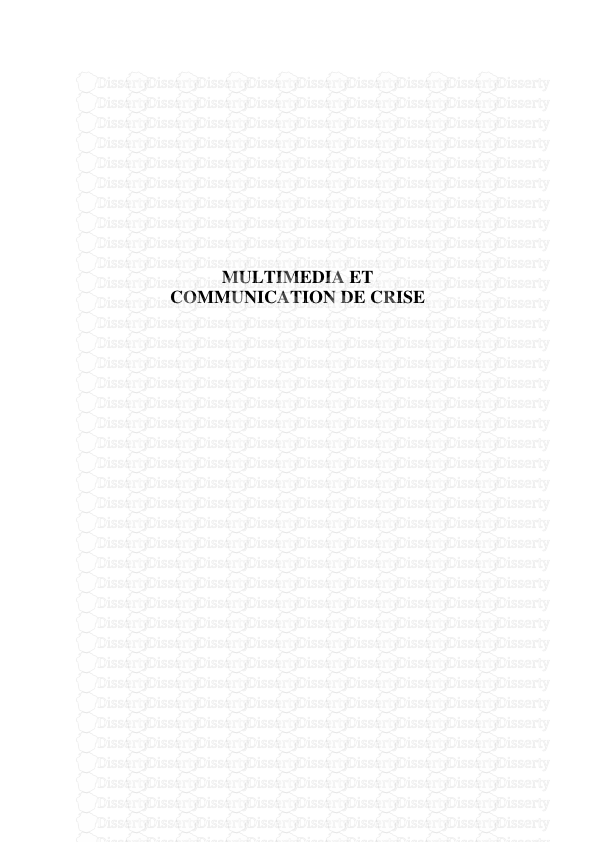




-
82
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 27, 2021
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2839MB


