Ressources naturelles[modifier | modifier le code] Diamant et or[modifier | mod
Ressources naturelles[modifier | modifier le code] Diamant et or[modifier | modifier le code] L'exploitation artisanale des gisements, comme ici à Kossou, est courante en Côte d'Ivoire. L'extraction de diamant en Côte d’Ivoire débute en 1948 par le gisement de Tortiya étendu sur 188 ha avec une réserve estimée à 830 000 carats. L’exploitation de ce gisement est confiée à la Société anonyme de recherches minières en Côte d’Ivoire (Saremci) qui, dès la première année obtient une production de 36 000 carats et voit sa production augmenter régulièrement pour atteindre son point culminant en 1972 avec 260 000 carats. Le déclin consécutif conduit à la fermeture de la mine en 1975 et à celle de l’entreprise en 1976, malgré une ultime tentative de reprise d’activités par la société Watson qui se solde par un échec et conduit à la fermeture en 1977. Malgré tout, le gisement de Tortiya a constitué à son époque la principale ressource minière du pays28. À côté de cette expérience qui constitue la plus importante opération de production de diamant en Côte d’Ivoire, et parallèlement à elle, se développent d'autres travaux d’exploitation de gisement dans la région de Séguéla. Ceux-ci sont entrepris d’abord par la Compagnie minière du Haut-Sassandra (Sandramine) en 1949 puis repris par la Société diamantifère de la Côte d’Ivoire (Sodiamci) en 1956. Cette autre initiative dont la production annuelle n'est jamais allée au-delà de 25 000 carats prend fin en 1971 avec la fermeture de la Sodiamci. Bien que l'extraction industrielle du diamant soit arrêtée, une exploitation artisanale se poursuit aujourd'hui à Séguéla et Tortiya, situés dans la zone contrôlée par la rébellion ivoirienne. Ainsi l'ensemble de la production nationale de diamant s'effectue sous le contrôle de la rébellion ivoirienne avec des résultats assez controversés. Jugés maigres, voire dérisoires par certains observateurs29, ces résultats sont évalués par l'organisation Global witness au chiffre record de 300 000 carats avec un revenu annuel du trafic lié à cette activité, estimé par le ministre ivoirien des Mines et de l'Énergie à plus de 25 millions de dollars (40 milliards de FCFA)30,31. En 2008, la Côte d’Ivoire reste cependant le seul pays sous embargo de l'ONU pour l'exportation du diamant en raison de la crise que connaît ce pays32,33. L’or, extrait au moyen de techniques traditionnelles par les peuples de Côte d’Ivoire bien avant l’accession du pays à l’indépendance, constitue la deuxième ressource minière exploitée d'un sous-sol qui recèle beaucoup d’autres minerais comme le fer, le nickel, le manganèse, la tantalite, la bauxite, le cuivre, le gaz, l’uranium, le cobalt, le tungstène, l'étain, l’iléite et les pierres ornementales. Toutefois, un seul gisement, géré par la Société des mines d’Ity (SMI) est en exploitation industrielle. Quatre autres gisements sont en exploitation artisanale par des organisations Coopératives à Issia, Angovia, Angbaoua, et Kokumbo. Plusieurs sociétés non nationales détiennent des permis d’exploitation de mines d'or. Malgré la crise que traverse le pays, la production globale d’or connaît une hausse entre 2004 et 2005. Le pays reste cependant un producteur assez marginal d'or, sa production annuelle moyenne étant estimée à 1,5 t34 très loin derrière les 26 t35 du Ghana ou les 38 t36 de l'Afrique du Sud. Pétrole et gaz naturel[modifier | modifier le code] Pétrole, gaz et électricité Pétrole Production 50 000 bbl/j Consommation 25 000 bbl/j Gaz Production totale 1,3 milliard de m3 (2004) Consommation 1,3 milliard de m3 (2004) Exportations 0 m3 (2004) Électricité Production totale – dont hydraulique – thermique 5 507 GWh (2006) 40 % 60 % Consommation 3 202 milliards de kWh (2004) Exportations 1,1 milliard de kWh (2004) Consommation d'énergie/capita Sources : CIA Avant la découverte, dans les années 1970, de gisements de pétrole et gaz exploitables, le pays assurait par des importations la couverture de ses besoins nationaux en produits pétroliers finis. Aussi, pour mieux bénéficier des gains de valeur ajoutée liés à la transformation du pétrole brut, l'État ivoirien importa, à partir de 1965, des quantités de plus en plus importantes d’hydrocarbures, traités intégralement par la Société ivoirienne de raffinage (SIR) créée en octobre 1962 et ayant une capacité de raffinage de 3 500 000 tonnes par an, soit 70 000 barils par jour37. Cette nouvelle situation fit baisser, de façon considérable, le taux d’importation de produits finis du pays. Celui-ci s'identifiait, de ce fait, comme un pays tourné vers la raffinerie plutôt que la production du pétrole. Le pays disposait pourtant de réserves de pétrole brut estimées à 100 millions de barils38. Le groupe Esso-Shell est à l'origine de la découverte de ce pétrole et de ce gaz exploitables. Dans son sillage, des concessions d’exploitation sont accordées à plusieurs autres grandes compagnies pétrolières par le gouvernement ivoirien. Cependant, à travers la société d’État Petroci (Société nationale d’opérations pétrolières de la Côte d’Ivoire), l’État ivoirien demeure propriétaire des gisements découverts et prend des participations au sein de divers groupes. En 2005, avec 3,9 millions de tonnes, le sous-secteur de l’hydrocarbure traduit son dynamisme par une hausse générale, la plus importante du secteur industriel. La production de pétrole, grâce au champ « Baobab » du bloc CI40, atteint le niveau de 80 000 barils par jour à fin mars 2006 permettant ainsi de couvrir largement la consommation journalière estimée à 25 000 barils. La production de gaz quant à elle s’établit à 1 742,3 millions de m³. La même année, les exportations de produits pétroliers augmentent de 22,6 % pour se chiffrer à 3 242,1 millions de tonnes39. Au total, en 2008, avec 50 000 barils par jour en moyenne, la Côte d’Ivoire ne peut être considérée comme un producteur stratégique de pétrole en Afrique comparativement à la Guinée Équatoriale (300 000 barils par jour), à l'Angola (1,5 million par jour) ou encore au Nigéria (2,3 millions de barils par jour)40. Énergie électrique[modifier | modifier le code] Immeuble de l'EECI (Énergie électrique de Côte d'Ivoire) à Abidjan plateau. Essentiellement hydraulique à l’origine, l’électricité produite par la Côte d’Ivoire est par la suite devenue également thermique. Elle est en majeure partie assurée à partir des barrages hydroélectriques d’Ayamé 1, Ayamé 2, Kossou, Taabo, Buyo et Fayé. Alors que le potentiel hydro-électrique total de la Côte d’Ivoire est évalué à 12 400 gWh, l’équipement actuellement disponible ne permet de disposer que de 2 550 gWh (20,56 %). Concourent à la production nationale d’énergie thermique, les centrales de Vridi gaz, la Compagnie ivoirienne de production d’électricité (Ciprel), Azito et d’autres centrales isolées ou autonomes. L’électricité produite par la Côte d’Ivoire en 2005 atteint 5 571,17 gWh, dont 1 397,87 gWh sont exportés vers le Ghana (plus de 50 % des exportations), le Burkina Faso, le Mali et le Bénin41. La gestion de la production et de la distribution de l’électricité relevait au départ de la structure d'État Énergie électrique de Côte d’Ivoire (EECI). Depuis la privatisation de cette gestion au profit de la Compagnie ivoirienne d'électricité (CIE), l’État n’intervient dans le secteur énergie électrique qu’à travers deux structures : la Société de gestion du patrimoine électrique de l’État (SOGEPE) qui gère le patrimoine du secteur et la Société d’opération ivoirienne d’énergie électrique (SOPIE), maître d’œuvre exclusif du secteur énergie électrique42. Malgré les efforts entrepris par l’Institut de recherche des énergies nouvelles (IREN), l’énergie solaire, pour lequel des potentialités importantes ont été relevées, reste encore très peu développée en Côte d’Ivoire42. En février 2010, à la suite d'une mauvaise appréciation des ressources énergétiques, le concessionnaire principal, la CIE, commence à procéder à des délestages au niveau du territoire ivoirien ouvrant une seconde période de crise énergétique en Côte d'Ivoire après celle de 1984. Selon Eddy Simon, alors directeur général de l’Énergie au ministère des Mines et de l’Énergie : « Le système électrique national connaît en ce moment une diminution de sa capacité de production d’énergie électrique qui se traduit par des difficultés à satisfaire l’ensemble des besoins en électricité des populations »43. Ainsi, un programme de délestage temporaire est mis en place, prenant en compte les priorités suivantes : sauvegarder le tissu économique permettant ainsi de préserver les emplois (industries, entreprises) ; assurer l’alimentation des stations de pompage et châteaux d’eau de la SODECI; assurer l’alimentation des centres hospitaliers. Mais on constate que cette crise énergétique gangrène l'économie nationale en provoquant l'arrêt des machines dans l'outil de travail industriel, obligeant les entreprises à mettre en place des programmes de chômage structurels et investir davantage dans l'achat de groupes électrogènes. Au niveau régional, cette crise retarde le projet de l'Uemoa d'interconnexion électrique ouest- africain dont le fournisseur essentiel devait être la Côte d'Ivoire grâce à ses « grandes capacités de production ». Ainsi le secteur ivoirien de l’électricité a commencé à importer de l’énergie du Ghana pour environ 25 MW et ceci, en application du contrat d’échanges d’énergie qui existe entre les deux pays. Puis, une centrale thermique de location de 70 MW sera installée à Vridi pour accroître la capacité de production. Orientations 2012[modifier | modifier le code] La CIE a présenté un plan en 10 points pour s'engager dans la réhabilitation et uploads/Industriel/ eco-ivoire-4.pdf
Documents similaires







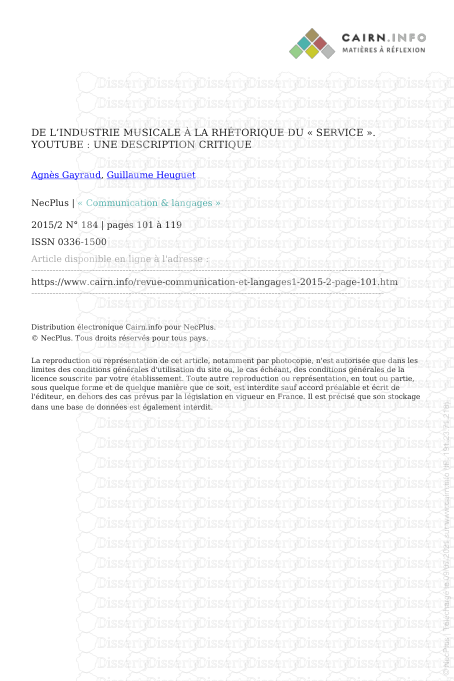


-
34
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 11, 2022
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 0.3209MB


