PLAN D’AFFAIRES EXTENSION DE FERME AQUACOLE DE PRODUCTION D’ALEVINS ET DE POISS
PLAN D’AFFAIRES EXTENSION DE FERME AQUACOLE DE PRODUCTION D’ALEVINS ET DE POISSONS MARCHANDS Page de couverture (avec entête de l’OP, titre du PA, photo spéculation, mois et année) Fiche signalétique du projet Résumé Coût Total du Projet………………= 140 000 000FCFA Apport du Promoteur……………… = 14 000 000FCFA Apport subvention………………….= 70 000 000FCFA Prêt Banque………………………...= 56 000 000FCFA Durée du Projet = 2 ans Lieu d’Intervention du Projet : Commune de Sanankoroba, Cercle de Kati, Région de Koulikoro Sommaire Table de matières Liste des figures Liste des tableaux Liste des abréviations, sigles et acronymes 1. Introduction 1.1. Contexte et justification du projet a a) Aperçu général sur le sous-secteur de la pêche dans l’économie nationale b Le sous-secteur de la pêche constitue un vecteur dans la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et insécurité alimentaire et aussi un pourvoyeur d’emploi. La pêche est la troisième activité économique du monde rural après l’agriculture et élevage et contribue à 4,2 % du PIB, avec la production de poisson de 116 000 t/an (DNP 2019). Le poisson participe à l’atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la production aquacole connait une progression annuelle moyenne de l’ordre de 1000 tonnes selon les données statistiques de la DNP où la production a passé de 2 000 tonnes en 2015 à 7 000 tonnes en 2019. La moyenne de consommation de poisson estimée par la FAO est de à 23 kg/per/an contre 10,5 kg/pers/an au Mali. Le besoin annuel moyen du pays en 2018 était estimé à 414 000 tonnes de poisson contre une production globale (production nationale et importation) de 160 000 tonnes soit un déficit de 254 000 tonnes. Ce déficit peut être comblé par la production aquacole et l’importation. Le Mali dispose trois principales zones de production (le Delta intérieur du Niger, le lac de Sélingué et le lac de Manantali) et de zones secondaires propices à l’aquaculture (Sikasso, Koulikoro et Kayes). Les emplois générés par la filière poisson sont estimés à plus de 1 000 000 de personnes avec une majorité de femmes et de jeunes soit environ 5% de la population active (DNPo 2018). Face à un accroissement de la demande de poisson, et en raison de son rôle économique, social et nutritionnel, l’aquaculture est une alternative durable qui permet de d’augmenter la production de pêche, créer une source de revenus et d’emplois durables dans les zones économiquement déprimées. Malgré son importance et les potentialités existantes, le développement de l’aquaculture et la pêche se heurte à plusieurs difficultés liées à l’approvisionnement régulier en alevins de souches performantes et à moindre coût ; le coût élevé de l’aliment ; l’insuffisance de la maitrise de la technique et de la technologie aquacole ; la baisse de la production halieutique; l’enclavement des zones de production halieutique ; les effets pervers du changement climatique et les tensions sociales. a b) Environnement du projet : b politique c - l’adoption par les Etats membres de l'ONU d’un ensemble de 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) pour mettre fin à la pauvreté, lutter contre les inégalités et l'injustice, et faire face aux changements climatiques d'ici 2030 ; d - la mise en oeuvre de l’engagement présidentiel d’allocation de 15% du budget national au secteur Agricole pour respecter les engagements de Malabo pour la transformation de l’Agriculture Africaine d’ici 2025 ; e - la mise en oeuvre des programmes sous régionaux UEMOA, CEDEAO et CILSS (Priorités Résilience Pays, Déclaration de Dakar sur la relance de l'agriculture irriguée et la Déclaration de Nouakchott sur le pastoralisme) ; - la mise en oeuvre du Programme Communautaire Décennal de Transformation de l’Agriculture pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PCDTASAN) dans l’espace UEMOA (2014-2024) ; - la mise en oeuvre des recommandations des sommets de Paris, de Marrakech, Bonn, Katowice et Madrid (COP21, COP22, COP23, COP 24 et COP 25) sur les changements climatiques ; - la mise en oeuvre de la Politique Nationale de Protection de l’Environnement (PNPE) et les mesures liées à l’intégration de la dimension environnementale et sociale dans toutes les politiques et stratégies de développement du pays, notamment celles portant sur le secteur Agricole ; - La volonté politique du gouvernement d’assouplir les conditions de création et d’installation des entreprises, encourager les investisseurs par l’abaissement des taux des fiscs, le climat favorable des affaires et la disponibilité des institutions financières et des banques à accompagner les porteurs de projet économiquement rentable ; - Des politiques très attractives sont prisent par le gouvernement notamment le Schéma Directeur de la Pêche et de l’Aquaculture, la Politique de Développement de la Pêche et de l’aquaculture. Juridique Plusieurs textes législatifs (Loi N°14-062 du 29/12/2014 déterminant les conditions et les modalités de gestion de la pêche et de l’aquaculture) et le Décret N°18-750 du 24 septembre 2018 portant application de la loi citée ci haut, des arrêtés et des conventions portant les principes de gestion et d’exploitation des ressources halieutiques et aquacoles balisent le cadre de l’activité de pêche et de l’aquaculture. L’installation de ferme aquacole exige une autorisation délivrée par le Ministère ; la réalisation de l’étude d’impact environnementale et sociale ou la notice d’impact et le paiement d’une redevance de 100 000FCFA au profit du Trésor public. Technologique : L’intensification de la production aquacole par l’introduction des nouvelles infrastructures d’aquacultures et des intrants performants dans le système de production de poisson en plus des actions d’aménagements des mares a permis d’augmenter la production de poisson. La production des alevins a évolué de la collecte des sauvageons en milieu naturel à la production intensive dans les écloseries respectivement de 1 000 000 de sauvageons en 2011 à plus de 100 000 000 d’alevins éclos. La densité de mise en charge des infrastructures a évolué de 3 à 5 alevins par mètre à 10 à 100 alevins par mètre. Le rendement de la production aquacole a passé de 1kg /m2 à environ 45kg/m2 suite à l’amélioration de la souche des alevins, l’introduction de l’aliment performant, l’amélioration de la maitrise de la technique de production. Economique Le Mali a adhéré à plusieurs organisations sous régionales (OHADA, OCED) qui sont en train harmoniser les textes des affaires et un assouplissement dans les procédures d’investissement dans les pays membres. Justification du projet de plan d’affaire La production aquacole a passé de 2600 tonnes en 2015 à 7000 tonnes en 2019 suite aux différents efforts de l’Etat et de l’investissement des privés dans le domaine. Le Mali couvre une superficie de 1.241.238km2 et une population estimée en 2017 à environ 18.000.000 habitants, atteindra en 2025 une population de 23.056.362 habitants. Sur la base du besoin alimentaire d’une personne en poisson au Mali estimé à 10,5kg par an, la production prévisionnelle en 2019 devait être de 189.000 tonnes contre une production réelle de 107.000 tonnes soit un déficit de 44%. Récemment la FAO vient de publier que le besoin alimentaire annuel pour une personne est de 23 kg de poisson, ce qui dépasse largement la norme nationale et sur cette base de la FAO, le besoin alimentaire de poisson au Mali est de 414.000 tonnes en 2019 et atteindra 530 000 tonnes en 2025. Le constat est que la production nationale malgré les efforts de l’Etat, des partenaires et des privés, elle tourne autour de 100.000 tonnes représentant 28% des besoins en 2019 et représentera 21% des besoins en 2025. Le pays dispose un potentiel hydrologique important très propice à des activités de pêche et d’aquaculture, crée de l’emploi pour plus de 1 000 000 personnes et apporte dans l’économie plus de 1000 milliards de FCFA en calculant les valeurs ajoutées dans les différents maillons de la filière. Le poisson subit un minimum de trois transactions entre les lieux de production et la consommation, malheureusement l’économie de la filière n’est pas suivie et évaluée. La pêche et l’aquaculture participent à 3,6 du PIB (INSAT 2019). L’importation des poissons augmente chaque année et elle a été de 5000 tonnes en 2015 et de 63 000 tonnes en 2019 (Ministère du Commerce) et fait une concurrence négative à la production nationale par son moindre coût d’achat, ce qui est une perte à gagner pour la production intérieure. Les conséquences de l’insuffisance de la production nationale de poisson de ces dernières années les plus apparentes sont celles liées à l’exode des pêcheurs, les cas d’avitaminoses (iode, calcium), la faiblesse de la fréquentation des structures sociales, l’afflux du marché malien par des poissons importés à bon prix provenant des eaux de mer et ceux de l’aquaculture intensive développée par les pays asiatiques et certains pays africains, la paupérisation des pêcheurs, la naissance des conflits fonciers, etc. L’Etat a adopté des politiques et développé des stratégies pour accroitre la production nationale de poisson dont celle de la technique de la pisciculture, puis l’aquaculture en bassins aquacoles donnant des meilleurs résultats relatifs aux coûts /avantages et une exploitabilité durable. Les acquis actuels de l’aquaculture au Mali sont entre autres (i) l’existence des écloseries modernes autour de Bamako, (ii) l’existence de deux usines de uploads/Industriel/ pa-ferme-aquacole-timbely-02-07-2021-revu-06-08-2021.pdf
Documents similaires





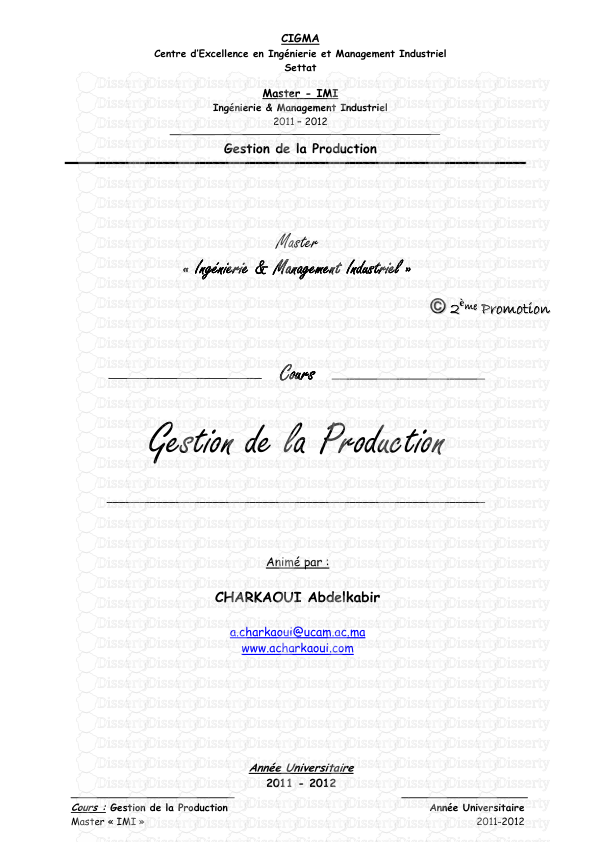




-
54
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 25, 2022
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 0.7153MB


