Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit
Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite. © Techniques de l’Ingénieur, traité Génie mécanique B 599 − 1 Présentation des mécanismes par René BOUDET Professeur à l’École Centrale des Arts et Manufactures 1. Généralités................................................................................................. B 600 - 2 2. Rappels de cinématique......................................................................... — 3 2.1 Champ des vitesses d’un solide................................................................. — 3 2.1.1 Propriété utile...................................................................................... — 3 2.1.2 Point central. Moment central ........................................................... — 3 2.1.3 Mouvements particuliers ................................................................... — 3 2.2 Composition de mouvements .................................................................... — 3 3. Liaisons....................................................................................................... — 5 3.1 Généralités ................................................................................................... — 5 3.2 Liaison pivot ou rotoïde .............................................................................. — 5 3.2.1 Définition et schéma........................................................................... — 5 3.2.2 Réalisations......................................................................................... — 5 3.3 Liaison glissière ........................................................................................... — 5 3.3.1 Schéma................................................................................................ — 5 3.3.2 Réalisation........................................................................................... — 7 3.4 Liaison glissière hélicoïdale........................................................................ — 7 3.4.1 Schéma................................................................................................ — 7 3.4.2 Réalisations......................................................................................... — 8 3.4.3 Remarque............................................................................................ — 8 3.5 Liaison pivot glissant................................................................................... — 8 3.5.1 Schéma................................................................................................ — 8 3.5.2 Réalisations......................................................................................... — 8 3.6 Liaison rotule ............................................................................................... — 8 3.6.1 Schéma................................................................................................ — 8 3.6.2 Réalisations......................................................................................... — 9 3.7 Liaison plane................................................................................................ — 9 3.7.1 Schéma................................................................................................ — 9 3.7.2 Réalisations......................................................................................... — 9 3.8 Liaison linéaire rectiligne............................................................................ — 9 3.8.1 Schéma................................................................................................ — 9 3.8.2 Réalisations......................................................................................... — 9 3.9 Liaison linéaire annulaire............................................................................ — 10 3.9.1 Schéma................................................................................................ — 10 3.9.2 Réalisations......................................................................................... — 10 3.10 Liaison ponctuelle....................................................................................... — 10 3.10.1 Schéma.............................................................................................. — 10 3.10.2 Réalisation......................................................................................... — 10 4. Test cinématiquement admissible ...................................................... — 10 4.1 Schéma de principe..................................................................................... — 10 4.2 Mécanisme à fermeture de chaîne simple ................................................ — 10 4.2.1 Définition............................................................................................. — 10 4.2.2 Principe de l’étude.............................................................................. — 11 4.2.3 Exemple............................................................................................... — 11 4.3 Mécanisme à fermeture de chaîne composée .......................................... — 12 4.3.1 Définition............................................................................................. — 12 4.3.2 Exemple............................................................................................... — 12 4.3.3 Méthode .............................................................................................. — 12 5. Mobilité de deux pièces liées par des contacts ponctuels .......... — 13 5.1 Problème ...................................................................................................... — 13 5.2 Rappels......................................................................................................... — 13 5.3 Rang d’un système de normales de contact ............................................. — 13 5.4 Mouvement autorisé ................................................................................... — 13 Références bibliographiques ......................................................................... — 14 PRÉSENTATION DES MÉCANISMES ________________________________________________________________________________________________________ Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite. B 599 − 2 © Techniques de l’Ingénieur, traité Génie mécanique es notions présentées dans la rubrique Organes de machines ont pour but de familiariser les lecteurs à certains problèmes techniques qu’ils ont à résoudre en leur présentant les fonctions du génie mécanique, en leur proposant des méthodes d’investigation et en leur suggérant des idées de solutions. Dans le présent article, nous allons nous préoccuper de mécanismes qui se distinguent des machines car ils ne font référence qu’à une seule forme d’énergie. Dans une machine (par exemple un moteur à explosion), un ou plusieurs mécanismes inter- viennent (système d’embiellage). L 1. Généralités L’énergie que nous étudions étant mécanique, deux éléments sont à considérer : — le mouvement ; — les efforts. Un mécanisme modifiant un de ces éléments agit nécessairement sur les valeurs de l’autre car, au rendement près, nous avons conservation de l’énergie. Cela justifie l’organigramme proposé (figure 1) que nous allons commenter. Un projet de réalisation correspond à une finalité appelée fonction globale ; il s’agit par exemple de transformer un mouvement de rotation continue en translation alternative. Notre culture technique ou notre imagination nous permet de mettre en place un schéma de principe où ne sont précisées que les liaisons (ou mouvements relatifs des différentes pièces) représentées suivant les conventions qui suivront. Il s’agit alors de tester la validité d’un tel schéma c’est-à-dire : l’idée de réalisation suivant le principe évoqué est-elle à retenir ou à proscrire ? Entraînera-t-elle une fabrication délicate avec des intervalles de tolérance très faibles, ou aisée ? Notations et Symboles Symbole Définition (S/ R) vecteur taux de rotation du solide S par rapport au repère R (O ∈ S/ R) vecteur vitesse du point O du solide S dans le mouvement par rapport au repère R torseur distributeur des vitesses du solide S par rapport au repère R µ pas du torseur S/R mouvement du solide S par rapport au repère R {Ac 1 → 2} torseur d’action de liaison de S1 sur S2 composantes sur les axes x, y, z du vecteur taux de rotation composantes sur les axes x, y, z du vecteur vitesse X21 , Y21 , Z21 composantes sur les axes x, y, z de la coordonnée somme (ou résultante) de l’action de liaison de S2 sur S1 L21 , M21 , N21 composantes sur les axes x, y, z de la coordonnée moment de l’action de S2 sur S1 r rang du système d’équations traduisant la fermeture de la chaîne cinématique p nombre d’inconnues cinématiques recensées dans la chaîne Ω V tc S/ R} { ω21x , ω21y , ω21z V21x , V21y , V21z Figure 1 – Organigramme d’étude d’une réalisation _______________________________________________________________________________________________________ PRÉSENTATION DES MÉCANISMES Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite. © Techniques de l’Ingénieur, traité Génie mécanique B 599 − 3 Si l’idée est retenue, le schéma est alors étoffé, les distances entre les différents axes sont chiffrées en exploitant des conditions d’encombrement, la puissance transmise est prise en compte, il s’agit alors de tester l’aptitude au choix des composants dans les catalogues des fabricants. Ce choix implique la connaissance des vitesses relatives (test cinématiquement admissible) et des charges ou forces appliquées aux liaisons appelées torseurs d’action de liaison. C’est le test statiquement admissible formulé comme il suit : pouvons-nous déterminer toutes les composantes des torseurs d’action de liaison ? Cela fait l’objet de l’article Études interefforts. Modification des comportements de liaison [B 600] dans ce traité. Si la réponse est favorable, la phase de dessin du dispositif peut débuter ; dans le cas contraire deux attitudes sont pensables : — nous modifions le schéma de principe de sorte que les réponses aux tests précédemment évoqués soient favorables (cf. article Études interefforts. Modification des comportements de liaison [B 600]) ; — nous retenons la fabrication du dispositif suivant le principe précédemment évoqué, en sachant que la fabrication et le montage seront délicats, ce qui influera sur le prix ; en contrepartie, avec des précautions à préciser, nous obtiendrons une qualité géométrique remarquable lors du fonctionnement (cas du montage des broches de machine-outil, par exemple). 2. Rappels de cinématique 2.1 Champ des vitesses d’un solide Il a été montré (cf. article Mécanique générale. Cinématique générale [A 1 661]) que les vitesses de deux points O et M d’un solide sont telles que : on aurait pu dire qu’au mouvement du solide S par rapport au repère R on associe un torseur distributeur des vitesses et convenir des notations : • S/R mouvement de S par rapport à R ; • torseur distributeur des vitesses associé au mouve- ment du solide S par rapport au repère R. Ce torseur est caractérisé par deux coordonnées : : vecteur rotation ou taux de rotation, qui est la coordonnée somme, , que nous noterons (O ∈ S/ R), qui est le vecteur vitesse de O qui appartient à S dans le mouvement par rapport à R et qui est la coordonnée moment du torseur. On retiendra l’association : 2.1.1 Propriété utile il suffit d’exploiter la relation : Cela entraîne que : est indépendant du point M du solide ; on l’appellera le pas du torseur. 2.1.2 Point central. Moment central Un point P est point central si la coordonnée somme et la coordonnée moment sont proportionnelles. Cette condition peut se traduire par : Il est facile de montrer alors que : l’ensemble des points centraux constitue l’axe central, aussi appelé axe de rotation ou de viration (cf. article Mécanique générale. Cinématique générale [A 1 661] dans le traité Sciences fondamentales). I Conséquence : la relation : peut aussi s’écrire : ou encore . 2.1.3 Mouvements particuliers 2.1.3.1 Mouvement de rotation autour d’un axe fixe C’est le cas d’un arbre monté sur paliers (figure 2) que l’on modé- lise, conformément à la figure 3. L’axe x’ x de la liaison correspond à l’axe central du torseur distributeur des vitesses de S1 par rapport à S0 . On a avec vecteur unitaire de l’axe x. 2.1.3.2 Mouvement de translation C’est le cas du mouvement de tables de machines-outils par rapport à leurs bâtis. Ces mouvements sont bien souvent réalisés par l’emploi de glissières (§ 3.3) ; les trajectoires sont alors rectilignes et nous les représentons symboliquement sur la figure 4. Tous les points de S1 ont même vitesse par rapport à S0 . Pour tout point M : avec vecteur unitaire de l’axe x. 2.2 Composition de mouvements La composition de mouvements correspond à un souci cartésien qui consiste à fractionner une difficulté en difficultés élémentaires. On peut montrer que tout mouvement de solide par rapport à un repère peut être considéré comme résultant d’un mouvement de translation et d’un mouvement de rotation dont la position de l’axe V R ( ) MS ( ) V R ( ) OS ( ) Ω OSMS ∧ + = tc S/R { } ω S uploads/Industriel/ presentation-des-mecanismes-rene-boudet.pdf
Documents similaires

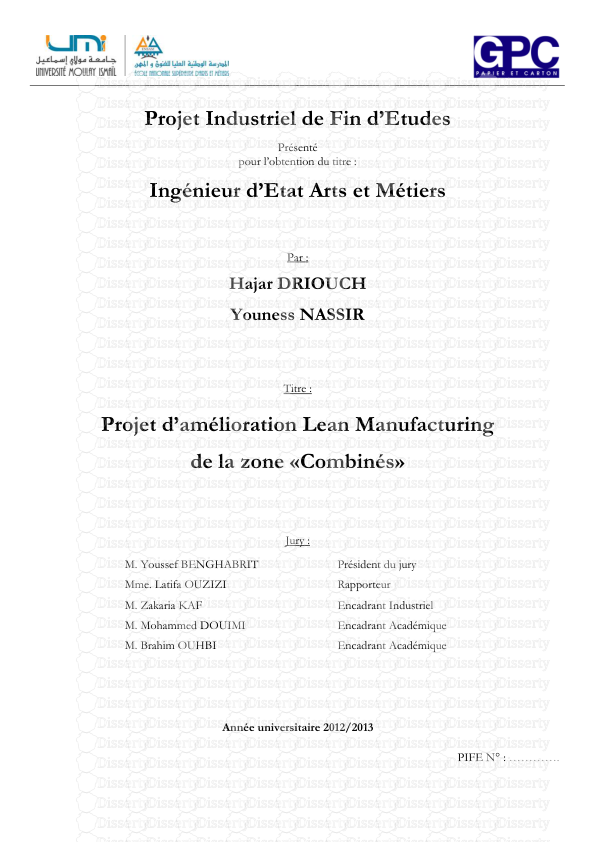








-
71
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 24, 2022
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 0.7978MB


