REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’EDUCATION NATION
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL SECONDAIRE TECHNIQUE Français PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 1 MARS 2006 SOMMAIRE Préambule I. La démarche pédagogique du projet I .1. Le déroulement du projet………………………………………………………3 I.1.1. La phase de conception (niveau pré-pédagogique) …………………..3 - L’évaluation diagnostique I.1.2. La phase de réalisation (niveau pédagogique) ………………………..4 a. Les activités b. Les exercices c. L’évaluation formative I.1.3. L’évaluation certificative ……………………………………………..6 a. Les défauts de l’évaluation classique et ses limites b. La situation cible (ou situation d’évaluation) II. La construction d’un questionnaire d’évaluation II.1. Les items à réponses choisies ……………..…………………………………...7 II.2. Les items à réponses construites ……………………………………………....8 II.3. La notation …………………………………………………………………....9 II.4. Les grilles d’évaluation …..……………………………………………….….10 III. Les domaines d’apprentissage III.1. L’écrit …………………………………………………..……………………16 III.1.1. La compréhension de l’écrit…………………………………. 16 - L’approche des textes III.1.2. La production de l’écrit ………………………………………………20 III.2. L’oral………………………………………………………………………….21 III.2.1. Compréhension de messages oraux…………………………………...22 III.2.2. Production de messages oraux III.3. Comment aborder la grammaire au secondaire ?...............................................23 IV. Les objets d’étude IV.1. Le discours objectivé .…………………………………………………………26 IV.2. Le discours théâtral…………………….………………………………………28 IV.3. Le plaidoyer et le réquisitoire…..………………………………………………30 IV.4. La nouvelle d’anticipation......................………………………………………35 IV.5. Le reportage touristique/le récit de voyages……………………………………38 IV.6. Le fait poétique (rappel) ………………………………………………………..39 V. Les techniques d’expression écrites et orales V.1. La prise de notes ………………………………………………………………40 V.2. Le compte-rendu et le résumé ……………………………………….................41 V.3. L’exposé oral ….………………………………………….…………………….48 V.4..Le dossier documentaire……………………….….……………………..……...49 Glossaire……………………………………………………………….……………….……51 Bibliographie ....…………………………………………………………………………… 56 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 2 Document d’accompagnement Préambule Ce document est destiné aux professeurs du cycle secondaire. Il a pour visée de leur offrir une lecture fonctionnelle du nouveau programme pour les aider à le mettre en œuvre. Le nouveau programme poursuit des objectifs qui dépassent le cadre de la classification typologique des textes et accorde une grande importance à la linguistique de l’énonciation qui pose comme préalable qu’il faut distinguer ce qui est dit (contenu du texte) de la présence de l’énonciateur dans son propre discours. Il s’inscrit dans une logique de projet pédagogique et vise l’installation de compétences par des activités variées qui permettront aux apprenants de s’approprier les règles régissant les différents discours et les enjeux qui les sous-tendent. I. La démarche pédagogique : Le projet considéré dans sa globalité, constitue l’organisateur didactique d’un ensemble d’activités. Il est organisé en séquences, ayant une cohérence interne et des intentions pédagogiques. Le projet permet d’installer une ou plusieurs compétences définies dans le programme. Il permet aussi de passer d’une logique d’enseignement à une logique d’apprentissage. • En entreprenant une démarche de projet le professeur accepte : - de tenir compte des besoins et des intérêts des apprenants, - de négocier avec les apprenants les objectifs et les moyens, - d’agir comme médiateur et non comme dispensateur de savoir. • L’apprenant impliqué dans un projet est un partenaire actif dans le processus de son apprentissage. Il « apprend à apprendre » par une recherche personnelle. PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 3 I .1. Déroulement du projet : La démarche pédagogique du projet se déroule en deux phases : conception et réalisation. I.1.1. La phase de conception (niveau pré-pédagogique) : L’apprentissage s’articule sur des objectifs cognitifs, socioculturels et socio affectifs. Pour que l’apprenant s’implique dans son apprentissage, il faut qu’il y adhère. Il devient donc nécessaire de négocier avec les apprenants l’intitulé du projet, sa thématique et la forme que ce projet doit prendre. Quand un apprenant aborde un nouvel apprentissage, il est déjà porteur de représentations* et de capacités (ensemble de savoirs et de savoir-faire) que l’action pédagogique doit s’efforcer de faire émerger par une évaluation diagnostique. Evaluer c’est identifier, déterminer et définir les lacunes des apprenants pour y remédier. C’est aussi déceler leurs capacités pour les développer et les améliorer. L’évaluation s’inscrira dans un processus. L’évaluation diagnostique : Comme toute évaluation, l’évaluation diagnostique est un processus de mesure, de jugement puis de décision. Les résultats obtenus doivent permettre au professeur d’opérer les régulations adéquates relatives au plan de formation initialement prévu. Au niveau de l’évaluation diagnostique, il faut pouvoir identifier par rapport à l’acquisition d’une compétence les savoir-faire sur lesquels on peut s’appuyer et le niveau des apprenants. Le moyen le mieux indiqué pour récolter les informations est le pré-test. Ce dernier met l’apprenant en face d’une situation problème dans laquelle il mobilisera ses acquis antérieurs mais ces derniers ne lui permettront pas de la résoudre complètement. De ce fait, la situation provoquera un conflit cognitif (condition nécessaire de l’apprentissage). Ainsi, en se représentant la compétence visée (l’enjeu de la formation) l’apprenant est amené à mieux mobiliser ses acquis. Le pré-test devra être conservé par les apprenants pour être amélioré au fur et à mesure des apprentissages. * vision du monde et connaissances intellectuelles. PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 4 I.1.2. La phase de réalisation (niveau pédagogique) Pour permettre la réalisation du projet, l’enseignant choisira les méthodes et les stratégies, les supports, la progression, les activités et les exercices ainsi que les techniques d’expression adéquates. Ce choix se fera en fonction des besoins exprimés par les apprenants pendant le déroulement du projet ou inférés par le professeur à partir de leurs productions en classe. Il organisera ainsi des situations d’apprentissage qui doivent répondre aux caractéristiques suivantes : partir des ressources personnelles de l’apprenant et stimuler ses structures cognitives pour lui permettre d’aller au plus loin de ses possibilités d’acquisition. Pour ce faire, l’enseignement apprentissage s’organisera en séquences. Chaque séquence est organisée autour d’un savoir faire à maîtriser (un niveau de compétence). Elle peut s’étendre sur une dizaine d’heures. Elle intégrera : - les activités relatives aux domaines de l’oral et de l’écrit pour analyser des aspects du discours à étudier, - des moments de manipulation des structures syntaxiques et lexicales, - des moments d’évaluation formative. a- Les activités : Elles doivent permettre à l’ensemble des apprenants de s’impliquer dans un contexte nouveau en s’appuyant sur leurs acquis et de travailler en groupe, quand c’est nécessaire. Elles doivent aussi être synthétiques c'est-à-dire qu’elles doivent requérir l’ensemble des acquis et des capacités et non la seule mise en œuvre d’automatismes. b - Les exercices : Des moments de la classe seront consacrés à la correction des exercices. Ces derniers doivent installer des automatismes nécessaires à l’atteinte d’un certain degré de maîtrise du code. L’exercice est alors axé sur une difficulté particulière (ex : lexique, syntaxe, ponctuation….) mettant en œuvre une aptitude spécifique. c- L’évaluation formative : Elle intervient au fur et à mesure que le processus d’apprentissage se déroule. Elle permettra de comparer les performances de l’apprenant aux objectifs assignés à l’apprentissage et d’apporter des régulations si cela s’avère nécessaire. L’évaluation formative prend une place centrale dans le processus d’enseignement. Elle facilite la gestion du projet et l’adéquation entre les visées et les stratégies utilisées. PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 5 Lors de l’évaluation formative, on cherche avant tout à comprendre le fonctionnement cognitif de l’apprenant en difficulté face à la tâche proposée. (cf. métacognition). Dans cette optique, les erreurs commises ne doivent plus être considérées comme des productions déviantes mais comme des indices de l’état d’apprentissage. Elles deviennent un objet d‘étude particulier dans la mesure où elles sont révélatrices de la nature des représentations de l’apprenant et de ses stratégies. Pour comprendre l’origine de l’erreur, on cherchera à formuler des hypothèses relatives aux interactions entre les caractéristiques de l’apprenant et celles de la tâche pour expliquer les difficultés de l’apprenant et l’aider à construire une stratégie plus adéquate. Cela se fera par : - des travaux individuels, - des interactions apprenant-professeur où ce dernier cherchera par un jeu de questions à favoriser une re-structuration des démarches d’apprentissage, - des travaux en petits groupes où l’interaction entre des apprenants à des stades d’apprentissage différents pourra susciter une progression (des apprenants en difficultés)* ou une consolidation des démarches d’apprentissage (des apprenants plus avancés). Ainsi l’évaluation est également l’occasion de développer des pratiques d’auto-évaluation et de co-évaluation et ainsi de développer des capacités sociales et affectives. Pour les activités de production, il est nécessaire d’outiller l’apprenant en mettant à sa disposition des grilles d’évaluation critériée. Quand les conditions le permettent, une pédagogie différenciée doit découler des résultats fournis par l’évaluation formative. Cette pédagogie prend en charge la disparité des niveaux par une différenciation des activités, des méthodes ou des rythmes. Concernant l’évaluation des attitudes, l’enseignant utilisera des grilles d’observation qui cibleront très précisément le comportement à observer. (cf. grille page suivante). PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 6 Exemple de grille d’observation du travail de groupe à l’usage de l’enseignant : Critères d’observation Indicateurs Oui Non Fonctionnement du groupe 1. Le groupe a-t-il planifié son activité ? 2. Le groupe a-t-il géré le temps de réalisation de l’activité ? 3. Le groupe a-t-il mobilisé ses connaissances en fonction de l’activité ? 4. Le groupe a-t-il pris des initiatives ? Interaction dans le groupe 1. Chaque apprenant a-t-il négocié son rôle dans le groupe ? 2. Chaque apprenant a-t-il coopéré et partagé des connaissances avec le groupe ? 3. Chaque apprenant a-t-il accepté uploads/Ingenierie_Lourd/ acc-2as-francais.pdf
Documents similaires





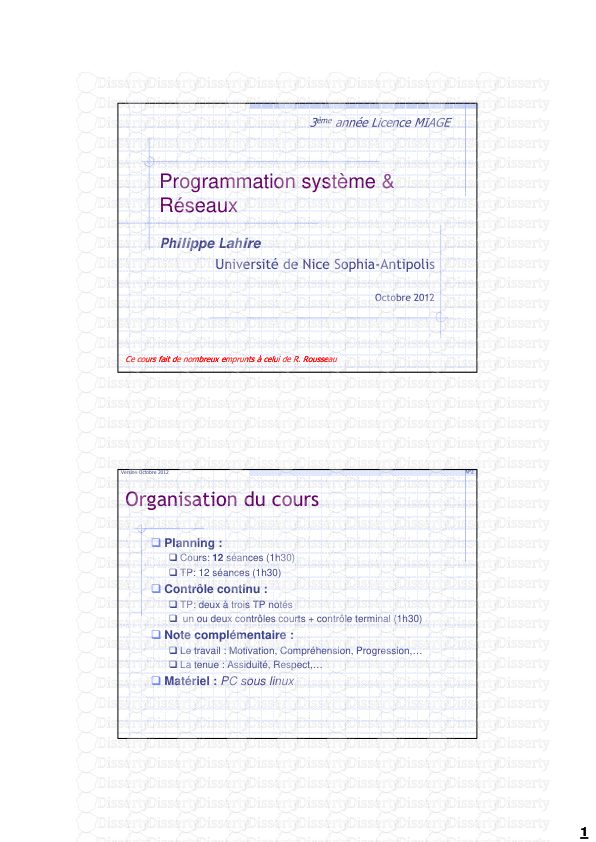




-
93
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 12, 2021
- Catégorie Heavy Engineering/...
- Langue French
- Taille du fichier 0.4496MB


