1 I. Au cœur de Paris, le « I. Au cœur de Paris, le « I. Au cœur de Paris, le «
1 I. Au cœur de Paris, le « I. Au cœur de Paris, le « I. Au cœur de Paris, le « I. Au cœur de Paris, le « Centre Beaubourg Centre Beaubourg Centre Beaubourg Centre Beaubourg » » » » 1. Où se trouve le bâtiment 1. Où se trouve le bâtiment 1. Où se trouve le bâtiment 1. Où se trouve le bâtiment ? ? ? ? Au cœur de Paris Le bâtiment se situe au cœur de Paris, entre le quartier du Marais, l’île de la Cité et le quartier des Halles. On appelle cet emplacement le plateau Beaubourg. En 1960, c’est un terrain vague qui sert de parking. Mais il n’en a pas toujours été ainsi. Un peu de géographie… rivière et marais Le nom de Marais, donné au quartier s’étalant à l’est du Centre Pompidou, rappelle le site naturel et ses terres marécageuses régulièrement inondées par la Seine. Quelques buttes, suffisamment élevées pour échapper aux crues, et le drainage des marais pour l'agriculture ont permis à l'homme de s'installer ici. Le nom de Beaubourg vient d'ailleurs d'un ancien village, le Beau-Bourg, qui existait au Moyen-âge. Un peu d’histoire… le développement de la ville Peu de traces subsistent aujourd’hui du site naturel. Il a en effet été depuis longtemps conquis et modelé par l’homme. Installée d'abord sur la rive gauche de la Seine, au niveau de la rue Saint-Jacques, la ville de Paris, au fil des siècles, s’est étendue de tous côtés. Sa croissance a été peu maîtrisée et dans le courant du XIXe siècle il apparaît nécessaire d’y « mettre de l’ordre », d’améliorer les circulations et de construire des immeubles neufs. Ce sont les « travaux d'Haussmann » Des « îlots insalubres » sont identifiés un peu partout dans la ville. Caractérisées par les mauvaises conditions de vie qui y règnent, ces zones urbaines devront être démolies pour laisser place à de nouvelles constructions plus aérées, disposant de l’eau courante et d’un système d’évacuation des eaux usées. En savoir plus : « Les travaux d'Haussmann » Entre 1853 et 1870, sous le second Empire, le baron Haussmann, préfet de la Seine, 2 entreprend un grand programme de transformation de Paris. De grands boulevards sont percés pour désengorger le centre-ville (par exemple le boulevard Sébastopol), de nouveaux immeubles sont bâtis, 600 km d'égouts sont creusés, plusieurs gares et monuments, dont les Halles, sont construits, de grands parcs sont créés (par exemple celui des Buttes- Chaumont). 2. De « 2. De « 2. De « 2. De « l l l l’ ’ ’ ’îlot insalubre n°1 îlot insalubre n°1 îlot insalubre n°1 îlot insalubre n°1 » au « » au « » au « » au « Centre Beaubourg Centre Beaubourg Centre Beaubourg Centre Beaubourg » » » » L’îlot insalubre n° 1 Au XIXe siècle, le quartier de Beaubourg est très peuplé. Les habitants y vivent entassés dans des logements misérables. Les petites ruelles où coulent les eaux usées apportent peu d’air et de lumière. Les épidémies se développent. Ce quartier est identifié comme l’« îlot insalubre n° 1 », celui du cœur de Paris. C’est ici que, près d’un siècle plus tard sera construit le Centre Georges Pompidou. Le terrain vague En attendant, il reste un espace oublié. Les démolitions ne commencent en effet que dans les années 1930, et rien n’est reconstruit dans l’immédiat. Pendant plus de trente ans encore, ce site en plein cœur de la capitale française, inscrit dans un quartier historique, entre la cathédrale Notre-Dame, la tour médiévale de l'ancienne église Saint-Jacques et les hôtels particuliers du Marais, n'est pas construit. Il sert finalement de parking aux usagers des Halles qui, situées juste à côté, approvisionnent en produits frais les commerçants de tout le bassin parisien. Un centre national d’art et de culture Dans les années 1960, un siècle après les grands travaux d'Haussmann, une nouvelle série de transformations a lieu, pour adapter la ville à l’évolution de la société et réaménager son espace en fonction des nouveaux besoins. C’est dans ce contexte que le président de la République française Georges Pompidou décide de la création d’un centre national d’art et de culture. L’emplacement de l’ancien îlot insalubre devenu terrain vague puis parking, est choisi pour accueillir le futur bâtiment. Sa localisation en plein cœur de la métropole en fait un lieu privilégié pour un projet qui devra rayonner dans la France entière et dans le monde. En savoir plus : « Les travaux des années 1960 » Dans les années 1960, un siècle après les travaux d'Haussmann, l'agglomération parisienne connaît de nouveaux grands chantiers. Des voies rapides pour les voitures sont créées dans la ville, le périphérique est construit tout autour, le RER (Réseau Express Régional) fait son apparition. La ville est aussi dotée d'un grand centre d'affaires et financier : la Défense, avec ses hautes tours de béton. De grands ensembles de logement sont érigés et des villes nouvelles sont bâties. En 1969, les Halles sont déplacées à Rungis. Un grand centre commercial sera construit à leur place, au-dessus de la gare de RER. Le visage de la capitale française change une fois encore de façon radicale. 3 3. Quel bâtiment pour le « 3. Quel bâtiment pour le « 3. Quel bâtiment pour le « 3. Quel bâtiment pour le « Centre Beaubourg Centre Beaubourg Centre Beaubourg Centre Beaubourg » » » » ? ? ? ? Le programme « Je voudrai passionnément que Paris possède un centre culturel (…) qui soit à la fois un musée et un centre de création, où les arts plastiques voisineraient avec la musique, le cinéma, les livres, la recherche audio-visuelle, etc. Le musée ne peut être que d’art moderne, puisque nous avons le Louvre. La création, évidemment, serait moderne et évoluerait sans cesse. La bibliothèque attirerait des milliers de lecteurs qui du même coup seraient mis en contact avec les arts. » C’est en ces termes que Georges Pompidou décrit le projet, lancé dès 1969, de ce qui deviendra le Centre Georges Pompidou. Les institutions qu'il doit accueillir sont : le Musée national d'art moderne et le Centre de création industrielle (qui seront par la suite regroupés), l’Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique et la Bibliothèque publique d'information. Le concours Un grand concours international d'architecture est organisé en 1971. 681 équipes d’architectes originaires du monde entier y participent et envoient leurs projets. Toutes les formes de bâtiment sont envisagées, des plus classiques aux plus originales. Les projets sont soumis à un jury qui devra tout examiner avant de désigner l’équipe à laquelle la construction de cet important bâtiment sera confiée. En savoir plus : « Les concours d’architecture » Le concours pour la construction du Centre Pompidou a été un des principaux concours d'architecture organisés en France. Depuis les trente dernières années, plusieurs concours internationaux d'architecture ont été lancés par le gouvernement français. Ont ainsi été construits à Paris : Le Parc de La Villette. Concours gagné en 1982 par Bernard Tschumi (France / USA). Construction : 1982 -1998. La Grande Arche de la Défense. Concours gagné en 1983 par Johan Otto von Spreckelsen (Danemark). Inauguration : 1989. La Bibliothèque Nationale de France. Concours gagné en 1989 par Dominique Perrault (France). Inauguration : 1995. Le Musée du Quai Branly. Concours gagné en 1999 par Jean Nouvel (France). Inauguration : 2006. Le choix du jury Présidé par Jean Prouvé, le jury désigne comme lauréate l'équipe de deux jeunes architectes : Renzo Piano et Richard Rogers (projet n° 493). L’un est italien, l’autre anglais. Associés depuis peu, ils ont une trentaine d’années et ont encore peu construit. Le choix du jury surprend, jusqu'aux gagnants eux-mêmes. L’architecture du projet de Piano et Rogers semble très provocatrice, surtout pour le cœur de Paris. Dès 1971, l’équipe se plonge dans la deuxième phase, qui est celle de l’élaboration du projet final, avant la construction. Le projet revu, avec quelques adaptations, reste entièrement fidèle aux lignes directrices du premier projet. 4 II. Comment ça tient II. Comment ça tient II. Comment ça tient II. Comment ça tient ? Comment ça ? Comment ça ? Comment ça ? Comment ça fonctionne fonctionne fonctionne fonctionne ? ? ? ? 1. Les grandes lignes du projet Piano/Rogers 1. Les grandes lignes du projet Piano/Rogers 1. Les grandes lignes du projet Piano/Rogers 1. Les grandes lignes du projet Piano/Rogers L’équipe et le projet Autour de Renzo Piano et Richard Rogers, toute une équipe travaille à la réalisation du projet. Parmi les collaborateurs figurent d'autres architectes et les ingénieurs du bureau Ove Arup and Partners. Le projet relève les deux principaux défis du programme : faire cohabiter différentes activités dans un même bâtiment, en rendant possibles les relations et les échanges entre celles-ci ; favoriser la rencontre avec le public, en faisant de ce centre d'art et de culture un lieu de vie. En savoir plus : « Renzo Piano et Richard Rogers » Renzo Piano est né en 1937 à Gènes, Italie. Il est diplômé de l'école d'architecture de uploads/Ingenierie_Lourd/ architecture-du-centre-pompidou.pdf
Documents similaires


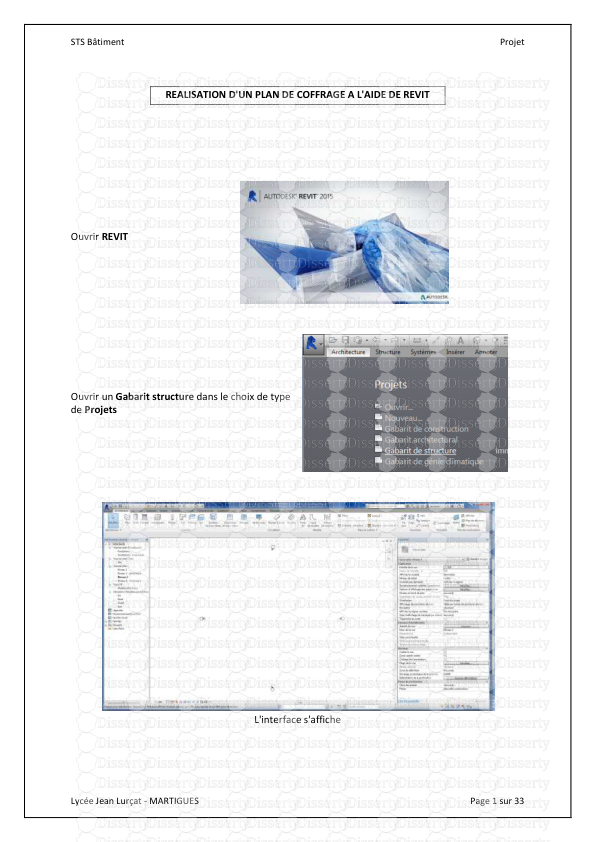







-
38
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 26, 2022
- Catégorie Heavy Engineering/...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1329MB


