Tradition et spontanéité Alors que l’architecture se situe, par essence, compte
Tradition et spontanéité Alors que l’architecture se situe, par essence, compte tenu de la durée de vie des bâtiments et de l’inertie de leur mise en œuvre, aux antipodes de l’instantanéité de l’information et du caractère éphémère de la mode, elle se trouve aujourd’hui de plus en plus soumise à la logique du spectacle marchand post- moderne. Les architectes qui ont accepté ce devenir prétendent que c’est en utilisant les moyens de l’ennemi qu’on pourra le battre ou, au moins, continuer d’exister. Et il serait tellement regrettable de ne pas vivre avec son Tradition Cette conception de l’histoire et de la production architecturales continue plus que jamais d’avoir cours, car elle entre désormais en synergie avec la conception marchande du monde qui domine tous les secteurs de l’activité humaine. Le marché, et la notion de croissance infinie qui le sous-tend, se nourrissent de la nouveauté en soi. Les produits ne sont plus conçus pour atteindre le meilleur niveau d’accomplissement et la plus grande pérennité, mais pour être remplacés le plus rapidement possible sous la double impulsion de leur obsolescence programmée, et de la mode, véhiculée par la publicité. Productions industrielle et culturelle de masse fonctionnent dorénavant suivant ce même modèle, qui se trouve encore renforcé par l’échange d’informations en temps réel autorisé par les nouvelles technologies. Dans ce flot ininterrompu et non hiérarchisé d’informations, l’outrance et la surenchère sont la règle, puisqu’elles sont les seuls moyens d’exister. Le spectacle règne, la représentation des choses tend à supplanter les choses elle-mêmes qui, de fait, deviennent chaque jour plus virtuelles, non parce qu’elles ont cessé d’exister physiquement, mais parce que leur présence matérielle n’est plus leur principale manière d’exister. L’architecture consiste à animer les constructions, à leur donner une âme pour inscrire dans leur matière inerte un souffle vital qui en fera des lieux habités. Cette tâche n’a rien à voir avec les questions de la nouveauté formelle ou du style. Or, les avant- gardes artistiques et architecturales du début du XXe siècle, dont le discours a informé, et continue à bien des égards d’informer le rapport des architectes au monde, ont élevé la nouveauté au-dessus de toute autre valeur. Et avec la nouveauté, l’idée que toute création, pour être authentique, implique la rupture avec le passé et la tradition. Spectacle Friedrich Nietzsche. “ A l’égard des artistes de toute espèce, je me sers désormais de cette distinction fondamentale : est-ce en l’occurrence la haine contre la vie ou le surplus de vie qui est devenu créateur ? ” © Eric Lapierre, pour la Maison de l’architecture de Picardie, septembre 2006 Ce n’est donc pas en accumulant les “ tics ” stylistiques personnels, mais bien plutôt en essayant d’être le plus général possible, que l’on parvient à la véritable expression : ce ne sont pas ses manies personnelles que doit exprimer l’architecte, c’est l’architecture elle-même en tant qu’ensemble de concepts opératoires. Et la part irréductible et incontrôlable d’expression personnelle qui survivra à ce dessein constitue la manière singulière et spontanée de chaque artiste de creuser une langue étrangère dans le langage commun de sa discipline. L’architecture du spectacle accepte de se placer sur un même plan que l’ensemble des images toujours plus outrancières produites par le monde contemporain. Dans ces conditions, seul le choc qu’elle peut provoquer sur un spectateur chaque jour plus blasé et à la sensibilité plus émoussée par la brutalité des médias de masse, peut lui permettre d’exister. Mais le choc est par définition passager, et la sidération qu’il provoque annihile toute capacité d’action et de réflexion du spectateur. L’inscription dans la tradition permet au contraire, par les décalages que les nouveaux bâtiments opèrent par rapport aux anciens, par les nouvelles interprétations qu’ils donnent de problèmes permanents, de résister au monde du spectacle, en mettant en place un système de signification subtil qui n’est soumis ni à la surenchère ni à la fuite en avant. L’architecture est constituée d’un ensemble de traditions qui se rapportent tant à des manières de faire localisées géographiquement, qu’à des ensembles de concepts. La modernité a rangé la tradition au rayon des vieux outils obsolètes et aliénants. Pourtant, s’inscrire dans une tradition ne consiste pas à reproduire stérilement un ensemble de formes surannées, mais bien plutôt à réinventer en permanence une culture singulière, constituée de l’ensemble des expériences menées dans le même champ par d’autres architectes, parfois depuis des siècles. S’inscrire dans une tradition n’implique pas un respect servile, mais exige au contraire de la réinventer en permanence pour la redéfinir et la maintenir vivante. Celui qui s’inscrit dans une tradition refuse l’idée simpliste d’une œuvre originale créée ex nihilo, et s’inscrit avec profit dans le processus de sédimentation des expériences menées par ses devanciers. Ainsi, à l’image de tel temple shinto reconstruit à neuf régulièrement toutes les deux ou trois décennies depuis huit siècles, et qui accumule donc l’attention, le savoir, et la qualité issue d’incessantes améliorations, de quarante générations mises au service d’un même objet, l’inscription dans la tradition permet de faire exister l’architecture en tant que discipline savante capable de produire des objets d’une telle complexité et d’un tel niveau d’accomplissement qu’ils nous permettent d’engager une relation au monde singulière et perpétuellement renouvelée. Ainsi peut-on atteindre une des dimensions essentielles de l’architecture : créer des objets qui se réfèrent, à la fois, à une expérience commune du monde, et à une expression singulière. En étant intégrée à la logique du spectacle l’architecture se trouve naturellement coupée de sa propre tradition, et se condamne à se réinventer à partir de rien, sinon des lois du marché et de l’air du temps le plus volatil. temps… C’est ainsi que le post-modernisme est devenu le mouvement architectural dominant, tant dans le champ de la production ordinaire la plus vulgaire que dans celui de la production savante d’avant-garde la plus reconnue. Partout dans le monde se développent les mêmes types de formes morbides, sans matière et sans vie, toutes identiques à force de poursuivre avec la même frénésie nouveauté et diversité. précédent suivant Mettre en œuvre cette poétique singulière ne relève que partiellement de la connaissance, et procède pour une part essentielle de l’intuition. En effet, de même que la spécificité des objets architecturaux est de l’ordre de l’indicible et de l’indescriptible, sa mise en œuvre ne relève pas d’une procédure purement objective. L’acte créatif repose, par essence, sur une intuition cultivée. L’architecte, s’il doit posséder une culture étendue de tous les aspects de sa discipline, doit aussi être capable d’« oublier » ce qu’il sait pour que son action ne soit pas entravée par le poids d’une connaissance paralysante. Ainsi, l’acte créatif architectural ne se nourrit d’une culture ferme et consciente qu’à travers le filtre d’un abandon relatif et d’une intuition éclairée. Car de même que l’architecture est indicible, il est impossible de posséder une conscience objective de ce qu’il convient de faire pour la faire exister. C’est à travers une forme d’oubli actif de ce que l’on sait – qui est le contraire de l’ignorance – que l’on peut atteindre l’architecture. Et ainsi, armé d’un savoir qui ne doit pas nous empêcher de rester naïfs, nous pouvons donner à des questions communes des formulations singulières. De même que l’architecture procède d’une inquiétante étrangeté ambivalente qui met en jeu dans un même mouvement la reconnaissance de choses inconnues et la redécouverte de choses connues, l’acte créatif qui y mène est-il tendu entre expérience et naïveté, mémoire et oubli, réflexion et spontanéité. Or, ce qui caractérise l’architecture est, avant tout, sa présence matérielle, et la poétique particulière qui s’attache à sa construction dans le monde réel. Les objets architecturaux possèdent une capacité d’expression spécifique qui dépasse toute tentative de représentation, de description, ou d’explication. Là réside le centre de gravité de l’architecture, ce qui lui appartient en propre. Mais une œuvre qui ne serait que problématisée deviendrait purement didactique et, par là même, ne posséderait pas la part obscure et immanente de l’œuvre d’art véritable. Une telle œuvre serait descriptible et épuisable par des mots et/ou à travers d’autres médias que l’architecture, et pourrait finalement faire l’économie de sa construction, puisqu’elle n’aurait rien de spécifique à manifester à travers sa matérialisation. Dans la mesure où l’architecture repose sur une culture spécifique du monde matériel, l’acte créatif qui conduit à sa concrétisation s’enracine dans une solide connaissance disciplinaire et dans un substrat conceptuel conscient. D’où l’importance, pour un architecte, de problématiser sa pratique à travers un processus qui met en jeu la connaissance et la conscience. Le premier acte créatif de l’architecte, mais c’est probablement vrai de n’importe quel artiste, consiste donc à inventer sa propre tradition, car celle-ci, dans sa définition même, est le résultat d’une construction conceptuelle et subjective permanente, élaborée à partir d’une réalité historique et matérielle objective. Acte créatif uploads/Ingenierie_Lourd/ e-ric-lapierre-experience-tradition-et-spontane-ite.pdf
Documents similaires




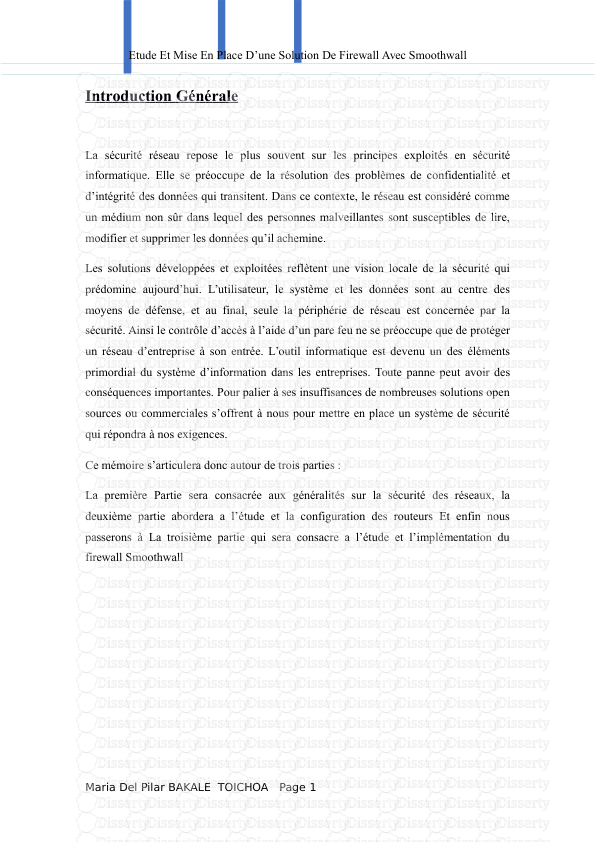





-
75
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 05, 2022
- Catégorie Heavy Engineering/...
- Langue French
- Taille du fichier 0.0521MB


