une chapelle de Sésostris Ier à Karnak introduction photographies paléographie
une chapelle de Sésostris Ier à Karnak introduction photographies paléographie index, bibliographie publications mode d'emploi études d'égyptologie 13 Alain Arnaudiès Nathalie Beaux Antoine Chéné Soleb Extrait conception graphique Thierry Sarfis TS et Olivier Cabon Thotm www.thotm.com réalisation Éric Aubourg Soleb éditions Soleb Paris, janvier 2015 ISBN 978-2-918157-23-6 www.soleb.com Le monument communément appelé « chapelle Blanche » tient une place très particulière dans les constructions de Karnak, autant pour les questions qu’il soulève que pour son histoire propre, voire même de par sa simple existence. Il est, de fait, l’un des plus anciens qui aient été découverts dans l’enceinte d’Amon-Rê, assurément le plus ancien de cette taille et de cette importance. Il est surtout l’un des témoins majeurs d’un état du temple, dont on sait aujourd’hui qu’il fut probablement le premier et qu’il servit de modèle aux constructions postérieures, qui peuplent aujourd’hui le site. C’est assez dire que cette chapelle de Sésostris Ier est l’une des clefs qui permettra peut-être de répondre aux questions que les égyptologues se posent, depuis sa découverte, sur son rôle exact, et, par là même, sur son emplacement originel. Car cette chapelle a subi le même sort que plusieurs autres monuments, retrouvés démontés et remployés en bourrage dans le IIIe pylône par Henri Chevrier. Celui-ci entreprit, en effet, en 1927, sur ordre de Pierre Lacau, de vider le pylône, dont l’état menaçait la stabilité de la salle hypostyle. L’effondrement de onze colonnes de celle-ci en 1899 avait mis en évidence sa fragilité statique et rendu nécessaire tous les travaux possibles d’allégement. Les premiers avaient rapidement montré l’abondance d’éléments architectoniques antérieurs, repris en bourrage, et la feuille de route d’Henri Chevrier l’incitait à chercher systématiquement les remplois. une chapelle de Sésostris Ier à Karnak photographies paléographie index bibliographie publications mode d'emploi études d'égyptologie 13 introduction Nicolas Grimal Le 16 novembre 1927 apparut, sous le plafond de la chapelle de Thoutmosis III, le premier bloc appartenant à celle de Sésostris Ier : un linteau. Ce n’est que dix ans plus tard, en 1937, que Chevrier dégagea le dernier élément de ce monument, dont il avait déjà établi une maquette provisoire en 1934. Pour dire le vrai, ce n’est qu’en 1948 que le dernier élément d’escalier fut découvert, mais Chevrier avait décidé en 1937 de ne plus attendre : il entreprit de réassembler la chapelle. Le lieu de la reconstruction allait de soi : ce qui sera plus tard le « musée de plein air », à proximité des chapelles d’Amenhotep Ier et de Thoutmosis Ier, précédemment remontées par Maurice Pillet. Henri Chevrier détaille minutieusement les opérations de remontage, — qui serviront de modèle à ses successeurs pour d’autres anastyloses —, dans la publication, qu’il réalise en 1946, en collaboration avec Pierre Lacau. Celui-ci y donne l’interprétation philologique et égyptologique de la chapelle, ainsi que celle de sa décoration. Ainsi s’est trouvé reconstitué un monument, dont le rôle et l’histoire restent encore bien mystérieux. Ce n’est, en effet, certainement pas Amenhotep III qui l’a fait démonter pour l’utiliser pour la construction du pylône qu’il édifiait en avant du temple, et qui en est devenu aujourd’hui le troisième. Même si l’espace alors occupé par la cour de Thoutmosis IV devait être fort « encombré » de chapelles reposoirs — mais pas seulement. La chapelle de Sésostris Ier avait certainement subi le même sort que le portique de ce roi, déjà restauré par Thoutmosis III, ainsi que les restes de ses autres monuments. Démontés depuis longtemps, ces blocs avaient probablement rejoint une réserve, où ils avaient retrouvé tout ou partie des autres monuments utilisés en remploi dans le pylône. « Réserve » et non « carrière », car leur état de conservation montre bien qu’ils étaient démontés et entreposés de façon à pouvoir être réutilisés intacts, fût-ce en bourrage. Les talatates du temple oriental d’Akhenaton nous rappellent que, même dans cet emploi détourné, même condamnés à une damnatio memoriae, ces monuments devaient à leur caractère sacré d’être conservés avec soin. Les hypothèses historiques de développement du temple — pour variées qu’elles soient — ne peuvent pas rendre un compte satisfaisant de ce type de monument, dont l’emplacement original ne peut guère être localisé qu’à partir d’une analyse fonctionnelle. C’est ainsi que la chapelle Rouge — compagnon de remploi, entre autres, de la nôtre dans le IIIe pylône — a pu être identifiée comme le reposoir principal de la barque sacrée à l’époque d’Hatshepsout. Cette localisation est plus difficile lorsqu’il s’agit de reposoirs utilisés lors des processions, d’autant plus que l’existence de deux axes processionnels ne simplifie pas la tâche. L’exceptionnelle qualité de la décoration, la finesse des hiéroglyphes méritaient une publication qui rende justice à cette épigraphie, caractéristique de son époque : encore marquée par l’art de la capitale de l’Ancien Empire, mais dont le classicisme novateur se retrouve affirmé dans les autres monuments de Sésostris Ier. Plusieurs projets avaient été lancés par le passé, sans jamais vraiment aboutir. Aujourd’hui, cette édition, entreprise il y a quelques années dans le cadre des travaux du Centre franco-égyptien d’étude des temples de Karnak, voit le jour, grâce aux talents conjugués d’abord d’Antoine Chéné, Alain Arnaudiès et Éric Aubourg. Il fallait, en effet, réaliser une couverture photographique de très grande qualité, de façon à offrir au lecteur des vues d’ensemble impeccables, mais aussi le détail fidèle de chaque signe de ce monument unique, — un détail susceptible d’être agrandi dans de fortes proportions, de façon à permettre l’étude du moindre de ses aspects. Antoine Chéné a mis son talent dans la réalisation de ce qui devait être la matière première d’une publication innovante, puisque le choix avait été fait dès le départ d’utiliser les possibilités que donnent aujourd’hui les publications numériques. Éric Aubourg a assuré la partie informatique de cet ouvrage, en construisant la structure, sur la maquette réalisée par Thierry Sarfis et Olivier Cabon. Ce dernier a associé ses compétences à celles d’Alain Arnaudiès, qui a organisé, lui, l’architecture de l’ouvrage, validant la navigation et assurant la cohésion interne à partir des fichiers qu’il a constitués, réunissant et organisant la bibliographie du monument, dont l’abondance témoigne de l’intérêt qu’a toujours suscité la chapelle Blanche. Cette bibliographie est en deux grands secteurs : la bibliographie générale et la bibliographie thématique. La bibliographie spécifique du monument est également jointe à cette publication : le lecteur peut ainsi avoir accès, aussi bien à l’editio princeps d’Henri Chevrier et Pierre Lacau qu’aux rapports de fouille du premier. Les planches constituent l’un des pôles principaux de l’ouvrage : chaque élément apparaît sur un plan interactif, qui permet d’aller au contexte, chaque fois fourni avec la bibliographie afférente, que celui-ci soit architectural ou liturgique. Deux planches particulières présentent une animation en trois dimensions : le lecteur peut se déplacer à l’intérieur comme à l’extérieur de la chapelle en une visite virtuelle. Nathalie Beaux, enfin, donne ici la première édition paléographique exhaustive de la chapelle Blanche, reprenant et développant les principes jadis mis en œuvre par Françoise Le Saout pour la publication d’une autre chapelle, celle d’Achôris. Elle fournit ainsi un véritable manuel de paléographie, exposant à la fois la méthode suivie et ses apports. Cette réflexion est assortie d’une ample bibliographie, puis d’une étude signe par signe. Chacun fait l’objet d’une fiche le donnant en photographie, avec sa valeur, le contexte et une bibliographie. Chaque fiche présente toutes les variantes, de façon à permettre la comparaison. Ainsi se trouve présentée une véritable étude paléographique, directement fondée sur le document lui-même. Cette publication est novatrice, autant par sa forme que dans sa conception scientifique : le travail des chercheurs y est directement perceptible et peut être suivi et contrôlé par le lecteur dans chacune de ses étapes. Elle prend toute sa place dans le mouvement actuel de publications et de ressources numériques orientalistes, à l’état desquelles la revue Bibliotheca Orientalis vient de consacrer tout un numéro. Plus en effet qu’un substitut à moindre coût à la publication traditionnelle, — devenue aujourd’hui trop chère pour beaucoup d’institutions, sans parler des chercheurs eux-mêmes —, ce nouveau type de publication ouvre de vastes perspectives : autant pour la mise en commun de bases de données que pour la diffusion des études qui en sont faites. Des monographies comme celle-ci constituent l’objet quasi idéal de cette nouvelle présentation, puisqu’elles vont de l’objet à son interprétation, en une chaîne épistémologique rendue quasi transparente. À Paris, le 13 janvier 2015 une chapelle de Sésostris Ier à Karnak introduction paléographie index bibliographie publications mode d'emploi études d'égyptologie 13 photographies Antoine Chéné, Alain Arnaudiès Extrait 1a 1b 2a 2b 3 4 9 10 11a 12 liste des planches localisation des scènes des piliers (plan interactif). localisation des architraves (plan interactif). modélisation 3D (extérieur) de la chapelle blanche. modélisation 3D (intérieur) de la chapelle blanche. façade est. façade ouest. portes est et ouest. architraves, parements externes. architraves, parements internes, partie nord de la chapelle. scènes 1 à 2 : Le roi reçoit la vie d’Amon-Rê. une chapelle de Sésostris Ier à Karnak introduction paléographie index bibliographie publications mode d'emploi uploads/Ingenierie_Lourd/ grimal-n-une-chapelle-de-sesostris-1er-a-karnak-extrait-preview-soleb.pdf
Documents similaires
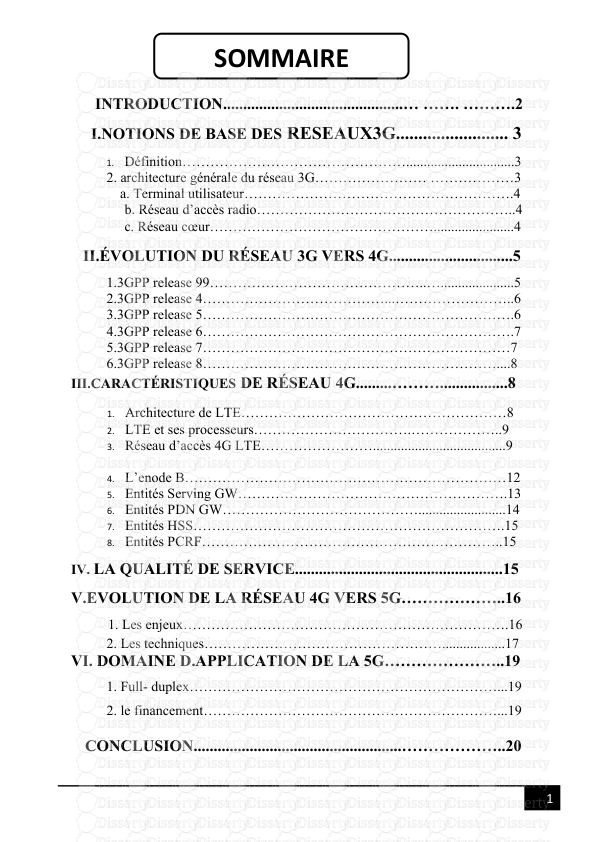









-
26
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 05, 2021
- Catégorie Heavy Engineering/...
- Langue French
- Taille du fichier 27.7042MB


