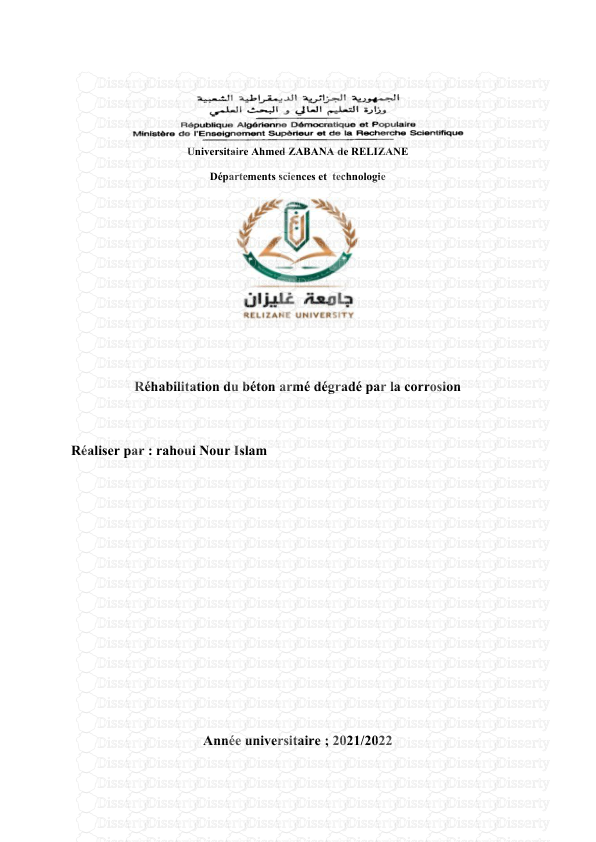Universitaire Ahmed ZABANA de RELIZANE Départements sciences et technologie Réh
Universitaire Ahmed ZABANA de RELIZANE Départements sciences et technologie Réhabilitation du béton armé dégradé par la corrosion Réaliser par : rahoui Nour Islam Année universitaire ; 2021/2022 Le béton armé est un matériau de base de structures largement utilisé depuis plus d’un siècle, aussi bien dans le génie civil que dans le bâtiment. Il peut se dégrader tous dépend de sont comportement face aux conditions climatiques et environnementales qui existent dans les milieux où ils sont construits. Les ouvrages en béton armé sont souvent exposés à de nombreuses agressions physico-chimiques auxquelles ils doivent résister afin de remplir de façon satisfaisante pendant leur période d'utilisation, toutes les fonctions pour lesquelles ils ont été conçus. Lorsqu'ils ne peuvent résister à ces agressions, des désordres dont le plus fréquent est la corrosion des armatures apparaissent dans le béton de ces structures. Ces désordres sont généralement dus à des défauts de conception, à une mauvaise mise en oeuvre ou à des causes accidentelles ; ils hypothèquent la durabilité, la résistance et la stabilité des ouvrages et peuvent entraîner leur dégradation, leur ruine. Les opérations de réhabilitation sont des travaux d'amélioration. C'est-à-dire qu'on ne procède pas à la destruction du bien. On en conserve la totalité ou une partie et on procède à son aménagement, pour le rendre meilleur. Les causes de dégradations du béton armé Les causes physiques de dégradation Abrasion : Usure accompagnée d'une perte de matière consécutive au frottement d'un élément par un abrasif ou par le passage répétitif des piétons, véhicules et chariots industriels, etc. Erosion : Perte de matière résultant du frottement d'un corps solide et d'un fluide contenant des particules solides en suspension et en mouvement. Cavitation : Usure d'une structure hydraulique caractérisée par une perte de masse en présence de bulbes de vapeur qui se forment lors d'un changement brusque de direction d'un écoulement rapide de l'eau. Chocs : Le béton éclate sous l'effet de chocs produits par des engins de transport ou de levage, des outils. Surcharges : Il s'agit d'ouvrages ayant supporté des charges trop importantes qui ont entraîné des fissurations et des éclatements du béton. Le feu : Les très fortes élévations de température lors d'un incendie par exemple, entraînent un éclatement du béton. Cycle gel/ dégel : Après un nombre important de cycles gel/dégel, certains bétons peuvent se déliter en surface et se désagréger. C'est le cas des ouvrages de montagne, des chambres froides. Les causes chimiques de dégradation Alcali-réaction ou cancer du béton : Réaction qui se produit entre la solution interstitielle du béton, riche en alcalin, et certains granulats lorsqu'ils sont placés dans un environnement humide .Des gels gonflants apparaissent en développant des microfaïençages et un éclatement du béton. Réactions sulfatiques : Les sulfates proviennent essentiellement du milieu extérieur. Ces ions ne sont pas passifs vis-à-vis de la matrice cimentaire et conduisent à la formation de certains composés chimiques expansifs tels que : L'éttringite, le gypse et la thaumasite. Ces composés provoquent le gonflement du béton créant en son sein des tensions qui engendrent des fissurations. Corrosion : Attaque des matériaux par les agents chimiques. Sur les métaux, la corrosion est une oxydation. I - Les autres causes de dégradation des bétons Nous avons vu que les bétons se dégradaient à cause des milieux dans lesquels ils sont placés car ils y subissent des agressions physiques et chimiques. Certaines causes, essentiellement dues à une mauvaise mise en oeuvre, peuvent également participer à la dégradation des bétons. - Mauvais positionnement des armatures Les armatures (généralement en acier) placées trop près du parement béton lors du coulage provoquent à terme des fissurations de surface. - Mauvaise qualité des bétons employés Un béton trop faiblement dosé en ciment, mal vibré, présentera un aspect défectueux : nids d'abeilles, faïençage, fissures superficielles, trous laissant les armatures apparentes. - Vibration trop importante Une vibration trop longue peut entraîner une ségrégation du béton et par conséquent une mauvaise répartition des constituants. Les efforts mal répartis entraînent alors des fissurations et des élancements du béton. - Absence de cure du béton La cure du béton est indispensable par temps chaud venté. Sans protection de surface, le béton se faïence en surface. - Cycle humidité / sécheresse Les cycles répétés d'humidité/sécheresse entraînent des variations dimensionnelles du béton pouvant créer des fissures et par conséquent la corrasion des aciers. - LE BETON ARME EN MILIEU MARIN L'eau de mer est constituée de sels chargés en ions chlorures de composés sulfatiques contenant les ions sulfates ( ), etc. Ces ions sont nocifs au béton lorsqu'ils pénètrent en son sein. La grande particularité de l'eau de mer est que les proportions relatives de ses constituants sont sensiblement constantes (c'est-à-dire indépendante de la salinité (teneur en sels dissous) ; cette propriété à été établie par le chimiste écossais William DITTMAR, et permet de considérer l'eau de mer comme une solution des onze constituants suivants : Anions Cations Cl- 0,5529 Na+ 0,3075 0,0775 Mg2+ 0,0370 0,0041 Ca2+ 0,0118 0,0019 K+ 0,0114 F- 0,000037 Sr2+ 0,00022 Molécule non dissociée H3B03 0,0076 Tableau n°1 : Masse du constituant contenue dans un Kg d'eau de mer, rapportée à la salinité La salinité moyenne de l'eau de mer est 35g/l. Le pH de l'eau de mer est proche de 8,2. Les gaz dissous comprennent principalement : 64% d'azotes, 34% d'oxygène ; 1,8% de dioxyde de carbone (soit 60 fois la proportion de ce gaz dans l'atmosphère terrestre). Poutre de tablier Pile en zone de marnage Paroi d'aéroréfrigérant Pile de pont Poteau support de ligne électrifiée Poteau porteur sous garage Poutre support de réservoir Eclats en formation LA CORROSION Le terme corrosion vient du latin "corrodere" qui signifie ronger, attaquer. La corrosion affecte tous les métaux. Elle résulte d'interactions physico- chimiques entre le matériau et son environnent entraînant des modifications de propriétés du métal souvent accompagnées d'une dégradation fonctionnelle de ce dernier (altération de ses propriété mécaniques, électriques, optiques, ex thétiques, etc.) Evans puis WAGNER et TRAUD sont les premiers à avoir défini la corrosion, en présence d'une phase liquide, comme un processus électrochimique. 1-GENERALITES Il existe plusieurs types de corrosions : - La corrosion uniforme : C'est une perte de matière plus ou moins régulière sur toute la surface. Cette attaque est observée sur les métaux exposés aux milieux acides. - La corrosion galvanique ou corrosion bimétallique : Elle est due à la formation d'une pile électrochimique entre deux métaux qui diffèrent par leur potentiel de corrosion. Le métal ayant le potentiel de corrosion le plus négatif, subit une corrosion accélérée provoquée par l'autre métal. - La corrosion caverneuse : Elle est due à une différence d'accessibilité de l'oxygène entre deux parties d'une structure, créant ainsi une pile électrochimique. Cette attaque sélective du métal est observée dans les fissures et autres endroits peu accessibles à l'oxygène. - La corrosion par piqûres : Elle est produite par certains anions, notamment les halogénures, et plus particulièrement les chlorures, sur les métaux protégés par un film d'oxyde mince. Elle induit typiquement des cavités de quelques dizaines de micromètres de diamètre. - La corrosion sous contrainte : C'est une fissuration du métal qui résulte de l'action commune d'une contrainte mécanique et d'une réaction électrochimique. Dans la plupart des cas (corrosion galvanique, caverneuse, par piqûres, etc.), c'est la formation d'une pile de corrosion qui est à l'origine de la corrosion. Une pile de corrosion est une pile électrochimique qui se forme lorsque deux parties d'une structure possèdent un potentiel électrique différent. La différence de potentiel résulte souvent des hétérogénéités du matériau ou du milieu environnant. La surface de l'acier est alors constituée d'une multitude de micro-piles, elles-mêmes constituées de zones dites anodiques où les électrons sont libérés et de zones cathodiques où les électrons sont consommés. En milieu aqueux, le processus de corrosion électrochimique de l'acier peut être décrit de manière simplifiée par deux réactions électrochimiques élémentaires simultanées. Dans la zone anodique, l'acier se dissout : Fe Fe2+ + 2e- (2) Les ions ferreux Fe2+ passent dans la solution et peuvent s'oxyder ultérieurement en ions ferriques Fe3+. Dans la zone cathodique, les électrons produits sont consommés afin de maintenir l'équilibre électronique. Les réactions cathodiques correspondantes sont la réaction de l'oxygène dissous dans l'eau (3a) ou la réduction du proton avec dégagement d'hydrogène (3b) : O2 + 2H2O + 4e- 4OH- (3a) 2H+ + 2e- H2 (3b) Les ions hydroxyde OH- formés dans la solution peuvent ensuite se combiner aux ions ferreux Fe2+ et précipiter en hydroxyde ferreux à la surface de l'acier, lorsque les concertations en ions ferreux et hydroxyde le permettent : Fe2+ + 2OH- Fe (OH)2 (4) Les réactions chimiques ci-dessus se produisent parce que avant d'être placée dans le coffrage, une armature en acier est rouillée puisqu'elle a d'abord été exposée à l'atmosphère. Lorsque le béton frais est mis en place autour de cet acier, l'eau de gâchage pénètre à travers les pores de la rouille, où elle forme progressivement de la ferrite de calcium hydraté (4 CaO, Fe203, 13H20). Mais surtout, cette eau réagit avec l'acier métallique et forme sur celui-ci uploads/Ingenierie_Lourd/ le-beton-arme-est-un-materiau-de-base-de-structures-largement-utilise-depuis-plus-d 1 .pdf
Documents similaires










-
52
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 10, 2022
- Catégorie Heavy Engineering/...
- Langue French
- Taille du fichier 1.1591MB