N O U V E L L E R E V U E P É D A G O G I Q U E 13,95 e / ISSN 1764-2116 Lettre
N O U V E L L E R E V U E P É D A G O G I Q U E 13,95 e / ISSN 1764-2116 Lettres Lycée novembre 2011 N° 17 Hors série Hors série Micromégas de Voltaire Étude d’une œuvre intégrale 2de Voltaire, Micromégas - Hors série NRP Lycée / n° 17 / novembre 2011 1 É D I T O R I A L Micromégas de Voltaire Par Christine Gensanne*, avec la collaboration d’Alexandre Winkler** et Vincent Fleury*** dénonciation de l’anthropocentrisme, et les leçons de vanité et de relativisme. Quant aux personnages secondaires, ils sont tous dési- gnés par des noms communs, pour partie ludiques (« le Saturnien » ; « Un raisonneur »), parmi lesquels se trouvent de plaisantes appel- lations « entomomorphiques » (« les insectes » ; « les mites »). Les personnages secondaires sont encore dénommés par des périphrases hilarantes (« le nain de Saturne » ; « le petit animalcule en bonnet carré »). Les « figurants », pour en terminer, font l’objet de désigna- tions encore plus vagues (« ses gens » ; « l’autre »). Cette imprécision onomastique – entres autres caractéristiques – lie Micromégas au genre du conte de fée, qui présente ce même trait (Blanche-Neige ; Le Prince charmant ; Le Petit Poucet). En somme, les seuls noms propres autorisés dans l’œuvre semblent bien être ceux des savants de l’époque (majoritairement des philosophes et des scientifiques), cités en référence, ou pour leur lancer des piques ironiques qui met- tent le lecteur en joie. Les références savantes qui apparaissent ainsi n’ont rien de cuistre ; elles s’inscrivent en revanche parfaitement dans la grande entreprise intellectuelle qui occupera tout le Siècle des Lumières : vulgariser le savoir. Voltaire s’attelle à la tâche en réper- toriant tous ceux qui comptent selon lui dans la pensée scientifique et philosophique du XVIIIe siècle, tout en soulignant son intime préfé- rence pour Locke et Newton. Autre « anonymat » transparent : Voltaire perce sous les masques du narrateur et de Micromégas (au chapitre 1 surtout, où l’auteur s’épanche sur ses déboires avec la censure) ; Fontenelle, lui, est caricaturé en « nain de Saturne ». Nos deux hommes de lettres ainsi métamorphosés en personnages ne sont pas sans évoquer Dante et Virgile dans Commedia de Dante, partis eux aussi en quête du monde du bonheur, le Paradis. Dans Micromégas, le merveilleux se fait aussi plus complexe et innovant qu’il ne l’est à l’accoutumée dans le conte philosophique, du fait de l’apparition d’un personnage inédit : le premier extraterrestre digne de ce nom de la littérature française : une « substance » cent pour cent humaine. Voltaire, virulent pourfendeur de l’anthropocen- trisme et de l’ethnocentrisme, ne va quand même pas jusqu’à ima- giner qu’un extraterrestre pourrait se présenter autrement que sous l’apparence Homo sapiens. La fameuse ironie voltairienne même prend des teintes inaccou- tumées dans Micromégas : si les piques y foisonnent contre les contemporains de l’auteur et les systèmes de pensée en vigueur au XVIIIe siècle, elles présentent un caractère adouci : Voltaire ne tue pas avec les mots, comme il en est parfaitement capable ; il joue plutôt, avec légèreté, d’un humour heureux. Le côté très divertissant du conte philosophique voltairien typique est bel et bien là, qui nous fait saisir les raisons du succès éditorial exceptionnel que connut Micromégas à son époque. Chacun en prend pour son grade dans des piques qui font tout le sel de l’œuvre, mais c’est le pauvre Fontenelle qui y détient la palme – bien peu académique pour le coup – du brocard. Ces pointes ironiques constantes rendent l’identification impossible, car elles maintiennent le lecteur en alerte, et le ramènent à la réalité. « Il n’y a pas de rose sans épine », dit le proverbe : c’est bien là tout le programme voltairien. Micromégas de Voltaire se prête idéalement au traitement des objets d’étude argumentatifs des classes de lycée, et s’adapte tout particulièrement au programme de 2nde, dans sa partie intitulée : « Genre et formes de l’argumentation des XVIIe et XVIIIe siècles ». Autre atout pédagogique : la brièveté providentielle du livre permet l’appro- fondissement. Toutefois, le texte reste difficile d’accès, en raison sans doute des nombreuses allusions à la vie culturelle de l’époque, mais également parce qu’il offre à l’œil attentif une série de singularités. Micromégas : un texte qui n’en fait qu’à sa tête « Enfant intelligent, mais polisson insigne. » Appréciation des maîtres jésuites sur Voltaire, élève au collège Louis-le-Grand Complexité générique C’est d’abord l’unique conte philosophique vraiment revendiqué par son auteur : Voltaire l’a exceptionnellement signé de son nom, quand on sait qu’il s’ingéniait d’ordinaire – par prudence par rapport à la censure royale, pour se faire de la publicité, et aussi par coquetterie – à nier farouchement la paternité de ses « coïonneries », considérées par lui comme des amusements ponctuels, indignes d’intérêt litté- raire. Il leur préférait de loin les genres nobles : la tragédie, l’histoire ou l’épopée. Micromégas est aussi un texte bien délicat à classer dans une catégorie générique précise, même s’il est convenu de le considérer comme un conte philosophique. Voltaire, d’ailleurs, le nomme ainsi. Car c’est un texte que n’effraie pas la contradiction : n’y trouvons- nous pas l’improbable cohabitation de l’irrationnel (le merveilleux) avec la rigueur scientifique ? Voltaire persiste et signe dans cette voie, en faisant de son conte un véritable pot-pourri générique ; relevant encore la sauce d’une pincée de récit de voyage, de roman de formation et de roman picaresque ; l’ensemble s’acoquinant avec l’utopie. Dans la catégorie « hors genre », car nous quittons désormais le domaine de la littérature, le Micromégas flirte volontiers, aussi – et surtout – avec la vulgarisation scientifique, ainsi qu’avec la philoso- phie. Pour couronner le tout, d’aucuns n’hésitent pas à en faire le lointain ancêtre de la nouvelle de science-fiction, genre toutes propor- tions gardées par certains aspects. Autre notable singularité toujours liée à la question du genre : l’ano- nymat quasi général des personnages. On m’objectera que Micromégas est bel et bien le nom propre du héros – témoin la majuscule – mais ce « nom » prend des accents d’épithète homérique (comme Pépin le Bref, Napoléon le Petit, Hérode le Grand, ou Vercingétorix le « Grand Roi des guerriers ») plutôt que de nom de baptême, si tant est que, sur Sirius, le muphti pratique ce sacrement. L’on saisit vite que ce nom n’est ni plus ni moins qu’un outil argumentatif qui sert la thèse, et, qu’à lui seul, il met en abyme tout le conte ; car il concentre en son sein les grands axes du livre : l’obsession de la mesure ; la 2 Voltaire, Micromégas - Hors série NRP Lycée / n° 17 / novembre 2011 On remarquera encore que Micromégas suit un plan en boucle : commencé sur une leçon d’humilité (« Micromégas, nom qui convient fort bien à tous les grands »), il s’achève sur une autre leçon d’humilité, de portée générale. Et l’œuvre se coule dans le moule de la plupart des récits de voyage des contes voltairiens, qui suivent toujours peu ou prou les mêmes lignes : 1° le départ et ses raisons ; 2° les étapes du voyage ; 3° le retour et ses conséquences (la fin de l’apprentissage). Micromégas, ou Les États et Empires du chiffre Enfin, et surtout, le lecteur est pris d’une naupathie bien sin- gulière en voyageant avec nos extraterrestres : le vertige mathé- matique. À force de mesurer frénétiquement tous les aspects du monde, et de préférence des objets de taille extrême et contrastée (on note que ces mesures sont « assorties » au héros du conte, qui a lui-même pour nom un oxymore dans lequel cohabitent les extrêmes opposés), Micromégas donne le tournis. Ses dénivelés vertigineux constants sont d’ailleurs fort bien rendus par le choix graphique d’un parangonnage calligraphié pour le titre Micromégas de la couverture de l’édition support de ce hors-série, Carrés Clas- siques (Nathan). Vertige il y a, en effet, car le thème de la mesure envahit toute l’œuvre, sur le mode du leitmotiv, créant un comique de répétition farcesque qui n’est pas sans évoquer un « Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes » qu’on aurait encore démultiplié. Ce principe obsessionnel consistant à tout passer à la toise évoque le tic de comportement, la précision maniaque. Ces mesures méthodiques si appuyées seraient-elles une façon de pointer du doigt avec insistance la direction à suivre ; la bous- sole de notre voyage interstellaire ; et – partant – la clé même de l’œuvre ? Si cette hypothèse se vérifiait, la notion de « chiffre » prendrait alors sa pleine extension sémantique : et le chiffre mathématique fusionnerait avec le sens à déchiffrer. Mode d’emploi du hors-série Sens à déchiffrer, clé à trouver, allusion à décoder : pour que l’élève puisse goûter tout le sel de Micromégas, et en apprécier la subtilité, il faut le guider, l’introduire dans une époque, un uploads/Litterature/ 8-hs-voltaire-maicromegas-lycee-nov-2011.pdf
Documents similaires








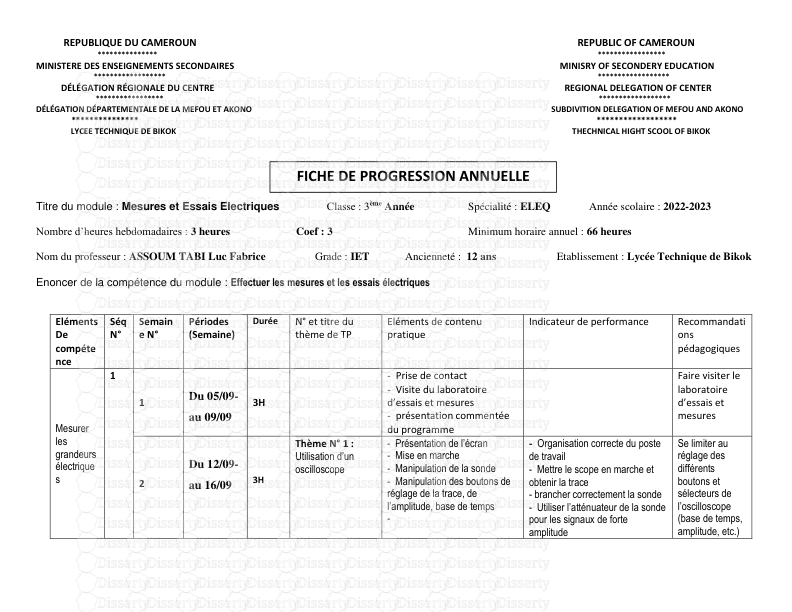

-
64
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 16, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 3.5980MB


