Pierre Bertaux - 1907 - 1986 Une esquisse biographique Hansgerd Schulte p. 273-
Pierre Bertaux - 1907 - 1986 Une esquisse biographique Hansgerd Schulte p. 273-280 TEXTE NOTES AUTEUR TEXTE INTÉGRAL 1 Cf. la bibliographie dans ce volume. 1 Si Pierre Bertaux a consacré son dernier livre à lʼinstinct ludique chez Goethe, ce nʼest sans doute pas un hasard : « Nous jouerons ensemble à de si jolis jeux ». Au cours dʼune vie riche et productive, Pierre Bertaux a eu des champs dʼactivité aussi divers que Hölderlin et Guillaume II, la mutation de lʼhumanité et lʼAfrique, sans oublier le travail occasionné par les éditions successives de cet héritage paternel quʼest le dictionnaire Bertaux-Lepointe1. Mais le fil conducteur de cette œuvre et de cette vie à multiples facettes, cʼest lʼinstinct ludique. 2 Une source digne de foi — sa mère Céline Piquet — a rapporté que la naissance de Pierre Bertaux, survenue le 8 octobre 1907 à Lyon, fut un « jeu dʼenfant ». Beaucoup a déjà été dit sur le rôle de médiateurs intellectuels et culturels des germanistes dʼAlsace et de Lorraine auxquels appartenaient les Bertaux. Le père Félix — le bien nommé — veilla sur une jeunesse heureuse et lʼinitia très tôt à la langue allemande. Pierre devait dire plus tard : « Je nʼai jamais eu à tuer mon père » et « Chez nous on est germaniste de père en fils ». Il eut la chance, dans un premier temps, dʼêtre dispensé des classes élémentaires : son alphabétisation fut confiée au grand-père, aussi gentil que bon pédagogue, et lʼenseignement du piano à André Gide. Même au lycée, son père, agrégé dʼallemand, conseilla à son fils de faire lʼécole buissonnière. Félix Bertaux estimait quʼil valait mieux garder son temps pour des choses plus gaies et plus utiles. Il nous apparaît donc que le jeune Pierre eut davantage de loisirs à consacrer au jeu que les autres enfants de son âge. Aussi ses premiers souvenirs de jeunesse étaient-ils associés aux jeux de construction et de ballon ; il jouait souvent au fronton, car il pouvait alors se passer dʼun partenaire : « Avec une balle, je ne mʼennuyais jamais ». Pierre était enfant unique ; le jeu lui permettait de surmonter sa solitude, de connaître la vie et de se connaître lui-même : « Le jeu a été la grande école de mon existence ». • 2 Cf. lʼhommage de Yehudi Menuhin à Pierre Bertaux dans ce volume. 3 Mais aux yeux de Pierre, les jeux les plus beaux, les plus fascinants et les plus passionnants étaient les jeux de langage. Dès sa prime jeunesse, il se plaisait à parcourir des champs sémantiques, à remonter des chaînes étymologiques et à rassembler des synonymes ; il était sensible aux qualités phonétiques dʼun mot. Puisque les règles linguistiques étaient, elles aussi, des règles de jeux, enfreindre les premières lui paraissait tout aussi critiquable dʼun point de vue moral que dʼenfreindre les secondes. Il en Mais aux yeux de Pierre, les jeux les plus beaux, les plus fascinants et les plus passionnants étaient les jeux de langage. Dès sa prime jeunesse, il se plaisait à parcourir des champs sémantiques, à remonter des chaînes étymologiques et à rassembler des synonymes ; il était sensible aux qualités phonétiques dʼun mot. Puisque les règles linguistiques étaient, elles aussi, des règles de jeux, enfreindre les premières lui paraissait tout aussi critiquable dʼun point de vue moral que dʼenfreindre les secondes. Il en conçut une sorte dʼéthique de la langue, quʼelle soit parlée ou écrite, éthique qui devait garder une valeur absolue durant toute son existence : « On ne triche pas avec la langue ». Il avait coutume de dire à son ami Yehudi Menuhin2 que des mots impropres et des expressions imprécises lui étaient aussi douloureuses quʼune fausse note. Le commerce avec la langue de- mande une virtuosité aussi consommée que lʼexécution dʼune œuvre musicale ; pour Bertaux, le jeu devait faire preuve du même esprit de sérieux dans lʼun et lʼautre domaine. 4 Il nous semble que lʼinstinct ludique qui se manifestait dans le domaine du langage a orienté de manière décisive la vie et la carrière scientifique de Pierre Bertaux. En affirmant cela, nous pensons dʼune part à son travail sur les rééditions du dictionnaire bilingue : une fois de plus, lʼenjeu nʼétait-il pas de trouver le mot juste, le terme correspondant dans lʼautre langue ? Pour Bertaux, ce travail sʼinsérait nécessairement dans le contexte dʼun rapprochement franco-allemand car, à ses yeux, les malentendus politiques résultaient en premier lieu de malentendus linguistiques et dʼimprécisions de vocabulaire. Aussi, seule la connaissance approfondie de la langue était-elle en mesure de permettre une compréhension véritable du peuple voisin. 5 Nous pensons, dʼautre part, à son dialogue permanent avec Hölderlin, dialogue marqué également par un amour ludique — et donc sérieux — de la langue. Hölderlin fut le partenaire de jeu idéal, le seul qui fût capable de retourner toutes les balles avec un art consommé — pour user dʼune expression de Bertaux. Il a toujours été fasciné par lʼextraordinaire précision du langage poétique de Hölderlin. Toute son interprétation part de la conviction que les affirmations du poète méritent dʼêtre prises rigoureusement à la lettre. On verrait alors que Hölderlin ne fut ni un poète ésotérique, comme le croient certains, ni lʼaliéné de la tour de Tübingen comme le pense encore aujourdʼhui la majorité des chercheurs. Aux yeux de Bertaux, Hölderlin fut un révolutionnaire à qui son engagement avait valu la persécution. 6 Trois expériences ont marqué profondément lʼévolution intellectuelle des années dʼécole et dʼuniversité : il faut nommer en premier ses années dʼenfance, passées dans un environnement familial hors du commun et protégées par lʼamour et lʼintelligence des parents. Sous lʼimpulsion de son père, la belle résidence familiale à Sèvres était devenue dans lʼentre-deux- guerres un point de rencontre privilégié des intellectuels ouverts au dialogue franco-allemand. Thomas et Heinrich Mann, qui ont laissé à Pierre Bertaux de nombreuses lettres non encore publiées, faisaient partie de ce cercle dʼamis, tout comme Joseph Roth, Ernst Bloch, André Gide, Jean Schlumberger, Roger Martin du Gard et un grand nombre de personnalités des célèbres « Décades » de Pontigny. Il nʼest pas surprenant que dans un environnement pareil, Bertaux ait pu sʼinitier à la culture au cours de déjeuners et de promenades. On comprend également pourquoi le futur germaniste devait souhaiter lʼextension des études germaniques à la connaissance de la franco allemand. Thomas et Heinrich Mann, qui ont laissé à Pierre Bertaux de nombreuses lettres non encore publiées, faisaient partie de ce cercle dʼamis, tout comme Joseph Roth, Ernst Bloch, André Gide, Jean Schlumberger, Roger Martin du Gard et un grand nombre de personnalités des célèbres « Décades » de Pontigny. Il nʼest pas surprenant que dans un environnement pareil, Bertaux ait pu sʼinitier à la culture au cours de déjeuners et de promenades. On comprend également pourquoi le futur germaniste devait souhaiter lʼextension des études germaniques à la connaissance de la civilisation allemande. Au cours de sa carrière universitaire, Bertaux a toujours défendu cette position avec vigueur : la création de lʼInstitut dʼallemand dʼAsnières est en grande partie le fruit de sa persévérance. Les écrivains allemands et français quʼil put fréquenter à cette époque sʼétaient tous opposés au fascisme ; de plus, ses origines lorraines lui avaient appris que cʼétait une erreur que de restreindre lʼétude du voisin incommode à la langue et à la littérature : le germaniste français devait se faire lʼobservateur et le commentateur critique de toute la réalité allemande ; mais il devait aussi se tenir prêt à prendre les armes dans lʼéventualité dʼune nouvelle agression. Bertaux en fit lui-même lʼexpérience : il dirigea, par exemple, les émissions en langue allemande de la radiodiffusion française. Dans ce cadre, il eut lʼoccasion de faire une lecture radiophonique de lʼAvertissement à lʼEurope de Thomas Mann. Plus tard, Bertaux défendit son pays, dʼabord au cours de la « drôle de guerre », ensuite dans la Résistance, ce qui lui valut de passer deux années en prison. Dʼune certaine façon, la vie de Bertaux reflète donc lʼidée que les germanistes français se faisaient dʼeux-mêmes et de leur mission particulière. 7 La deuxième expérience décisive fut lʼEcole Normale Supérieure, où Bertaux entra en 1926. Parmi ses camarades, on trouve les noms de Raymond Aron, René Maheu, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty et Paul Nizan. Il existe un « esprit de Normale », qui, bien quʼil soit difficile à caractériser, permet aux anciens élèves de se reconnaître comme les membres dʼune même famille. On peut en citer comme éléments constitutifs : la capacité à garder une distance critique, lʼironie (y compris vis-à-vis de soi-même), lʼintelligence, une largeur de vue hostile à tout dogmatisme, un scepticisme tolérant qui se fonde sur la conviction que tout enseignement est relatif, la foi en un homme devenu plus cultivé et plus fin grâce à lʼéducation. Ces caractéristiques sont complétées par des qualités formelles, lʼesprit dʼanalyse, la clarté de la présentation, la virtuosité stylistique et par ce qui constitue la marque distinctive du normalien : lʼesprit du « canular uploads/Litterature/ bertaux-1907-1986.pdf
Documents similaires




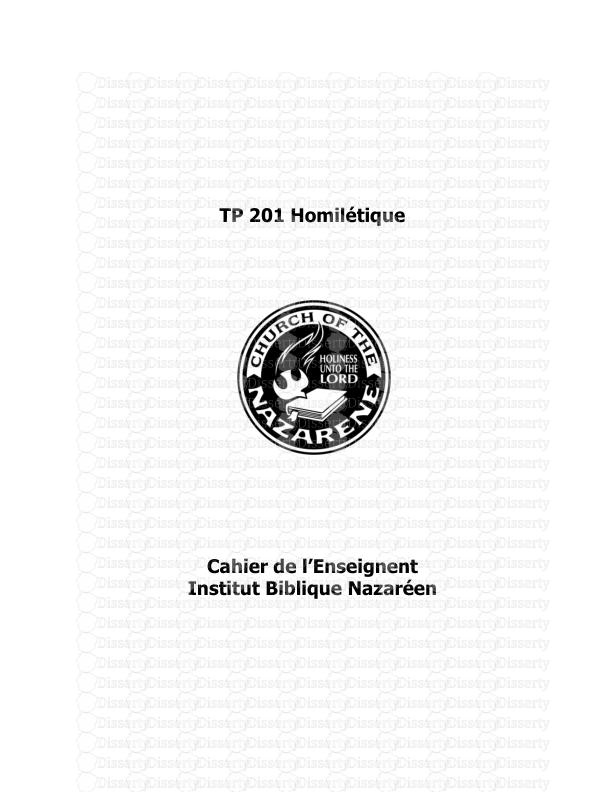





-
50
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 24, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2277MB


