LES ÉDITIONS ILLUSTRÉES DU JARDIN DES SUPPLICES À la fin de son article sur « M
LES ÉDITIONS ILLUSTRÉES DU JARDIN DES SUPPLICES À la fin de son article sur « Mirbeau et l’illustration1 », Laurence Tartreau-Zeller se demandait s’il était possible d’illustrer Le Jardin des supplices en raison de la puissance de l’imaginaire de l’auteur. Malgré sa défiance à l’égard de « l’horrible mot : illustrer2 », Mirbeau fut à l’initiative d’une édition de luxe du roman chez Ambroise Vollard, illustrée par Auguste Rodin, artiste dont on connaît la relation amicale durable et fervente avec l’écrivain. Après sa mort, plusieurs illustrateurs des années 1920 à 1945 se sont confrontés à cette œuvre (Paul de Pidoll, Gio Colucci, Raphaël Freida, Edy Legrand, Pierre Leroy), ainsi qu’une plasticienne contemporaine (Florence Lucas), en 2012. Comment se présentent ces éditions du Jardin des supplices, tant au niveau de la décoration du livre que de l’illustration du texte ? Comment ces artistes ont-ils interprété le roman et transposé graphiquement l’imaginaire de son auteur ? C’est à ces questions que je voudrais répondre, à travers l’examen successif des éditions illustrées de ce roman3. Auguste Rodin L’édition originale du Jardin des supplices chez Charpentier-Fasquelle, en 1899, s’accompagne d’un tirage de luxe sur grand papier (édité à 150 exemplaires), illustré par un dessin de Rodin placé en frontispice et imprimé en couleurs, sans rapport avec une seconde édition de luxe (tirée à 200 exemplaires4), comportant une vingtaine de dessins de Rodin. Celle-ci paraît en 1902 chez Ambroise Vollard, ornée de vingt lithographies hors-texte, toutes des compositions originales, dont dix-huit en couleurs, auxquelles il faut ajouter une vignette figurant sur la page de titre. Ce sont les deux seules éditions illustrées du roman publiées du vivant de l’écrivain. Il y aurait beaucoup à dire sur Le Jardin des supplices édité par Vollard mais il est peu pertinent de comparer ce livre avec la plupart des éditions illustrées qui suivront : il s’agit en effet d’un livre d’art plus que d’un ouvrage illustré ; de surcroît, c’est le fruit d’une collaboration entre le romancier, un artiste et un éditeur ; c’est l’unique cas où seul le texte de la deuxième partie du roman soit publié ; enfin, l’autonomie du texte et de l’image semble avoir été recherchée dès l’origine du projet, plusieurs dessins ayant été choisis dans un corpus préexistant, sans lien avec le roman, et sans qu’on sache précisément par qui. La présence d’une citation sur les serpentes recouvrant les lithographies crée un jeu de tensions, de concordances et de distorsions qui ont alimenté plusieurs articles sur les relations entre les images et le texte. Mais ces études érudites, qui interprètent le plus souvent les planches à la lumière d’autres dessins de l’artiste inconnus du lecteur, négligent les effets de sens que ces images, associées au roman, produisent par elles-mêmes5. 1 Laurence Tartreau-Zeller, « Mirbeau et l’illustration », Revue des lettres et de traduction, n° 8, Université du Saint-Esprit de Kaslik (Liban), 2002, p. 395-409. 2 Octave Mirbeau, « Félicien Rops », Combats esthétiques, t. I, p. 241, cité par L. Tartreau-Zeller. 3 Je me limiterai ici aux éditions en français. Pour les éditions illustrées des traductions du roman, je renvoie à la Bibliographie d’Octave Mirbeau par Pierre Michel sur scribd.com, 2005-2017. Voir aussi Gérard Barbier, « Mariette Lydis, illustratrice du Jardin des supplices », Cahiers Octave Mirbeau, n° 21, 2014, p. 125-131. Cette dessinatrice autrichienne a réalisé en 1924 une quarantaine d’illustrations pour le roman, exposées à Paris et à Milan, mais non publiées. 4 15 exemplaires sur Japon impérial, 30 sur Chine d’origine, 155 sur Vélin. 1 Paul de Pidoll C’est en 1923 que paraît Le Jardin des supplices illustré par Paul de Pidoll (1882- 1954), peintre, xylographe, graveur et illustrateur de quelques livres. L’ouvrage est publié aux éditions Georges et Antoinette Mornay, dans la collection « Les Beaux livres » (tirage à 1 000 exemplaires6), emblématique du livre moderne illustré français « semi-précieux » (ou « demi- luxe ») de la période Art Déco. Pidoll n’y a illustré que cet ouvrage (n° 20), mais cette collection contient trois autres romans de Mirbeau, L’Abbé Jules (n° 27, 1925) et Sébastien Roch (n° 32, 1926), illustrés par Fernand Siméon, ainsi que Le Calvaire, illustré par Hermann Paul (n° 41, 1928). Le Jardin des supplices illustré par Paul de Pidoll comporte un grand nombre d’images (cinquante-neuf planches, figures et vignettes) organisées selon un dispositif régulier composé de bandeaux en tête de chaque chapitre et d’autant de lettrines et de culs-de-lampe, auquel s’ajoutent onze planches (quatre hors-texte, frontispice compris, et sept in-texte, déployées sur une double page) et six vignettes hors-texte, toutes situées dans la deuxième partie du roman, privilégiée par l’artiste. La couverture est recouverte presque entièrement par un portique de temple chinois sur lequel se trouvent les éléments paratextuels, avec quatre touffes végétales à l’arrière-plan qui entrent en résonance avec le titre. Sur un fond uni orangé qui sert de fil chromatique au livre, l’image de couverture convie d’abord le lecteur à un voyage en Orient, sur un mode purement décoratif. Le frontispice oriente la lecture dans une tout autre direction, en privilégiant les thèmes du jardin et de l’union du désir et de la mort, à travers la vision allégorique d’une femme et d’un squelette verdâtre qui s’enlacent au milieu d’une végétation exubérante [fig. 1]. Point d’exotisme ici ni de référence aux supplices, mais une nature où la mort et le sexe triomphent – le massif d’arômes au premier plan traduisant les « inflorescences phalliformes [...] des plus stupéfiantes aroïdées » du texte (IIe partie, chap. 5). Toutefois, la référence à la sexualité est quasi absente dans la suite des illustrations : à peine évoquée dans la scène finale du lupanar, elle est indiscernable dans celle du supplice de la caresse. Dans cette dernière, les liens du supplicié sont à peine visibles et rien n’indique l’activité de la tourmenteuse. L’image fait plus penser à une pietà qu’à une scène de torture [fig. 2]. En revanche, le dernier cul-de-lampe du livre montre un animal ithyphallique, référence directe à la décoration du lupanar, mais unique écho explicite à un texte où la dimension érotique est prégnante. La régularité du dispositif iconique conduit à la représentation de nombreuses scènes du roman, le plus souvent en relation ténue avec elles. Les bandeaux de la première partie réduisent souvent la diégèse à l’anecdote (usine du père du narrateur, soirée mondaine, harem) ou à une évocation générale (bateaux, paysages et oiseaux pour le voyage maritime). Les culs- de-lampe proposent une imagerie liée au quotidien (bouteille de vin, bureau), parfois un dessin abstrait évoquant un aspect plus poétique du texte (la vision féérique de la mer et de 5 Cette question mériterait d’être approfondie. Signalons au moins l’étude de Claudine Mitchell, « Fleurs de sang : les dessins de Rodin pour Mirbeau », Rodin – Les figures d’Éros, Éditions du Musée Rodin, 2006, p. 87- 119 ;celle d’Olivier Schuwer, « Le dessin de Rodin dans le dessein de Mirbeau. Chassé-croisé au Jardin des supplices », Cahiers Octave Mirbeau, n° 22, 2015, p. 67-83 ; et celle de Marie Bat, « Octave Mirbeau et ses illustrateurs : un dialogue des arts ? », dans ce volume. 6 Un seul exemplaire sur Japon ancien, 60 sur Japon impérial, 11 sur Hollande van Gelder avec suite des bois sur Japon, 928 sur papier de rives ; 99 H.C. dont 9 Japon, 24 Hollande, 66 rives. 2 l’embryologie). L’illustration de la deuxième partie, plus riche, privilégie les motifs végétaux, les physionomies humaines et le monumentaire chinois, mais d’une manière très stylisée, conformément à l’Art Déco. Pidoll crée quelques scènes de martyres, mais qui ne donnent pas une idée précise de la diversité et du raffinement du catalogue des supplices du roman : limitée à quelques scènes de flagellation ou de bastonnade, à de rares corps ensanglantés, la violence est reléguée dans les culs-de-lampe (charognard, panier avec morceaux de chair, supplicié) et sur un mode allusif. Trois des quatre planches hors-texte mettent en valeur une femme identifiable à Clara, présentée, tantôt comme une idole adorée par des hommes nus ensanglantés, tantôt impassible face à une scène de flagellation. Assez peu représentée, en définitive, par rapport à son importance dans le roman, l’héroïne apparaît inaccessible et insensible, peu sensuelle et bien moins complexe que chez Mirbeau. Dans la quatrième planche hors-texte, qui représente le tourmenteur, les instruments de torture sont si stylisés qu’ils sont peu identifiables, tandis que le corps du supplicié, réduit à deux jambes pendantes, est relégué hors de l’image. Cette euphémisation des supplices se retrouve dans le traitement de l’épisode de la cloche, où la violence est atténuée par l’esthétisme de l’image, marquée par une floraison exubérante et des paons majestueux. Le choix de couleurs vives et fraîches, l’unité chromatique de l’ouvrage, la grande diversité de motifs floraux stylisés, présents notamment dans les lettrines, renforcent ce parti pris décoratif qui édulcore l’imaginaire cruel et angoissant du roman. Avec l’illustration de Pidoll, le jardin l’emporte sur les supplices, le paysage sur la figure humaine, l’ornement sur la diégèse, le sujet anecdotique sur la uploads/Litterature/ bruno-fabre-les-editions-illustrees-du-quot-jardin-des-supplices-quot.pdf
Documents similaires




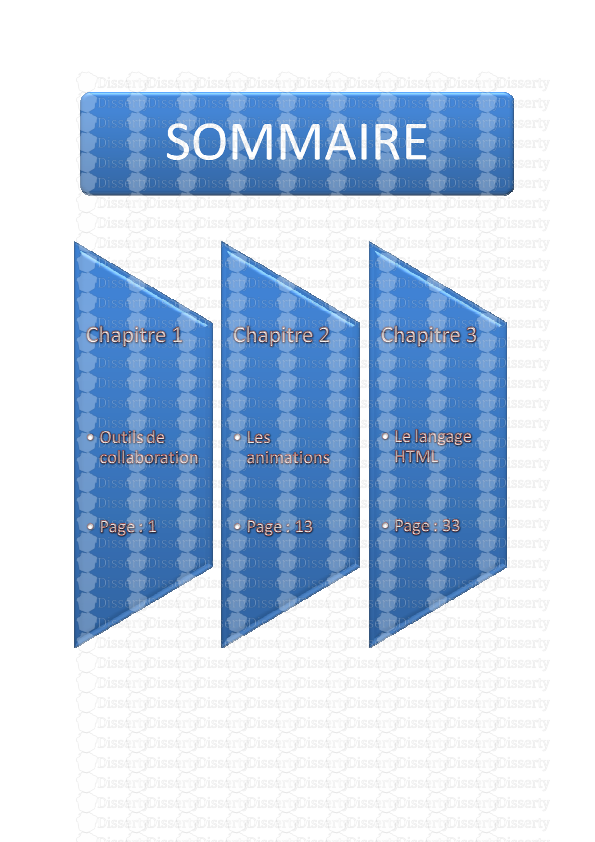
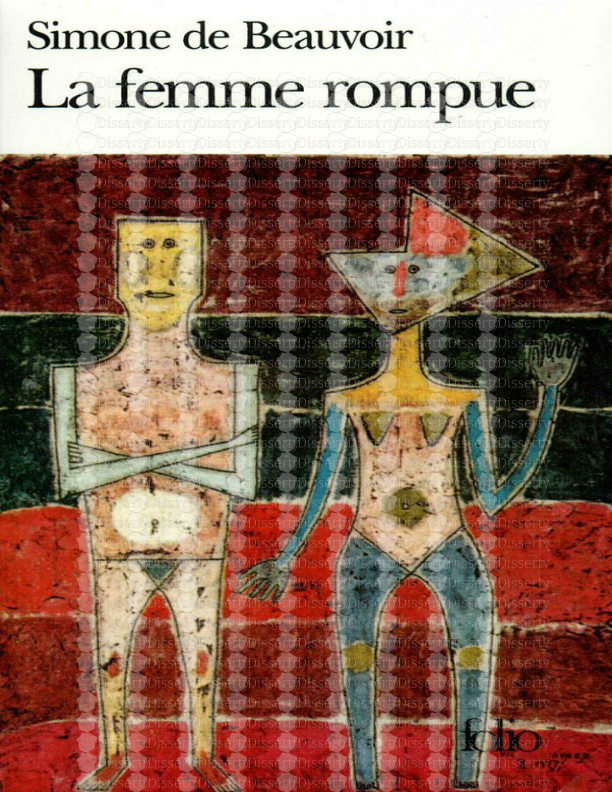




-
39
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 29, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1513MB


