Capitalisme et esclavage Eric Williams avec une nouvelle introduction par COLIN
Capitalisme et esclavage Eric Williams avec une nouvelle introduction par COLIN A. PALMER La presse de l'Université de Caroline du Nord Chapel Hill et Londres © 1944, 1994 L'Université de Presse de Caroline du Nord Tous les droits sont réservés Fabriqué aux États-Unis d'Amérique Données de catalogage avant publication de la Bibliothèque du Congrès Williams, Eric Eustache, 1911- Capitalisme & esclavage / par Eric Williams ; avec une nouvelle introduction par Colin A. Palmer. p. cm. Publié à l'origine : 1944. Comprend des références bibliographiques et un index. ISBN 0-8078-2175-6 (tissu : papier alk.) ISBN 0-8078-4488-8 (pbk. : papier alk.) 1. Grande-Bretagne—Industries—Histoire. 2. Traite des esclaves—Grande Bretagne. I. Titre. II. Titre : Capitalisme et esclavage. CH 254.5. W 5 1994 338.0941—dc20 94-8722 CIP L'article de ce livre respecte les directives de permanence et de durabilité du Comité des directives de production pour la longévité des livres du Council on Library Resources. 98 97 96 95 94 6 5 4 3 2 Au professeur Lowell Joseph Ragatz dont les travaux monumentaux dans ce domaine peuvent être amplifiés et développés mais ne peuvent jamais être dépassés CONTENU Préface Introduction par Colin A. Palmer 1. L'origine de l'esclavage nègre 2. Le développement de la traite négrière 3. Commerce britannique et commerce triangulaire 4. L'intérêt des Indes occidentales 5. L'industrie britannique et le commerce triangulaire 6. La Révolution américaine 7. Le développement du capitalisme britannique , 1783-1833 8. Le nouvel ordre industriel 9. Le capitalisme britannique et les Antilles 10. « La partie commerciale de la nation » et l'esclavage 11. Les « saints » et l'esclavage 12. Les esclaves et l'esclavage 13. Conclusion Remarques Bibliographie Indice PRÉFACE La présente étude est une tentative de placer dans une perspective historique la relation entre le capitalisme primitif tel qu'il est illustré par la Grande-Bretagne, et la traite des Noirs, l'esclavage des Noirs et le commerce colonial général des XVIIe et XVIIIe siècles. Chaque époque réécrit l'histoire, mais particulièrement la nôtre, qui a été forcée par les événements de réévaluer nos conceptions de l'histoire et du développement économique et politique. Les progrès de la révolution industrielle ont été traités plus ou moins adéquatement dans de nombreux livres à la fois savants et populaires, et ses leçons sont assez bien établies dans la conscience de la classe instruite en général et de ceux en particulier qui sont responsables de la création et de la orientation d'une opinion éclairée. D'un autre côté, alors que du matériel a été accumulé et des livres ont été écrits sur la période qui a précédé la révolution industrielle, la nature mondiale et interdépendante du commerce de cette période, son effet direct sur le développement de la révolution industrielle, et l'héritage qu'il a laissé sur la civilisation d'aujourd'hui n'a nulle part été placé dans une perspective compacte et pourtant globale. Cette étude s'y essaie, sans toutefois manquer de donner des indications sur l'origine économique de courants sociaux, politiques, voire intellectuels bien connus. Le livre, cependant, n'est pas un essai d'idées ou d'interprétation. Il s'agit strictement d'une étude économique du rôle de l'esclavage des Noirs et de la traite des esclaves dans la fourniture du capital qui a financé la révolution industrielle en Angleterre et du capitalisme industriel mature dans la destruction du système esclavagiste. Il s'agit donc d'abord d'une étude d'histoire économique anglaise et d'une seconde d'histoire antillaise et noire. Il ne s'agit pas d'une étude de l'institution de l'esclavage mais de la contribution de l'esclavage au développement du capitalisme britannique. De nombreuses dettes doivent être reconnues. Le personnel des institutions suivantes était très gentil et serviable avec moi : British Museum ; Bureau des archives publiques ; Bibliothèque du Bureau de l'Inde ; Comité des Indes occidentales ; Bibliothèque de Rhodes House, Oxford ; Bureau d'enregistrement de la Banque d'Angleterre ; la Société britannique de protection contre l'esclavage et les aborigènes ; Maison des Amis, Londres ; Bibliothèque John Rylands , Manchester ; Bibliothèque centrale, Manchester ; Bibliothèque publique, Liverpool ; Musée Wilberforce, Hull; Bibliothèque du Congrès; Biblioteca Nacional, La Havane ; Sociedad Económica de Amigos del País, La Havane. Je souhaite remercier la Newberry Library, Chicago, pour sa gentillesse de me permettre, grâce à un prêt entre bibliothèques avec Founders' Library, Howard University, de voir les précieuses statistiques de Sir Charles Whitworth sur « State of the Trade of Great Britain dans ses importations et exportations, progressivement à partir de l'année 1697-1773. Mes recherches ont été facilitées par des subventions de différentes sources : le gouvernement de Trinidad, qui a accordé une bourse originale ; l'Université d'Oxford, qui m'a décerné deux bourses d'études supérieures ; le Beit Fund pour l'étude de l'histoire coloniale britannique, qui a accordé deux subventions ; et la Fondation Julius Rosenwald, qui m'a décerné des bourses en 1940 et 1942. Le professeur Lowell J. Ragatz de l'Université George Washington de cette ville, le professeur Frank W. Pitman du Pomona College, Claremont, Californie, et le professeur Melville J. Herskovits de la Northwestern University, ont très aimablement lu le manuscrit et fait de nombreuses suggestions. Tout comme mon collègue senior à l'Université Howard, le professeur Charles Burch. Le Dr Vincent Harlow, aujourd'hui professeur Rhodes d'histoire impériale à l'Université de Londres, a supervisé ma thèse de doctorat à Oxford et a toujours été très utile. Enfin, ma femme m'a été d'une grande aide pour prendre mes notes et taper le manuscrit. Université Eric Williams Howard Washington, DC 12 septembre 1943 INTRODUCTION Colin A. Palmer Peu d'ouvrages d'histoire moderne ont bénéficié de l'impact intellectuel durable et de l'attrait de Capitalism and Slavery d'Eric Williams . Sa publication en 1944 a été saluée par des acclamations dans certains milieux et de sévères critiques dans d'autres. Le débat scientifique sur ses conclusions se poursuit cinquante ans plus tard sans aucun signe de ralentissement. Cet ouvrage classique d'un universitaire antillais reste la contribution la plus provocatrice à l'étude de la relation complexe entre la traite négrière africaine, l'esclavage, la montée du capitalisme britannique et l'émancipation de la population esclavagiste aux Antilles. Eric Eustace Williams est né à Trinidad en 1911. Jeune homme intellectuellement doué, il a fréquenté le Queen's Royal College, l'une des meilleures écoles secondaires de l'île. En 1931, il reçut la bourse de l'île solitaire et en 1932, il s'inscrivit à l'Université d'Oxford, où il prépara un diplôme en histoire moderne. A Oxford, comme à Trinidad, Williams a été exposé à des courants intellectuels qui célébraient la connexion impériale et accordaient peu d'influence aux peuples d'ascendance africaine dans les colonies. Rappelant ses années de formation à Trinidad, Williams a noté : « L'équipement intellectuel dont j'ai été doté par le système scolaire de Trinidad avait deux caractéristiques principales : quantitativement, il était riche ; qualitativement c'était britannique. « Soyez britannique » était le slogan non seulement de la législature mais aussi de l'école. » 1 Au fur et à mesure qu'il grandissait intellectuellement à Oxford, le jeune colonial en est venu à remettre en question, et finalement à rejeter, une analyse centrée sur l'impérialisme de l'histoire de son peuple. Lors de ses rencontres avec son tuteur, R. Trevor Davies, par exemple, Williams a rapporté qu'il systématiquement « a pris une ligne indépendante ». 2 L'étudiant intellectuellement curieux a passé près de sept ans à Oxford, recevant le doctorat. en décembre 1938. Sa thèse, « Les aspects économiques de l'abolition de la traite des esclaves antillais et de l'esclavage » seront révisés, développés et publiés cinq ans plus tard. Williams a accepté un poste d'enseignant à l'Université Howard en 1939. Là, il a poursuivi ses recherches, approfondissant sa thèse et mettant un accent particulier sur la relation entre l'esclavage et la montée du capitalisme britannique. Williams a également établi des contacts avec les professeurs Lowell Ragatz de l'Université George Washington et Frank Pitman du Pomona College. Les deux érudits étaient des autorités de premier plan sur l'histoire de la pré-émancipation des Antilles britanniques. Agissant sur les conseils de Ragatz, Williams a soumis son manuscrit terminé à l'University of North Carolina Press le 17 février 1943. Dans sa lettre à William T. Couch, le directeur, l'auteur a écrit qu'il espérait que le livre "est à la hauteur des des normes élevées de votre presse autant qu'il semblerait s'accorder avec l'ensemble des travaux sur l'esclavage des Noirs que le monde intellectuel a appris à associer à l'Université de Caroline du Nord. » 3 Il a noté que le manuscrit avait été lu par Pitman et Ragatz et que ses recherches avaient été soutenues par deux bourses Rosenwald qu'il a reçues en 1940-1941 et en 1942. La lettre de Williams était accompagnée d'un prospectus d'une page décrivant le livre et sa thèse principale. Le livre, a-t-il dit, « tente de placer dans une perspective historique la relation entre le capitalisme primitif en Europe, tel qu'illustré par la Grande-Bretagne, et la traite négrière et l'esclavage des Noirs aux Antilles. Il montre comment le capitalisme commercial du XVIIIe siècle s'est construit sur l'esclavage et le monopole, tandis que le capitalisme industriel du XIXe siècle a détruit l'esclavage et uploads/Litterature/ capitalisme-et-esclavage.pdf
Documents similaires









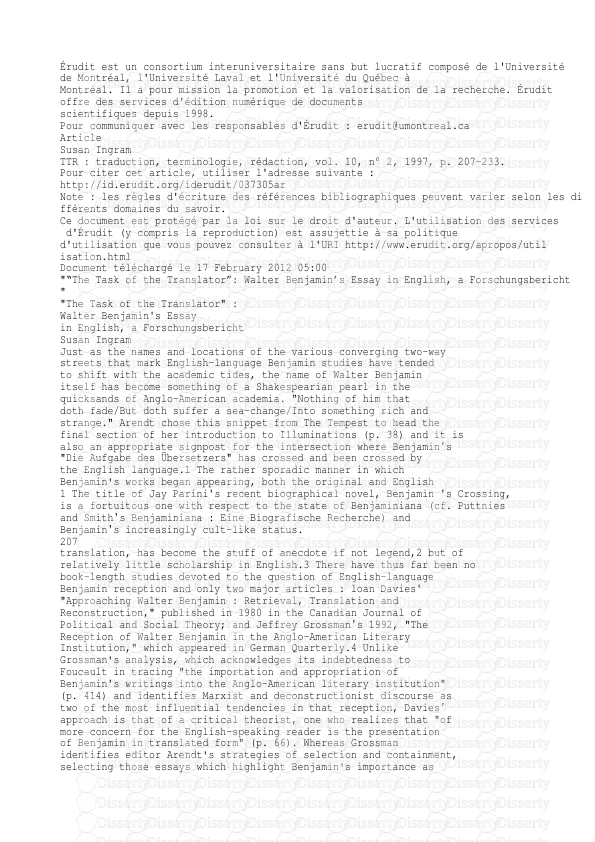
-
67
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 12, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 1.9164MB


