Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l'Univ
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l'Université de Montréal, l'Université Laval et l'Université du Québec à Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche. Érudit offre des services d'édition numérique de documents scientifiques depuis 1998. Pour communiquer avec les responsables d'Érudit : erudit@umontreal.ca Compte rendu Mélissa Dufour et Maude Poissant Études littéraires, vol. 37, n° 1, 2005, p. 133-141. Pour citer ce compte rendu, utiliser l'adresse suivante : URI: http://id.erudit.org/iderudit/012830ar DOI: 10.7202/012830ar Note : les règles d'écriture des références bibliographiques peuvent varier selon les différents domaines du savoir. Ce document est protégé par la loi sur le droit d'auteur. L'utilisation des services d'Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d'utilisation que vous pouvez consulter à l'URI http://www.erudit.org/apropos/utilisation.html Document téléchargé le 21 novembre 2014 05:58 « Contours de l’essai. : repères bibliographiques (1995-2005) » Contours de l’essai. Repères bibliographiques (1995-2005) MÉLISSA DUFOUR ET MAUDE POISSANT B ien que l’essai ait, ces dernières années, suscité un intérêt grandissant auprès de la critique et trouvé une place ne serait-ce que modeste et condition- nelle (Gérard Genette) aux côtés des genres canoniques, sa saisie demeure une entreprise complexe et parfois hasardeuse. Le genre découlant de l’imposante œuvre de Montaigne résiste aujourd’hui encore à la théorisation. Apparaissant comme l’un des objets les plus fuyants du point de vue générique, il soulève des interrogations toujours renouvelées: qu’est-ce que l’essai? une forme inachevée, hétérogène, se remettant elle-même constamment en question et échappant à toute saisie trop catégorique? Il semble pourtant y avoir une ouverture nouvelle dans les récents travaux portant sur l’essai; plutôt que de tenter de définir le genre de fa- çon rigide et universelle, on s’attache davantage à l’étude des caractéristiques qui lui sont propres, aux traits définitoires qui permettent de le comprendre. Il faut par ailleurs reconnaître que certains aspects longtemps laissés de côté par la critique sont de plus en plus investis par les recherches, telles la question de la fiction et celle de la mise en recueil1, aspects qui permettent d’étudier avec un autre regard les enjeux formels, génériques et pragmatiques de l’essai. Puisqu’il s’agissait pour nous de faire un bilan actuel des travaux sur l’essai, nous avons répertorié les ouvrages récents (de 1995 à aujourd’hui) qui présentaient une réflexion d’ordre général sur le genre. Par conséquent, cette bibliographie ne se veut pas représentative de l’ensemble des travaux con- sacrés à l’essai. De nombreuses études de cas, même très pertinentes2, n’ont pas été retenues parce qu’elles ne s’articulaient pas autour de la problématique 1 Quelques études qui examinent le rapport entre essai et mise en recueil sont publiées dans le collectif sous la direction d’Irène Langlet, Le recueil littéraire. Pratiques et théorie d’une forme, 2003. 2 À titre d’exemple: les collectifs Alexandre Gefen et René Audet (dir.), Frontières de la fiction, 2002 et Robert Dion, Frances Fortier et Élisabeth Haghebaert (dir.), Enjeux des genres dans les écritures contemporaines, 2001, comportent plusieurs articles traitant de questions actuelles autour de l’essai. large de l’essai ou encore parce qu’elles s’orientaient autour de l’œuvre d’un seul essayiste3. La pluralité des approches de l’essai nous a conduites à répartir les ouvrages retenus en trois sections. En majorité, les études et travaux répertoriés abordent plusieurs aspects relatifs à l’essai en combinant souvent différents angles (géné- ricité, pragmatique, énonciation, approche historique, etc.). C’est dire qu’à l’image des frontières de l’objet qu’elle veut cerner, les frontières de cette bibliographie ne sont pas étanches. Nous avons, pour l’essentiel, procédé en considérant les axes dominants de chacune des études et les avons regroupées sous trois bannières, en fonction de l’aspect le plus important qu’elles développent ou de l’approche principale qu’elles adoptent. La première section, «Parcours de l’essai», comprend deux anthologies et les ouvrages qui abordent surtout l’essai dans son historicité (tant l’histoire de sa forme que celle des théories et approches la concernant), alors que la deuxième, «Théories et discours sur l’essai», regroupe des ouvrages qui se consacrent davan- tage à l’analyse d’une ou de plusieurs caractéristiques de l’essai. Bien que ces deux points de vue aient, le plus souvent, une incidence l’un sur l’autre — l’étude de la forme et du genre laisse rarement de côté la question de l’histoire et vice versa — et que, d’une certaine façon, ces sections se recoupent, il nous a paru important de maintenir ces délimitations qui contribuent à donner un aperçu global des principales orientations de la recherche. La problématique du recueil, la fiction dans l’essai ainsi que l’inscription du sujet dans le texte sont réunies, à titre de nou- veaux champs d’intérêt, dans la troisième section. Les questions de la fiction et du sujet sont rassemblées, s’agissant vraisemblablement de deux facettes d’un même problème, puisque la fiction de l’essai réside précisément dans l’ambiguïté du «je» de l’essayiste qui, s’il n’est pas «purement» fictif, n’en relève pas moins d’une cer- taine posture et d’une certaine rhétorique. La transgénéricité est également abordée dans certaines études autour de cas qui mêlent le narratif et l’essayistique. 134 • Études littéraires – Volume 37 Nº 1 – Automne 2005 3 C’est le cas des ouvrages s’intéressant à l’œuvre d’essayistes «canoniques»: citons le cas, en France, de Roland Barthes (voir par exemple Marielle Macé et Alexandre Gefen (dir.), Barthes, au lieu du roman, 2002) et celui, au Québec, de Jacques Brault (voir Frédérique Bernier, Les essais de Jacques Brault. De seuils en effacements, 2004). Références BERNIER, Frédérique, Les essais de Jacques Brault. De seuils en effacements, Montréal, Fides, 2004. DION, Robert, Frances FORTIER et Élisabeth HAGHEBAERT (dir.), Enjeux des genres dans les écritures contemporaines, Québec, Nota bene, 2001. GEFEN, Alexandre et René AUDET (dir.), Frontières de la fiction, Québec / Bordeaux, Nota bene / Presses universitaires de Bordeaux, 2002. LANGLET, Irène (dir.), Le recueil littéraire. Pratiques et théorie d’une forme, Rennes, Presses universitaires de Rennes (Interférences), 2003. MACÉ, Marielle et Alexandre GEFEN (dir.), Barthes, au lieu du roman, Québec / Paris, Nota bene / Desjonquères, 2002. Contours de l’essai... de Mélissa Dufour et Maude Poissant • 135 1. PARCOURS DE L’ESSAI ■CHASSAY, Jean-François (dir.), Anthologie de l’essai au Québec depuis la Révolution tranquille, Montréal, Boréal, 2003, 271 p. Rappelant le flou théorique autour de l’essai qui incite à adopter tantôt une conception trop rigide, tantôt une conception trop vaste, Chassay choisit de partir du «centre», c’est-à-dire de ne regrouper que des textes qui sont d’abord et stricte- ment des essais. Puisque 1960 est une date charnière pour le Québec culturel et des idées (essor dans tous les domaines), les textes choisis ont été écrits à partir du début des années 1960. L’anthologie est divisée en sept parties: 1. «Europe, Amé- rique», 2. «Grande histoire, petite histoire», 3. «Politique», 4. «Culture et société», 5. «Féminisme», 6. «Langue», 7. «Écrire, lire, peindre». ■CHEVALIER, Tracy (dir.), Encyclopedia of the Essay, London, Fitzroy Dearborn, 1997, 900 p. Cette encyclopédie rassemble la plupart des grands essayistes de différentes nationalités. Les entrées consacrées à chaque auteur sont généralement substan- tielles et riches de renseignements. Chacune d’elles regroupe des considérations autobiographiques, historiques et bibliographiques en plus de tracer le parcours de l’œuvre de l’essayiste. Des entrées sont également consacrées aux différents types d’essais, aux termes voisins (aphorisme, maxime, méditation, pamphlet, etc.), aux revues et journaux associés à l’essai, etc. ■GLAUDES, Pierre et Jean-François LOUETTE, L’essai, Paris, Hachette Supérieur (Contours littéraires), 1999, 176 p. Les auteurs s’intéressent à la position particulière de l’essai dans le champ littéraire. Survolant différents aspects problématiques du genre, Glaudes et Louette convoquent surtout des études antérieures et les synthétisent. Ils proposent des pistes de réflexion générales qui tentent de saisir ce genre mouvant ainsi qu’une proposition de définition très large et fortement inspirée des travaux de Marc Angenot, laquelle permet d’englober quantité de textes résistant aux définitions précédentes («Prose non fictionnelle à visée argumentative»), mais qui éloigne de la spécificité de l’essai littéraire. Glaudes et Louette structurent leur étude en trois «logiques»: la généalogie de l’essai de Michel de Montaigne à Roland Barthes, l’analogie, qui permet de saisir les liens entre les formes de l’essai afin d’en déga- ger un modèle, et la pragmatique de l’essai, de laquelle découle leur proposition de «véridicité conditionnelle». ■GLAUDES, Pierre (dir.), L’essai: métamorphoses d’un genre, Toulouse, Presses universitaires du Mirail (Cribles), 2002, 472 p. Ce collectif s’intéresse à l’essai dans une perspective générale. Il est divisé en quatre parties qui, bien que rassemblant les études autour de problématiques 136 • Études littéraires – Volume 37 Nº 1 – Automne 2005 précises, brossent un tableau assez large de la question. À partir de diverses ap- proches (lexicologie, mélange des genres, comparaison entre texte scientifique et essai, etc.), la première partie propose de fournir des éléments de définition de l’essai en étudiant les contours du genre. Les textes de la deuxième partie s’at- tardent surtout aux origines de l’essai et à la rhétorique (aux Essais de Montaigne, mais aussi à ses prédécesseurs). La troisième partie, plus brève, traite de l’essayisme à l’âge classique, plus particulièrement des essayistes britanniques dont les œuvres sont à caractère philosophique (Bacon, uploads/Litterature/ dufour-et-poissant-contours-de-l-x27-essai 1 .pdf
Documents similaires




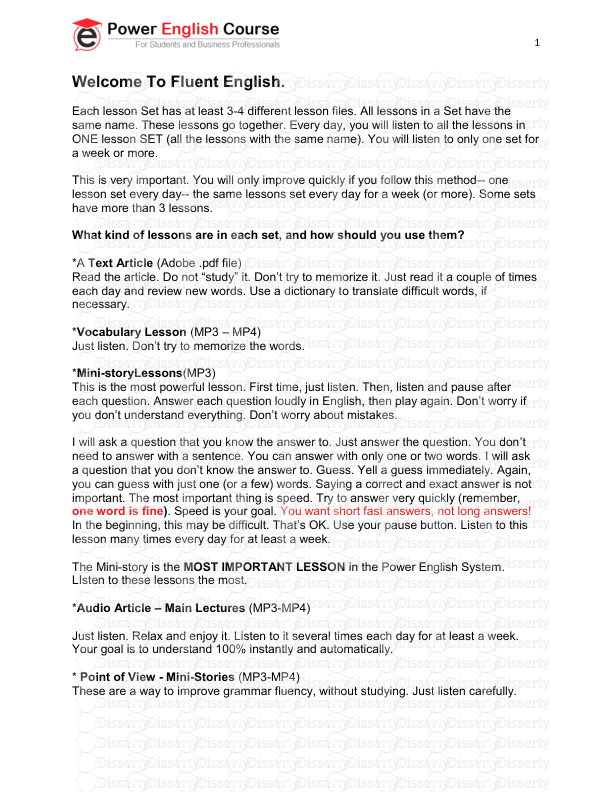





-
50
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 24, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1386MB


