ACCUEIL Eau céleste et oxydoréduction Frédéric ELIE, novembre 2004 La reproduct
ACCUEIL Eau céleste et oxydoréduction Frédéric ELIE, novembre 2004 La reproduction des articles, images ou graphiques de ce site, pour usage collectif, y compris dans le cadre des études scolaires et supérieures, est INTERDITE. Seuls sont autorisés les extraits, pour exemple ou illustration, à la seule condition de mentionner clairement l’auteur et la référence de l’article. Voici quelques expériences très simples avec du sulfate de cuivre: fabrication de l'eau céleste, déshydratation et réhydratation du sulfate de cuivre, mise en évidence d'une réaction d'oxydo-réduction entre le cuivre et le zinc. Quelques notions sur les hydroxydes seront introduites en cette occasion... sulfate de cuivre présentation: Le sulfate de cuivre est un sel de cuivre, se présentant sous la forme pentahydratée (c'est-à- dire associée à 5 molécules d'eau), de formule: (CuSO4 - 5H2O). Sa présentation commerciale en poudre bleue correspond à cette forme hydratée. Dissoute dans l'eau jusqu'à saturation cette poudre donne une solution liquide bleue, jadis appelée le vitriol bleu. Masse volumique de la poudre: 2,284 g/cm3. A l'état naturel le sulfate de cuivre se trouve dans la chalcanthite (voir photo). minerai de cuivre de chalcanthite forme cristalline: prismatique ou tabulaire minerai soluble dans l'eau: au contact de l'air humide, se décompose lentement en poudre verdâtre (le sulfate de cuivre doit donc être conservé dans un emballage étanche) source photo: guide des minéraux Hachette ©Frédéric Élie, novembre 2004 - http://fred.elie.free.fr - page 1/23 Obtention par le procédé Oker: par dissolution de granulés de cuivre dans l'acide sulfurique dilué et chaud, et barbotage de l'air: 2Cu + O2 + 2H2SO4 + 3H2O → 2CuSO4-5H2O expérience 1: obtention de cristaux On peut obtenir des cristaux de sulfate de cuivre à partir d'une solution de la manière suivante: • obtenir une solution saturée de sulfate de cuivre à partir de la poudre: verser dans un bécher de l'eau, puis de la poudre que l'on mélange à l'eau, au fur et à mesure jusqu'à ce qu'elle ne se dissolve plus dans la solution. Verser en le filtrant l'ensemble dans un autre bécher: la solution obtenue, séparée des parties solides qui n'ont pas pu se dissoudre et retenues par le filtre, est la solution saturée. • mettre à chauffer la solution saturée (attention: le bécher ne doit pas être au contact de la flamme, utiliser un support conducteur de la chaleur). Pendant le chauffage, jusqu'à ébullition, ajouter progressivement de la poudre tant qu'elle arrive à se dissoudre. • lorsque la poudre ne se dissout plus et reste solide au fond du bécher, arrêter le chauffage • retirer avec précaution le bécher du brûleur, le poser sur une surface non froide, et laisser refroidir pendant plusieurs minutes. Au cours du refroidissement j'ai observé la formation de cristaux au fond du bécher et à la surface. Si un fil a été placé au milieu de la solution dès le début du refroidissement, les cristaux se forment aussi sur lui. • à la fin, lorsque la solution est parfaitement refroidie, retirer les cristaux et le fil au bout duquel se sont amalgamés des cristaux. Vus à la loupe, ils présentent des facettes rhomboédriques. Voir photos ci-après: cristallisation du sulfate de cuivre pendant le refroidissement d'une solution saturée (photo: F. Elie) cristaux de sulfate de cuivre après refroidissement d'une solution saturée - à droite, les cristaux se sont agglomérés sur un fil qui trempait dans la solution (photo: F. Elie) déshydratation et réhydratation du sulfate de cuivre ©Frédéric Élie, novembre 2004 - http://fred.elie.free.fr - page 2/23 expérience 2: déshydratation Les cristaux de sulfate de cuivre hydraté sont des édifices atomiques où sont incluses des molécules d'eau. Celles-ci sont enlevées par chauffage: Au fond d'un bécher verser un peu de poudre bleue de sulfate de cuivre hydraté, et le faire chauffer (rappel: pas de flamme en contact direct avec le récipient!) Les cristaux virent du bleu au gris, tandis que de la buée se dépose au col du bécher, signe d'une perte de l'eau. La poudre gris clair qui reste au fond du bécher après chauffage est du sulfate de cuivre anhydre CuSO4 (photo ci-après). à gauche: sulfate de cuivre hydraté à droite: sulfate de cuivre anhydre obtenu par chauffage du précédent (photo: F. Elie) expérience 3: réhydratation du sulfate de cuivre anhydre Lorsqu'on verse un peu de sulfate de cuivre anhydre (expérience 2) sur un papier filtre imbibé d'eau, il devient bleu très rapidement: il s'est réhydraté. Une autre façon de montrer la réhydratation est la suivante: dissoudre la poudre de sulfate de cuivre anhydre dans l'eau. la solution obtenue devient bleue. Un thermomètre plongé dans l'eau montre une augmentation de la température au cours de la dissolution et de la réhydratation (T passe de 19°C à 22°C dans mon expérience): le processus est légèrement exothermique (photos ci-après). ©Frédéric Élie, novembre 2004 - http://fred.elie.free.fr - page 3/23 réhydratation du sulfate de cuivre anhydre au contact d'un papier filtre humidifié (photo F. Elie) propriété exothermique de la dissolution et de la réhydratation du sulfate de cuivre anhydre dans l'eau (photo: F. Elie) caractère acide de la solution de sulfate de cuivre expérience 4: sulfate de cuivre dans l'éthanol Si on verse de la poudre de sulfate de cuivre dans l'éthanol (alcool éthylique) et qu'on remue on s'aperçoit que les cristaux ne disparaissent pas: le sulfate de cuivre n'est pas soluble dans l'éthanol (voir photo); on montrerait de même qu'il l'est très peu dans le méthanol. le sulfate de cuivre reste non dissout dans l'éthanol (photo F. Elie) expérience 5: pH de la solution de sulfate de cuivre Par contre, comme on l'a vu le sulfate de cuivre est complètement soluble dans l'eau. C'est une solution légèrement acide: avec du papier pH on trouve pH ≈ 5 pour la solution utilisée dans l'expérience (voir photo). On doit donc s'attendre à une réaction de neutralisation par une base. ©Frédéric Élie, novembre 2004 - http://fred.elie.free.fr - page 4/23 caractère acide de la solution de sulfate de cuivre saturée (photo: F. Elie) formation d'hydroxydes expérience 6: hydroxyde de cuivre Dans un tube à essai contenant une solution de sulfate de cuivre (acide), verser une solution de soude NaOH (base): la neutralisation de l'acide par la base s'accompagne d'un précipité bleu, d'aspect gélatineux: c'est un hydroxyde métallique, l'hydroxyde de cuivre Cu(OH)2 (voir photo ci-après): CuSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Cu(OH)2↓ L'hydroxyde de cuivre ne se dissout pas dans un excès de soude, comme on peut le constater en continuant d'ajouter de la soude. Remarque 1: dans la réaction précédente, on obtient aussi un sel, le sulfate de sodium Na2SO4, dissout dans la solution. A l'état non dilué ce sel, hydraté, se présente sous forme de cristaux incolores et prismatiques appelés sel Glauber Na2SO4-10H2O tant que la température est inférieure à 32°C. Au-dessus il est anhydre et cristallise sous forme rhomboédrique. Remarque 2: l'hydroxyde de cuivre peut se déshydrater par simple chauffage, en donnant l'oxyde de cuivre (insoluble) et de l'eau: Cu(OH)2 → CuO + H2O et les solutions acides réagissent avec l'oxyde de cuivre pour donner l'aquacomplexe de cuivre de la solution de sulfate de cuivre (voir expérience 7): CuO + 2H3O+ + H2O → Cu(H2O)4 2+ ©Frédéric Élie, novembre 2004 - http://fred.elie.free.fr - page 5/23 réaction de la soude sur une solution de sulfate de cuivre: formation d'un précipité bleu d'hydroxyde de cuivre (photo: F. Elie) expérience 7: l'eau céleste Récupérer le précipité d'hydroxyde de cuivre de l'expérience 6, par filtration de l'ensemble et retrait de toute trace liquide de la solution. Mettre un échantillon dans un tube à essai propre et ajouter de l'ammoniaque (l'ammoniaque est la solution aqueuse de l'ammoniac NH3 : c'est une base NH4 +OH- issue de la réaction de dissolution du gaz ammoniac dans l'eau NH3 + H2O → NH4 + + OH- Boucher le tube et secouer jusqu'à disparition complète de la phase solide. On obtient un liquide d'un bleu profond: c'est l'eau céleste (voir photo ci-après). eau céleste (photo: F. Elie) Pour comprendre cette formation, il faut d'abord prendre en compte que, dans la solution de sulfate de cuivre, l'ion cuivrique Cu2+ existe sous forme d'un aquacomplexe Cu(H2O)4 2+, et que ©Frédéric Élie, novembre 2004 - http://fred.elie.free.fr - page 6/23 c'est ce dernier qui réagit avec la base (comme ici l'ammoniaque). On a alors: formation d'aquacomplexe en solution: CuSO4 + 4H2O → Cu(H2O)4 2+ + SO4 2- réaction avec l'ammoniaque: Cu(H2O)4 2+ + 4(NH4 + + OH-) → Cu(NH3)4 2+ + 8H2O (1) qui fournit le complexe Cu(NH3)4 2+ caractéristique de l'eau céleste (je donnerai plus loin quelques explications sur les complexes). On remarquera que l'on obtient le même produit avec d'autres réactions: • dissolution par l'ammoniaque du précipité d'hydroxyde de cuivre obtenu précédemment; la solution obtenue a un caractère basique (présence d'ion hydroxyde): Cu(OH)2 + 4(NH4 + + OH-) → Cu(NH3)4 2+ + 4H2O + OH- • dissolution des cristaux de sulfate de cuivre par l'ammoniaque: CuSO4 + 4(NH4 + + OH-) → Cu(NH3)4 2+ + 4H2O + SO4 2- • action du gaz ammoniac NH3 sur une solution de sulfate de cuivre: lors de sa dissolution uploads/Litterature/ eau-celeste-oxydoreduction.pdf
Documents similaires

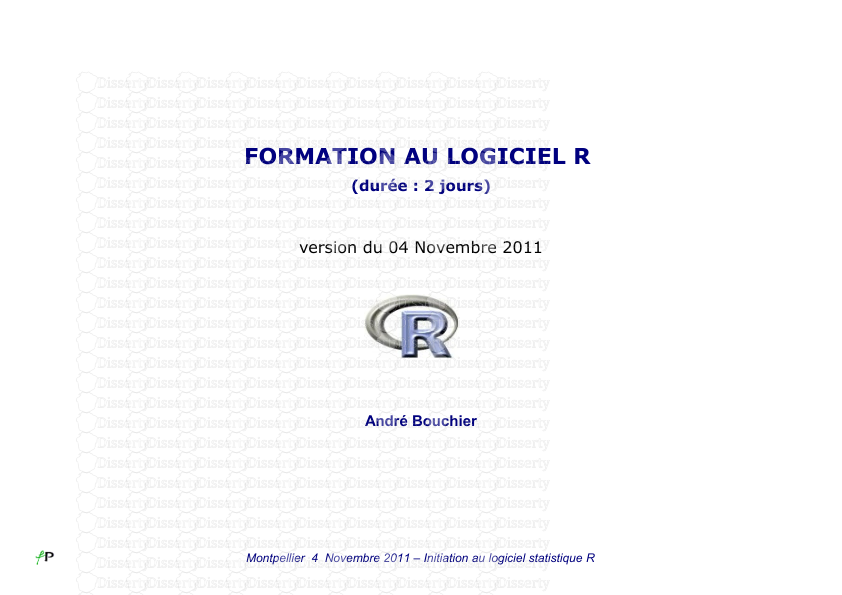








-
29
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 18, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.4531MB


