Jacques E. Ménard La structure et la langue originale de l'Évangile de vérité I
Jacques E. Ménard La structure et la langue originale de l'Évangile de vérité In: Revue des Sciences Religieuses, tome 44, fascicule 1-2, 1970. Mémorial du cinquantenaire de la Faculté de théologie catholique 1919-1969 (II suite et fin) pp. 128-137. Résumé La recherche de ces dernières années sur l'Évangile de Vérité s'est très intéressée à la langue et à la structure du nouvel écrit de Nag Hamadi. Certains sont de l'opinion que l'Évangile de Vérité est d'origine égyptienne ou copte (Fecht), d'autres, qu'il est d'origine syriaque (Nagel), d'autres, enfin, qu'il est d'origine grecque (Ménard, Böhlig). Il semble beaucoup plus qu'on soit en présence d'un phénomène de bilinguisme, où des expressions ou des tournures grecques sont empruntées à celles du syriaque, plus particulièrement. Mais si l'auteur ou les auteurs ou, encore, le rédacteur final pensaient syriaque, ils n'en écrivaient pas moins en un grec qui demeure hellénistique. Citer ce document / Cite this document : Ménard Jacques E. La structure et la langue originale de l'Évangile de vérité. In: Revue des Sciences Religieuses, tome 44, fascicule 1-2, 1970. Mémorial du cinquantenaire de la Faculté de théologie catholique 1919-1969 (II suite et fin) pp. 128-137. doi : 10.3406/rscir.1970.2582 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rscir_0035-2217_1970_num_44_1_2582 Jacques MÉNARD Professeur d'histoire et d'archéologie bibliques LA STRUCTURE ET LA LANGUE ORIGINALE DE L'EVANGILE DE VERITE Un des mystères les plus obscurs qui enveloppe cet écrit gnosti- que copte de la découverte de Nag Hamadi est celui de sa structure ou de sa composition et de sa langue. G. Fecht (1) s'est basé sur une métrique égyptienne apparentée à celle de maints écrits hiéroglyphiques pour diviser l'Evangile de Vérité en plusieurs strophes. Il soutient que l'ouvrage fut directement écrit en copte, bien que son auteur ait pu l'écrire en même temps en grec, le grec étant à l'époque une langue courante en Egypte. La première partie de l'Evangile de Vérité, la seule étudiée par Fecht, traite de la rédemption grâce à la découverte par le Tout, jusqu'ici séparé du Père, de cette connaissance surnaturelle transmise par le Christ dans son enseignement et dans sa mort sur la Croix. Cette première partie comprend cent vingt versets et quinze strophes, le tout faisant trois chapitres. Le premier chapitre est consacré aux relations du Père et du Tout : à l'ignorance succède maintenant une connaissance mutuelle. Ce chapitre est constitué de quatre strophes et de trente versets. La première strophe de huit versets (p. 16, 31-17, 4 de la pagination du Codex) exalte le salut opéré par la découverte du Père. La deuxième strophe de sept versets (p. 17, 5-21) décrit l'origine de la TcXdvyj. Cette dernière vient de l'ignorance du Tout qui, par contrecoup, a besoin d'une révéla- (1) Cf. Der erste « Teil » des sogenannten Evangelium Veritatis (S. 16, 31-22, 20), I : Kapitel* 1, Str. I-III ; II : Kapitel* 1, Str. IV-Kapitel4 2, Str. VII ; III : Kapitel4 2, Str. VIII-Kapitel* 3, Str. IX, dans Orientalia. 30-32 (1961-1963), p. 371-390 ; p. 85-119 ; p. 298-335. l'évangile de vérité 129 tion. La troisième strophe de huit versets (p. 17, 21-36) rejette la possibilité d'une relation du Père avec la matière ; elle expose au contraire les conséquences du combat de l'homme aux prises avec la TzXdvrj. A la quatrième strophe (p. 17, 36-18, 11) le Père est mis en rapport avec l'oubli, d'une part, et avec la connaissance, d'autre part. Cette connaissance a son origine en Lui et elle doit détruire l'oubli. Cette strophe comprend sept versets. Le deuxième chapitre traite de Jésus, qui n'est pas encore identifié au Livre. Eévélateur et maître, Jésus aide d'abord par sa crucifixion et en tant que fruit du Père à faire la découverte de ce dernier : il exprime Sa volonté et il est le symbole de la perfection à obtenir par la connaissance qui conduit à la conversion. Il a pourtant échoué devant les sages de cette terre. Trente versets et quatre strophes composent ce chapitre. Sa première strophe (ou Ve strophe de tout l'ensemble), qui est de six versets (p. 18, 11-21), présente Jésus, le Christ, mystère secret, qui révèle l'Evangile de celui qu'on recherche ; il est la première forme de la connaissance du Père, à laquelle il est identifié. La sixième strophe de huit versets (p. 18, 21-35) expose le premier aspect de la mort de Jésus en croix ; celui-ci y est comparé au fruit de la connaissance du Père dont les hommes doivent manger, s'ils veulent être réunis à ce dernier. La septième strophe (huit versets, p. 18, 36-19, 10) justifie l'attitude du Père de conserver pour lui-même la plénitude : elle explique le but de cette réserve. A la huitième strophe (huit versets, p. 19, 10-27) Jésus vient dans le monde comme maître de la connaissance du Père, mais il ne réussit pas à convaincre les sages. Le troisième chapitre identifie cette fois Jésus au Livre. C'est grâce à la révélation du Livre que l'enseignement est dispensé aux enfants prédestinés à la connaissance. L'auteur présente dans ce troisième chapitre le deuxième aspect de la crucifixion du Christ : le Livre est une disposition du Père attachée à la Croix, et Jésus est le maître de la connaissance et de la perfection pour les prédestinés. Ce chapitre comprend trente-cinq versets et quatre strophes. La première de ces strophes (la dernière de l'analyse de Fecht et la neuvième de tout l'ensemble [neuf versets, p. 19, 27-20, 6]) décrit la venue de Jésus, qui coïncide avec l'enseignement prodigué aux enfants qui possèdent la science et la révélation du Livre dans leur cœur. L'hypothèse de Fecht est ingénieuse. Un de ses mérites est de laisser clairement entendre, par exemple, que l'auteur de l'Evangile de Vérité passe d'une interprétation orthodoxe et temporelle de la 130 J. MÉNARD Croix (p. 18, 24) à une interprétation gnostique et atemporelle (p. 20, 6-25,35), c'est-à-dire du Jésus de la Passion au Livre, disposition du Père attachée à cette croix. La première interprétation refléterait une couche rédactionnelle primitive de l'écrit (2). Ce dernier pourrait toutefois ne vouloir révéler que lentement à ses lecteurs sa véritable interprétation de la Croix. En passant d'une strophe à l'autre, on se rend également compte que l'une appelle l'autre, qu'elles se complètent et s'expliquent mutuellement selon une logique qui progresse sans cesse. Ainsi les strophes VI et VII se terminent par le même verset et font ressortir les oppositions qui existent entre la connaissance et la icXàv/j, à moins que ces versets finaux ne soient que des doublets. La métrique des strophes est la même à l'intérieur d'un chapitre, mais différente d'un chapitre à l'autre. (2) Cf. id., ibid., 32 (1963), p. 316-320. Fecht s'oppose ainsi à l'opinion de W.-C. van Unnik, The « Gospel of Truth » and the New Testament, dans The Jung Codex, Londres, 1955, p. 79 s. ; R. -McL. Wilson, The Gnostic Problem, Londres, 1958, p. 163 ; P. Weigandt, Der Doketismus im Urehristentum und in der theologischen Entwicklung des zweiten Jahrhun- derts, Diss. Heidelberg, 1961, I, p. 93 ; H. Jonas, The Gnostic Eeligion 2. The Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity, Boston, 1963, p. 78, note 29 ; R.-McL. Wilson, Gnosis and the New Testament, Londres, 1968, p. 89-92, pour qui l'auteur de VEvangile de Vérité n'est pas encore complètement passé au gnosticisme. La p. 31, 4 ss. de l'écrit gnostique semble bien manifester pourtant un docétisme évident (ainsi S. Giversen, Sandhedens Evangelium. De gnostiske hândskrifter fra Nildalen, Copenhague, 1957, p. 66, 106 ; B. Gaertner, Evangelium Veritatis och Nya Testa- mentet, dans Eeligion och Bibel, 17 [1959], p. 63 ; Ringgren, Evangelium Veritatis och den valentianiska gnosis, dans Religion och Bibel, 17 [1959], p. 48 ; F.-M. Braun, Jean le théologien et son Evangile dans l'Eglise ancienne [E. B.], I, Paris, 1959, p. 119 ; B. Gaertner, The Theology of the Gospel of Thomas, Londres, 1961, p. 142 ; H. Ringgren, The Gospel of Truth and Valentinian Gnosticism, dans Vox Theologica, 18 [1964], p. 51- 65 contre G. Quispel, Neue Funde zur valentinianischen Gnosis, dans Z.B.G.G., 6 [1954], p. 294 ; J. Leipoldt, dans T.L.Z., 82 [1957], col. 832 ; K. Grobel, The Gospel of Truth. A Valentinian Meditation on the Gospel. Translation from the Coptic and Commentary, Londres, 1960, p. 22, 123 et H. Jonas, op. cit., p. 196, note 28 qui admettent un certain docétisme dans YEvangile de Vérité et surtout contre H.-M. Schenke, Die Herkunft des sogenannten Evangelium Veritatis, Goettingue, 1959, p. 27, 46 ; P. Weigandt, op. cit., p. 93, 153 qui pensent que la pensée du nouvel Evangile est antidocétiste et enfin contre S. Arai, Die Christologie des Evangelium Veritatis. Eine religionsgesehichtliche Untersuchung, Leyde, 1964 pour qui la christologie de l'écrit gnostique, tout en présentant certains traits gnostiques, n'est ni gnostique ni docétiste, mais pneumatique, cf. J.-E. Ménard, dans Novum Testamentum, 7 [1965], p. 332-334). l'évangile de vérité 131 Si l'hypothèse de Fecht est intéressante pour une meilleure compréhension de la structure de VEvangile de Vérité, elle l'est moins pour les détails de la uploads/Litterature/ la-structure-et-la-langue-originale-de-l-x27-evangile-de-verite-je-menard-pdf.pdf
Documents similaires









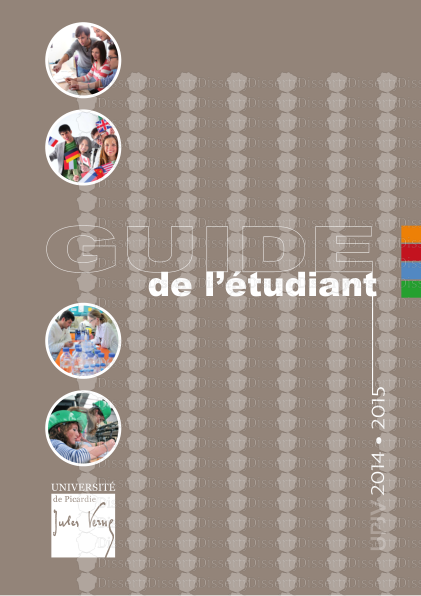
-
68
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 20, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.7862MB


