LACAN (Jacques) 1901-1981 Article écrit par Patrick GUYOMARD Prise de vue Jacqu
LACAN (Jacques) 1901-1981 Article écrit par Patrick GUYOMARD Prise de vue Jacques Lacan a dominé pendant trente ans la psychanalyse en France. Il l'a marquée de son style ; il y laisse une trace ineffaçable. Aimé et haï, adoré et rejeté, il a suivi sa voie sans s'en écarter, ne laissant personne indifférent, s'imposant même à ceux qui ne voulaient pas de lui. Pour les psychanalystes, son œuvre et sa pensée sont incontournables, quelles qu'en soient les contraintes, les difficultés, voire les limites. Il n'a pas seulement, comme les élèves de Freud puis les analystes de la seconde génération tels Melanie Klein, Donald W. Winnicott et Wilfred R. Bion, enrichi la psychanalyse d'un apport original et personnel. Il a été le seul à reprendre et refondre dans son ensemble l'œuvre du fondateur, et à lui rendre l'hommage de la cohérence des voies et des rigueurs auxquelles elle dut se plier pour produire et imposer l'existence de l'inconscient. Il fut le seul à se donner la double ambition de faire revivre une parole à ses yeux oubliée et trahie, et de tenter d'y égaler la sienne. I-Lacan le « stylite » Né à Paris dans une famille catholique et bourgeoise, il fut, après des études de médecine et de psychiatrie, interne de Gaétan Gatien de Clérambault, son « seul maître en psychiatrie » et l'un des rares qu'il se reconnût dans sa vie. En 1932, il soutient sa thèse de doctorat sur La Psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité. Thèse publiée, où se lisent un sens étonnant de la clinique, une culture et une érudition sans faille et un souci de l'exhaustion du sujet qui ne lui fait pas ignorer la psychanalyse, à une date où sa diffusion en France se heurte à des résistances et des préjugés inconnus dans d'autres pays. C'est une thèse de psychiatre ; il n'est pas encore psychanalyste. Il fréquente les surréalistes, qui saluent les premiers le caractère révolutionnaire des découvertes freudiennes. Ils les situent d'emblée dans le langage, en célèbrent les fonctions poétiques et se reconnaissent dans celui qui voit dans les productions de l'inconscient de véritables œuvres d'art. Lacan écrit sur le crime des sœurs Papin, s'intéresse à des paradoxes logiques et suit, à l'École pratique des hautes études, le séminaire d'Alexandre Kojève – un autre de ses maîtres – sur Hegel. Il y rencontre Raymond Aron, Raymond Queneau, Pierre Klossowski, Maurice Merleau-Ponty, Alexandre Koyré et Georges Bataille. En analyse avec Rudolph Loewenstein, il devient en 1934 membre adhérent de la Société psychanalytique de Paris. Deux ans plus tard, au XVIe congrès psychanalytique international de Marienbad, il fait une communication sur « Le Stade du miroir ». Son histoire se confond dès lors avec celle de la psychanalyse. Il fut un homme de parole, – la parole de l'analyste, qu'il souhaitait rompu à son exercice et dont elle est l'unique ressort, lui qui « se distingue en ce qu'il fait d'une fonction commune à tous les hommes un usage qui n'est pas à la portée de tout le monde, quand il porte la parole ». Contre toutes les objectivations et réductions de la parole à un pur usage d'information, il n'a cessé d'en rappeler la valeur constituante pour le sujet et pour toute vérité définissable dans le champ de l'inconscient. Sa parole fut aussi celle de l'enseignant du « séminaire » où, semaine après semaine, il sut avec génie donner vie – et parfois redonner vie – à la psychanalyse. Plusieurs générations d'analystes s'y formèrent, suivant le maître au long de ses déplacements. Son audience dépassa largement le cercle de ses auditeurs. On doit à cet enseignement – tout autant qu'à la publication, somme toute assez tardive, des Écrits – que, pour beaucoup, il soit impossible de penser sans la psychanalyse. Freud l'avait inventée avant lui, mais Lacan l'a d'une certaine manière redécouverte, lui rendant l'enthousiasme et la fraîcheur d'une nouveauté. Il l'a sortie d'un renfermement psychologique et médical, abâtardissant et obscurcissant, lui restituant contre tout réductionnisme la dimension d'une pensée. Il lui a insufflé son immense intérêt pour tous les champs de la création et du savoir, et s'est fait une éthique de défendre les analystes contre leur propre enfermement, fût-ce au prix de vouloir être leur maître. Conscient de sa valeur et sûr d'une réussite qu'il a cherchée et trouvée – lui qui faisait orgueilleusement sien le mot de Picasso : « Je ne cherche pas, je trouve » – ; il n'a rencontré nul obstacle que lui-même. Son œuvre déroute. Elle est difficile à qui n'a pas suivi les séminaires. Il l'a voulue telle, plus faite pour avoir des effets et déplacer le lecteur que pour s'intégrer sans dommage dans le champ du savoir. Il qualifiait lui-même avec malice ses Écrits d'« illisibles », ce qui ne le laissait pas en mauvaise compagnie. Son style est précieux, aphoristique et savant, clair et parfois emprunté, toujours fait pour surprendre et dérouter, s'adonnant volontiers au mélange des genres, classique jusqu'à ne pas refuser l'alexandrin, baroque comme il aimait le rappeler – « Jacques Lacan, le Góngora de la psychanalyse, pour vous servir » –, abstrait comme celui de Hegel et celui de Mallarmé, parcouru de trouvailles et de mots d'esprit, plus porté vers l'assertion et la métaphore poétique, avec des fulgurances rares, que vers le questionnement. « Le style, c'est l'homme même », aimait-il répéter après Buffon. Il fut l'inimitable – mais très imité – homme d'un style où sa pratique se mêla à sa parole et à son écriture. Saint psychanalyste, il mérite bien le nom de « stylite ». Il se défiait de toute mainmise, qu'elle vînt de ce qu'il appelait le commerce culturel ou de l'université, lieu de « l'ignorance enseignante », dont il n'espérait que le malentendu. Il théorisa cette défiance en décrivant le type de lien qu'institue le discours de l'université, qui ne peut, dans le champ de la psychanalyse, « que se tromper » ; quant à l'universitaire, « de structure, il a la psychanalyse en horreur ». Lacan ne fut guère moins méfiant envers ses élèves, dont il voulait rester le maître, censeur impitoyable et gardien jaloux d'orthodoxie parfois malaisée à deviner. Il s'est voulu inassimilable et rejeté, tirant de cette place excentrique et unique une maîtrise et un pouvoir de fascination peu communs. Sa pensée obéit à son style. Elle en a les facettes et les aspérités. « Elle marche, disait d'elle, en 1939, Édouard Pichon, dans une colonne de nuées sombres, mais gravides, dont, par déchirement, naît et jaillit çà et là une étincelle de lumière. Dépouillons-la ; mettons la belle nue, cette pensée à la robe d'orage ; elle en vaut la peine. Car l'essentiel de la doctrine de M. Lacan est vrai. » Elle est d'une extrême rigueur dans l'explication de ses thèses principales, dont les derniers développements ne sont que la stricte déduction. On peut la dire systématique, en ce sens, bien que refusant le système. Elle est rebutante à qui n'en a pas les clés, relativement simple à qui les détient, au risque, cependant, que la valeur d'usage n'en efface les aspérités. Elle est aussi d'une grande liberté face à elle-même, se pliant à son objet : l'inconscient. Un inconscient qui oblige à inventer et à se laisser surprendre, peu propice à se laisser saisir dans le sens obligé d'une formule ou dans la linéarité d'un discours, mais, bien plus, en ce qui touche à son réel, dans l'écho du double sens, dans les ruptures, les distorsions et les impasses. II-Le retour à Freud Lacan fut un lecteur extraordinaire et, avant tout, un lecteur de Freud. Son enseignement peut être mis sous le double signe d'une réforme et d'un retour. Réforme d'une psychanalyse qui a perdu le sens originaire de son expérience et retour à celui dont le nom même est devenu un symptôme, énigme pour qui le profère. Cette lecture de la situation de la psychanalyse dans les années cinquante et du « symptôme Freud » est une interprétation de l'histoire en termes de cure qui fait appel aux concepts majeurs : refoulement, rejet, filiation, meurtre du père et idéalisation. Elle constitue le sol du renversement lacanien, qui identifie le discours de Freud à l'objet qu'il a lui-même produit – l'inconscient – et en interprète les aléas comme ceux du discours inconscient. En accord avec cette position, Lacan identifiera son propre discours à la vérité de ce dont il fut le porte-parole et il interprétera toute entrave à son enseignement comme un rejet de l'inconscient. Ce destin qu'il se choisit, propre à ceux dont le nom s'identifie pour un temps à l'objet de leur discours, le suivra jusqu'à la fin et ordonnera les voies d'une imaginaire transmission et d'une fantasmatique succession de son œuvre. Une histoire analytique, dont la question est de savoir si Lacan devra, comme Freud, être redécouvert, c'est-à-dire voir son nom libéré du symptôme qui l'enferme. En 1953, le retour à Freud est un retour au sens de Freud. Renversement de la tendance dominante uploads/Litterature/ lacan-jacques-1901-1981-patrick-guyomard.pdf
Documents similaires




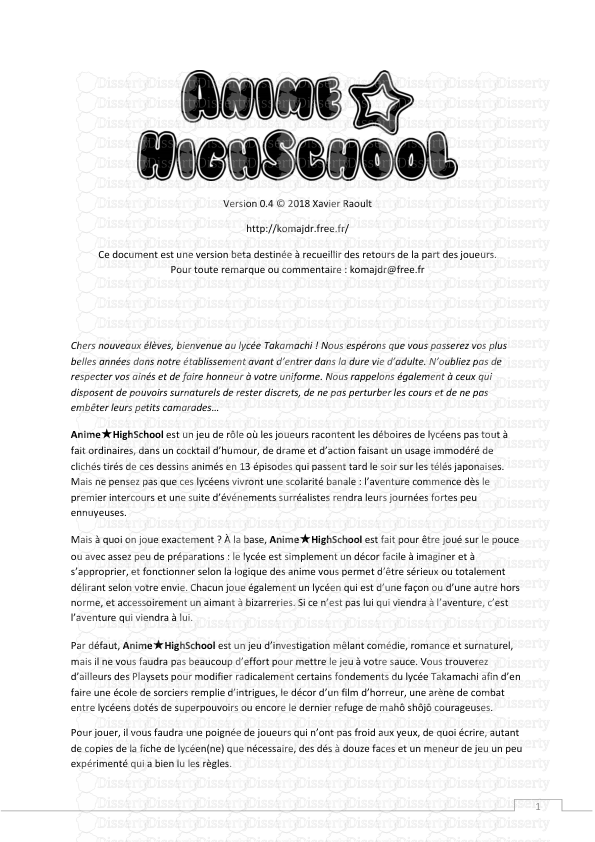





-
58
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 30, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.0805MB


