Le style d’écriture de l’auteur Source :https://lacroiseefr.wordpress.com/2010/
Le style d’écriture de l’auteur Source :https://lacroiseefr.wordpress.com/2010/04/07/le-style-decriture-de-lauteur/ Avez-vous souvent lu des histoires, des romans, des poèmes? Lire nous transporte dans des lieux et des temps fort variés. Les auteurs, avec plus ou moins d’adresse, nous font entrer dans l’univers de leurs personnages. Toutefois, chaque auteur possède sa propre manière de colorer ses textes, de les rendre uniques. Si ce n’était pas ainsi, ce serait endormant et très dommage. C’est cette diversité qui permet d’accrocher chaque personne selon ses goûts et ses intérêts. C’est aussi pour cela que nous aimons un auteur en particulier, tout en détestant un autre tout aussi intensément. Bien que le style de l’auteur se démarque particulièrement dans les domaines narratifs et poétiques, d’autres dominantes peuvent utiliser les concepts qui déterminent le style que ce soit pour frapper l’imagination du lecteur, pour illustrer une idée ou tout simplement pour piquer la curiosité. On peut déterminer le style d’un auteur à partir de trois éléments stylistiques de base : les registres de langue , les procédés littéraires , les figures de style . Ce sont également des notions que nous pouvons nous-mêmes utiliser pour enrichir nos propres œuvres, ce que nous faisons souvent par intuition, c’est-à-dire sans le savoir consciemment, et ce, parfois à nos dépens malheureusement. Prenez le temps d’explorer chacune des catégories. Il est certain que quelques concepts vous paraîtront étranges, ardus à saisir. Ne vous découragez pas trop vite. Prenez le temps d’observer les exemples, d’expérimenter l’utilisation de quelques éléments qui vous semblent les plus compréhensibles et de noter le style des auteurs que vous lisez. Tranquillement, vous saurez distinguer de mieux en mieux les nuances entre chacun. En outre, rien ne vous empêche de poursuivre votre découverte dans des livres, sur d’autres sites web pertinents, etc. Bonne recherche! Les niveaux (registres) de langue Pour déterminer à quel registre appartient un extrait ou un texte complet, il est important d’observer quelques caractéristiques essentielles : -le vocabulaire utilisé, - la structure de phrase (syntaxe), -le respect des règles du bon usage, la présence ou l’absence d’anglicismes ou de mots inappropriés, la facilité à comprendre pour des étrangers, etc. On distingue quatre niveaux de langue différents. Le langage populaire s’écarte de la norme de plusieurs manières. Il ne respecte pas les règles du bon usage et sa syntaxe est incorrecte. Il y a parfois présence d’anglicismes, de mots inappropriés et parfois même grossiers. C’est généralement difficile à comprendre pour les étrangers. Il comprend souvent : des termes impropres (peignure) des termes généralement péjoratifs, dépréciatifs (gnochon) des termes vulgaires des verbes mal conjugués un mauvais emploi du genre et du nombre (la grosse orteil) des contractions de prépositions et d’articles (Lise vient d’es voir.) des sons remplacés par d’autres sons (ménuit) des anglicismes (overtime) Le langage familier est plus conforme que le langage populaire, mais il reste simple, dans le langage de tous les jours. Il respecte de façon générale les règles du bon parler et la syntaxe. L’emploi de la langue familière rend généralement l’oeuvre plus près de la réalité, de la langue parlée tous les jours qui emploie des termes simples et familiers. Ce registre peut renfermer : parfois des anglicismes des régionalismes (brunante) des mots tronqués (télé, bus, stylo) des redondances (mon père, lui, il connaît ça) la suppression du «ne» dans «ne pas», «ne plus» (ce que j’appelle souvent la «double négation») Le langage correct, pour sa part, est beaucoup plus formel, standardisé. C’est ce qu’on appelle souvent le «français international». Il respecte bien les règles de la langue française et sa syntaxe. Son vocabulaire est beaucoup plus précis, quoique toujours assez simple à comprendre, bref un vocabulaire simple, clair et précis. Enfin, le langage soutenu, qu’on qualifie parfois de littéraire ou recherché, est le niveau le plus élevé et le plus complexe du langage. Il emploie des mots et des expressions recherchées, des figures de style bien choisies ainsi que des tournures de phrases variées et raffinées. Sa syntaxe se fait généralement plus complexe. Ce registre se remarque davantage à l’écrit, dans les œuvres littéraires et dans les textes à caractère officiel. À l’oral, on l’utilise dans les conférences importantes ou dans certaines stations de radio et de télévision. Les procédés littéraires (narratifs) Les procédés narratifs sont des manières diverses de raconter une histoire ou pour présenter certains éléments particuliers. En voici les exemples les plus courants. Les dialogues et les monologues mettent en scène les personnages en les faisant parler. Le dialogue rapporte un échange entre deux ou plusieurs personnages (sous forme de conversation). Le monologue, de son côté, rapporte les paroles d’un seul, c’est une transcription à la première personne d’une suite d’état de conscience que le personnage est censé éprouver (souvent le personnage principal). Il importe ici de bien ponctuer et compléter le tout lorsqu’on les utilise dans un texte : deux-points, guillemets, tiret, saut de ligne, proposition incise, etc. En outre, le temps et la personne des verbes peuvent différer de la narration puisque les dialogues et monologues sont des paroles rapportées fidèlement, directement, telles qu’elles ont été prononcées. La description et le portrait permettent aux lecteurs d’imaginer, de se représenter les éléments du récit en les amenant à voir, à ressentir, à vivre ce que vivent les personnages. Ils permettent ainsi aux lecteurs de participer plus étroitement à l’intrigue et même la vivre mentalement. La descritption est comme une photographie ou une vidéo qui permet d’observer plus en détail un lieu, une action ou une atmosphère précise. Elle augmente le degré de vraisemblance d’une histoire et lui donne plus crédibilité. Lorsqu’on présente un personnage de cette façon, on parle souvent de faire le portrait physique ou psychologique de ce dernier. Ces procédés sont utiles pour expliquer, préciser, mais ils ralentissent le rythme du récit. Les conteurs utilisent donc des descriptions brèves et accélèrent le rythme du récit en insistant sur les actions. La narration est un exposé d’une suite de faits, donc c’est une manière de raconter une histoire, un récit. Il faut qu’il y ait des personnages qui effectuent une suite d’actions ou subissent des événements dans un ordre donné. Le narrateur peut être un acteur, un témoin ou absent du récit. Le type de narrateur est ainsi déterminé puisqu’il est un être imaginé par l’auteur et qu’il sert d’intermédiaire pour raconter l’histoire. S’il est l’un des personnages (principaux ou secondaires) de l’histoire et qu’il participe à l’action, on dit qu’il est un narrateur à l’intérieur du récit (FOCALISATION INTERNE): le texte sera écrit à la première personne (je). S’il est le personnage principal, le héros, on parle alors de narrateur sujet ou acteur. S’il est un personnage secondaire, il assiste à l’événement qu’il raconte, mais ce n’est pas à lui que les aventures arrivent. On parle alors de narrateur témoin. Si, au contraire, on dit que c’est un narrateur extérieur à l’histoire(FOCALISATION EXTERNE), c’est qu’il est absent du récit et qu’il raconte le tout à la 3e personne (il/ils) : il n’est pas un personnage, donc il ne participe pas à l’action. Bref, le narrateur extérieur est soit un observateur neutre ignorant la vie intime des personnages, soit il est un narrateur omniscient, connaissant tous les personnages (FOCALISATION ZÉRO). La digression, pour sa part, vient casser le rythme du récit. Elle intervient souvent dans la chronologie de la narration. La plus courante est le retour en arrière qui permet d’avoir un bref aperçu du passé des personnages. Ce procédé permet d’inverser l’ordre chronologique des événements en racontant d’abord un événement récent puis en revenant aux événements passés. On peut aussi insérer dans le récit l’histoire d’un rêve, une histoire fictive qu’un personnage raconte, l’anticipation d’actions futures, etc. L’apostrophe est un procédé très bref qui permet d’interpeller la personne à qui l’on parle en la nommant. Elle est souvent utilisée dans les discours rapportés directement (dialogue ou monologue), ce qui fait qu’on s’adresse directement aux personnes ainsi interpellées. Par exemple, je peux dire : «Martin, viens me voir.» Remarquez que l’apostrophe (extrait souligné) est séparée par la virgule et qu’elle n’intervient pas dans l’accord du verbe. Prenons un autre exemple: «Tu le sais, mon ange, pourquoi je te refuse tout.» On voit ici qu’on peut interpeller par le nom propre ou par un groupe nominal qui désigne la personne à qui l’on s’adresse. L’inversion est aussi un procédé très bref qui consiste à inverser l’ordre des constituants de base de la phrase. L’ordre habituel est : [sujet + verbe + complément]. La construction de la phrase est modifiée lors de l’inversion, ce qui pourrait influencer la ponctuation : [complément, sujet + verbe] ou [complément + verbe + sujet]. L’alternance est le procédé qui consiste à raconter deux ou plusieurs histoires simultanément, en interrompant tantôt l’une, tantôt l’autre, pour la reprendre à l’interruption suivante. On peut ainsi alterner entre l’histoire d’un personnage et celle d’un autre personnage. Parfois on peut aussi alterner entre les événements situés dans un lieu puis dans un uploads/Litterature/ le-style-dun-auteur.pdf
Documents similaires








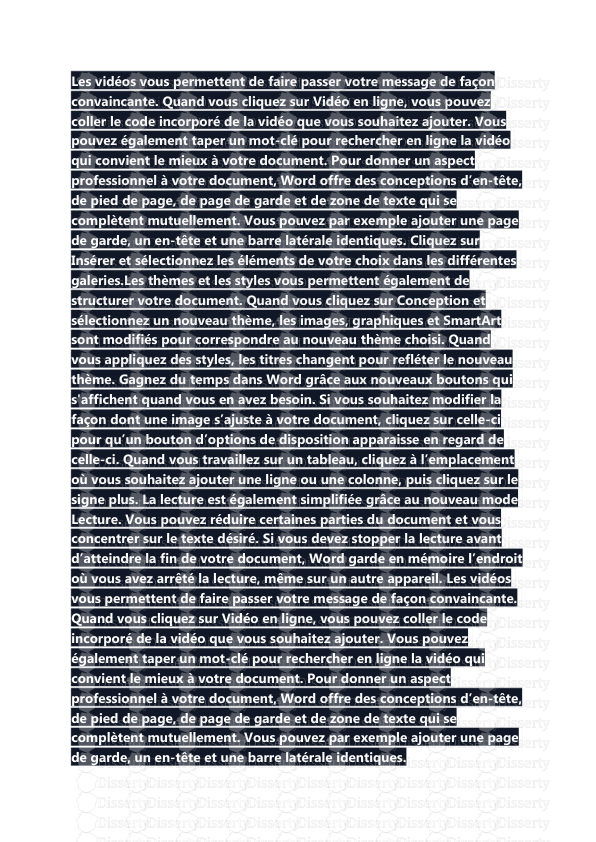

-
83
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 20, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.3749MB


