Thèse de doctorat en histoire de l’art Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne E
Thèse de doctorat en histoire de l’art Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne ED 441 Sous la direction de Monsieur Michel Poivert Jouer contre les appareils : Une tentative de définition de la photographie expérimentale contemporaine. présentée et soutenue le 10 juin 2016 à Paris par Marc Lenot devant le jury composé des membres suivants : – Monsieur Philippe Dubois, professeur, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 – Monsieur Michel Frizot, directeur de recherche émérite, Centre National de la Recherche Scientifique – Monsieur Michel Poivert, professeur, Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne – Madame Roberta Valtorta, directrice scientifique, Museo di Fotografia Contemporanea, Cinisello Balsamo (Milan, Italie) – Madame Hilde Van Gelder, professeur, Katholieke Universiteit Leuven (Belgique) 1 Vol. I 2 3 4 Jouer contre les appareils Une tentative de définition de la photographie expérimentale contemporaine Marc Lenot 5 6 1 Qui est assez sage pour discerner ces choses et assez intelligent pour les comprendre ? (Osée 14:101) À ma fille Sophie, à sa lumière et à ses ombres 1 Épitaphe – en hébreu et en tchèque – sur la tombe de Vilém Flusser au cimetière juif de Prague. Voir Image page 46. Avant-propos Si, au cours de quelques années de recherche sur la photographie expérimentale contemporaine, on a acquis l’habitude, devant un nouveau livre d’histoire ou de théorie de la photographie trouvé dans une librairie ou une bibliothèque, d’aller aussitôt à l’index et d’y chercher le mot « expérimental », on est le plus souvent bredouille, ou déçu. La négligence avec laquelle l’histoire de la photographie semble traiter la photographie expérimentale contemporaine, son approche critique au mieux comme un simple catalogue de pratiques, sa présence plus que discrète dans les musées et les expositions, incitent à s’interroger, non point sur son existence réelle, qui, empiriquement, semble avérée, mais sur sa légitimité conceptuelle, et, partant, sur sa définition ontologique. La présente thèse a pour objet de tenter de formuler une telle définition théorique de la photographie expérimentale et de montrer comment de nombreux photographes contemporains, sans pour autant faire partie d’un mouvement structuré, peuvent se rattacher à ce que nous définirons ici comme le courant de la photographie expérimentale. Cette recherche n’a pas été menée à partir d’une idée préconçue, d’une philosophie déjà bien définie dans laquelle il aurait fallu ensuite faire entrer le travail des artistes de gré ou de force. Elle s’est, au contraire construite d’abord de façon très lâche, en compilant des travaux photographiques que, de manière alors assez vague, nous pensions alors pouvoir considérer comme expérimentaux, sous diverses acceptions courantes de ce terme, sans qu’ils soient alors reliés par un thème, une approche, ni a fortiori une appartenance. Rien ne serait advenu de cette compilation si, en parallèle, nous n’avions exploré des voies théoriques, tentant de trouver des fondations possibles à notre démarche, que ce soit dans le champ de l’histoire de la photographie elle- même, ou de manière plus large en histoire de l’art et en esthétique, et, plus largement, en philosophie. C’est ainsi, à mi-chemin entre réflexion théorique et compilation d’un corpus potentiel, que s’est peu à peu fait jour la possibilité d’une certaine cohérence, dont cette thèse se veut l’exposition. Une règle nous 1 a constamment guidé dans cette navigation entre corpus et théorie, même si nous ne prétendons pas l’avoir toujours suivie à la perfection, c’est celle qu’énonça Marguerite Yourcenar dans ses carnets de notes en postface des Mémoires d’Hadrien : « Les règles du jeu : tout apprendre, tout lire, s’informer de tout, et, simultanément, adapter à son but les Exercices d’Ignace de Loyola ou la méthode de l’ascète hindou qui s’épuise, des années durant, à visualiser un peu plus exactement l’image qu’il crée sous ses paupières fermées 2. » S’il fallait citer le moment clef où cette cohérence a enfin paru possible, où l’accumulation de travaux divers a enfin semblé pouvoir faire sens, où, en quelque sorte, l’image sous les paupières fermées dont parle Yourcenar a enfin commencé à pouvoir être visualisée, nous dirions que ce fut à la lecture des pages finales de l’essai de Vilém Flusser3, sur lequel nous reviendrons plus loin, que, peu à peu, nous avons pu espérer pouvoir bâtir cet édifice. Ceci explique en partie la place centrale que ses idées occupent dans cette recherche. Le champ de cette recherche est limité selon trois déterminants, historique, technique et géographique : d’abord, cette recherche ne porte que sur la période contemporaine, depuis le début des années 1970 jusqu’à aujourd’hui, et ne s’intéresse à l’expérimental au temps des avant-gardes et dans la période de l’après-guerre qu’à titre de référence historique. Ensuite, elle ne couvre que la photographie analogique (argentique ou autre) et, à de rares exceptions près, elle a exclu de son champ la photographie numérique, postulant que le rapport à l’expérimental a été fondamentalement transformé par l’arrivée de la technologie numérique et informatique et qu’un changement aussi radical de paradigme demanderait une autre approche, mériterait une recherche importante, et justifierait à elle seule une nouvelle thèse. Enfin, nous n’avons inclus dans le corpus d’étude, à quelques exceptions près4, que des 2 Yourcenar Marguerite, Mémoires d’Hadrien, Paris, Gallimard, 1974 [1958], p.332. 3Flusser Vilém, Pour une philosophie de la photographie, Belval, Circé, 1996 [1983], p.79-85. 4Les exceptions concernent quelques artistes d’Israël, d’Iran, du Mexique ou de Turquie. Nous avons aussi inclus des artistes originaires d’autres pays comme le Japon, l’Inde, le Viet-Nam, la Jamaïque, l’Équateur, la Colombie, le Brésil ou le Maroc, mais travaillant en Occident. photographes actifs en Europe et en Amérique du Nord, n’ayant identifié, en dehors du Japon, que très peu de photographes d’autres pays présents dans ce domaine, et ayant jugé l’effort (culturel, linguistique et pratique) nécessaire pour inclure les photographes expérimentaux japonais dans ce corpus supérieur à nos capacités. Étudiant quelque peu atypique, nous avons peut-être montré parfois un peu plus d’enthousiasme que de coutume dans des travaux universitaires. Tout en nous efforçant de conserver une approche et un style aussi factuels que possible, nous avons parfois été pris par un zèle qui, nous l’espérons, ne sera pas jugé excessif, car traduisant simplement notre passion de néophyte pour ce sujet et pour les découvertes qu’il nous a offertes. Qu’il nous soit donc permis de placer ce qui pourrait ici passer pour excessif ou exagéré sous l’égide bienveillante d’Aaron Scharf qui, dans son livre essentiel, hélas non traduit en français, Creative Photography, écrivait déjà il y a cinquante ans : « Il y a si peu de textes qui traitent de la photographie non orthodoxe de manière sérieuse, et un intérêt au mieux si limité pour cette approche non orthodoxe dans les livres et les articles de magazine sur la photographie créative, que nous avons considéré qu’il était nécessaire de faire preuve ici de quelque exagération 5. » 5 “But because of the paucity of literature which treats photographic unorthodoxy in a serious way, and because books and magazine articles on creative photography at best show only limited interest in it, exaggeration was considered necessary.”, Scharf Aaron, Creative Photography, Londres, Studio Vista, 1965, p.96. (Sauf mention contraire, nous avons traduit nous-même les textes dont la citation originale en langue étrangère est reproduite en note) Remerciements Rédiger des remerciements, une fois tout le reste fait, est l’occasion de se pencher sur ces années de thèse et de se remémorer les appuis, les soutiens, les encouragements, les marques de sympathie, en somme tout ce qui fait l’agrément d’un long parcours parfois difficile ou rugueux. Je veux donc d’abord remercier ceux qui ont cru en moi, parfois plus que moi- même, et qui, chacun à sa manière, parfois discrète et parfois énergique, m’ont aidé à parvenir au bout de ce projet. Au premier rang, bien évidemment, mon directeur de thèse, Michel Poivert, qui, face à cet étudiant atypique, a su trouver les mots justes, les encouragements idoines et les critiques ciblées, qui m’a d’abord accepté et orienté, puis m’a incité et aiguillonné avec tact et intelligence, au fil de mes hésitations, de mes procrastinations et de mes délais. Si j’en suis là aujourd’hui, c’est aussi parce qu’en 2007, quand le projet un peu fou de reprendre mes études a commencé à me trotter dans la tête, André Gunthert m’a accepté dans son programme de Master et a su me permettre de m’adapter et de m’intégrer. Sans l’assurance que j’ai acquise lors de ces deux années sous sa houlette, je n’aurais pas ensuite eu l’audace de me lancer dans une thèse. Même si je suis aujourd’hui plus lointain, la confiance qu’il m’a alors témoignée m’accompagne encore. Dans ce même registre, des proches, des intimes, qui connaissent si bien mes faiblesses et ont su si bien me prodiguer le moment venu les petits signes dont j’avais besoin, méritent toute ma gratitude. Je ne serais pas arrivé là sans l’affection de ma fille Sophie qui, avec son frère Alexandre, a souvent, l’air de rien, su trouver les mots justes, sans l’amitié de Judith Souriau dont les encouragements tout au long de ce parcours m’ont été précieux, ni sans le réconfort de la uploads/Litterature/ lenot-tese-fr.pdf
Documents similaires


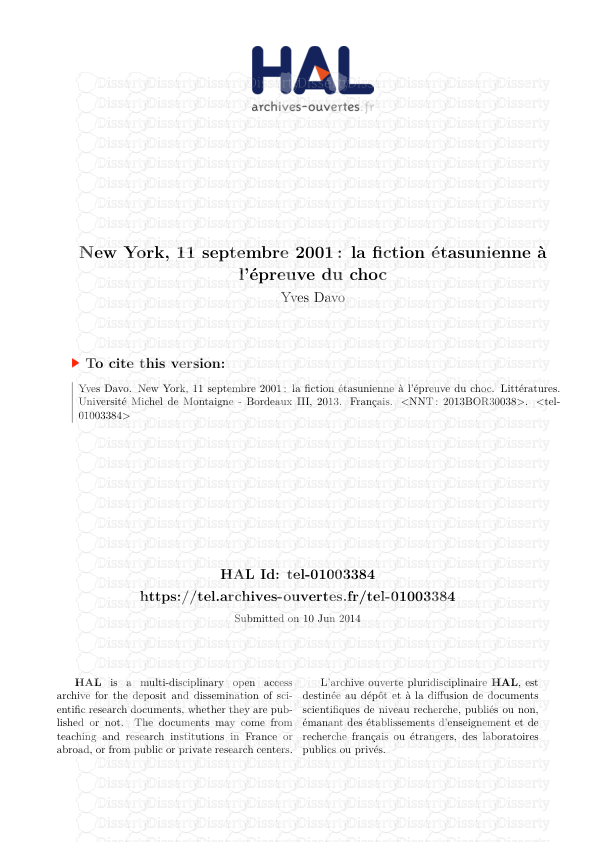







-
53
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 09, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 42.7027MB


