Bibliothèque de Genève Catalogue des manuscrits Manuscrits arabes CH BGE Ms. o.
Bibliothèque de Genève Catalogue des manuscrits Manuscrits arabes CH BGE Ms. o. 1-112 Promenade des Bastions, 1211 Genève 4, Suisse © BGE, Genève, 2016 C A T A L O G U E D E S M A N U S C R I T S BIBLIOTHEQUE M a n u s DE LA PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE DE G E N E V E T O M E XVII c r i t s a r a b e s établi par Anouar LOUCA Introduction les manuscrits arabes qui figurent au Catalogue raisonné des manuscrits conservés dans la Bibliothèque de la Ville et République de Genève, publié par Jean Senebier en 1779, sont au nombre de quatre (n° 15-18), ou de cinq si l'on y ajoute le n° 13 qu'il prend pour syriaque. Depuis, ce nombre a près de deux fois décu plé; les présentes notices décrivent une centaine de textes arabes répartis en 82 volumes, sous 78 cotes. l'accroissement de ce fonds est d'autant plus remarquable qu'il reflète la diversité des manuscrits arabes dans le monde. En effet, par leurs types d'é criture, leurs lieux d'origine, leurs dates et leur contenu, les manuscrits arabes réunis à Genève forment un ensemble organique assez complet. Sur parchemin, papier oriental et plus tard eu ropéen, les spécimens caractéristiques de l'art des copistes arabes sont représentés. On peut les suivre à travers les âges, de l'écriture archaïque dite cou- fique, jusqu'à la cursive moderne, en passant par les calligraphies maghrébine, persane, diwani et surtout le nashi. v Ces manuscrits appartiennent à toute l'étendue géographique du domaine arabe, soit à trois continents. Si la plupart proviennent d'Egypte et d'Afrique du Nord, certains furent exécutés, non seulement en Pa lestine, Syrie et Turquie, mais aussi en Inde, en I- ran et en Afrique noire (Sénégal, Tchad), les manus crits parisiens et genevois, qui prolongent la collec tion, sont l'oeuvre d'émigrés arabes en Europe et d'o rientalistes français et suisses. Comme dans l'espace, ces manuscrits s'étalent dans le temps sur une vaste période de l'histoire. les plus anciens, en parchemin, remontent aux 9e et 10e siècles; Les plus récents, copiés au 19e siècle, suppléent alors aux lenteurs de l'imprimerie que vient d'adopter le monde arabe. Témoins authentiques de dix siècles de civilisation, ils en relatent plusieurs épisodes, plus ou moins connus. On y retrouve donc les principales branches de l'humanisme arabe. En premier lieu, l'islamologie. Plusieurs ouvrages d'exégèse, de droit, de mystique, ainsi que des recueils de prières et de sermons accom pagnent quelques anciens exemplaires du Coran. Au ser vice de la langue du Coran, se groupent des traités de grammaire, de lexicographie et de rhétorique, l'his toire du monde et des pays arabes en particulier, tient dans ce fonds une aussi grande place que la poésie et les belles lettres en prose. Mais la production narrative l'emporte avec toute la gamme des fables, proverbes, maqâmât, récits édifiants et romans popu laires, surtout les Mille et une nuits. Les sciences naturelles et occultes ne sont pas absentes : la zoo logie et l'alchimie y sont inséparables de la divina tion. De cette masse encyclopédique se détache une littérature chrétienne, trop souvent négligée chez les arabophones : traduction de l'Evangile, liturgie, prières, hagiographie et même poésie. Si, en vue d'un recensement plus détaillé, nous renvoyons aux tables des auteurs et des genres litté raires, placées à la fin du catalogue, il faut s'ar rêter ici pour chercher comment, quand et par qui cet ensemble de manuscrits arabes a été constitué à Genè ve. les premières acquisitions sont bien antérieures à l'époque de Senebier. Déjà le .fonds primitif de la Bibliothèque comprend l'Alcoranus, laconiquement men tionné dans une liste manuscrite, datée de 1572, qu'on considère comme le catalogue le plus ancien de la 3 maison, (l) Mais des documents plus précis, dans les archives de la Bibliothèque, citent, en tant que do nateurs de manuscrits arabes au 17e siècle, "Monsieur Girard", principal du Collège (1589-1655) (2) et le professeur Vincent Minutoli (1639-1709) (3). Grâce sans doute aux relations étroites de ce dernier avec la Hollande, (4) la Bibliothèque de l ’ Académie, dont il fut chargé, s'enrichit notamment de deux manuscrits maghrébins du 15e siècle (actuellement cotés : ms. o. 18a et 88). Pris en 1550 dans la mosquée d'al-Mah- diyya (Tunisie), lors de l'expédition de Charles Quint commandée par son amiral André Doria, les deux manus crits portent des notes autographes de Roberti, le médecin de celui-ci et du célèbre orientaliste hollan dais Erpenius (1584-1524). C'est là, avec quelques fragments du Coran et un texte chrétien d'inspiration monachique, les Propos de Secundus le sage, la premiè re couche de la collection des manuscrits arabes. (1) Archives de la Bibliothèque : B 1, f. 23. - Voir, sur cette liste, l'étude de Préd. Gardy, "Le Ponds primitif et le premier catalogue de la Biblio thèque de Genève", Genava, VI, 1928, p. 101-117. (2) Archives de la Bibliothèque : B 3, f. 188v°. - Sur Etienne Girard, voir Henri Heyer, l'Eglise de Genève, 1555-1909, Genève, A. Jullien, 1909, p. 470. (3) Archives de la Bibliothèque : B 3, f. 194. (4) Vincent Minutoli avait été pasteur à Middel- bourg et entretenait avec Bayle et Jean Le Clerc, le publiciste genevois d ' .Amsterdam, une correspondance active. Voir Charles Borgeaud, Histoire de l'Univer sité de Genève, L'Académie de Calvin, Genève, Georg, 1900, p. 403-404. 4 La deuxième couche, plus ample, a été entièrement rassemblée par un seul homme, Jean Humbert (1792-1851). Ge jeune pasteur, après avoir terminé sa théologie à Genève, et acquis à Gottingen une formation de phi lologue, s'était laissé attirer par la littérature arabe. A Paris, il suivit 1'enseignement de Silvestre de Sacy, fréquenta les orientalistes Marcel, Reinaud, Burnouf, Jaubert et se lia avec un émigré syrien, po ète et linguiste, Michel Sabbagh (1784-1816), qui ser vait comme copiste à l'Imprimerie nationale. Chez Mar cel, l'ancien traducteur en chef de Bonaparte pendant l'expédition d'Egypte, Humbert eut l'occasion d'admi rer un trésor de manuscrits; il en acheta une partie et se fit copier d'autres par son maître et ami Sab bagh. Sa collection personnelle dépasse alors une tren taine de textes, qui reflètent ses goûts pour la poé sie, les romans populaires et l'histoire, outre ses intérêts de théologien et de philologue. Lorsqu'en 1820, l'Académie de Genève le nomme professeur honoraire de langue arabe, Jean Humbert se met à compléter sa collection afin qu'elle répon de à ses nouveaux devoirs pédagogiques. Il la donne à la Bibliothèque publique, qui lui fournit, à son tour, pour l'élargir, un crédit de 600 livres. (5 ) En puisant encore à ses sources parisiennes, toujours alimentées par les émigrés d'Egypte, Humbert étend considérablement l'éventail de ses acquisitions. (6) (5) Archives de la Bibliothèque : Registre de la Direction, H 2, p. 172. (6) Dans -son rapport à la Bibliothèque (ms. o. 110, f. 2), J. Humbert écrit : "Les 11/12 de ces manuscrits ont été achetés à Paris, à Mr. Marcel, ancien Direc teur de l'Imprimerie royale, membre de l'Institut du Caire et l'un des Collaborateurs au grand ouvrage de la Description de l'Egypte. Il les a tous apportés d'Egypte, au retour de l'expédition." 5 Aussi s'interdit-il le luxe de convoiter des pièces onéreuses : "J'aurais pu acheter des manuscrits infi niment plus beaux, déclare-t-il, mais je n'aurais eu alors, pour la somme de 600 fr. que 4 ou 5• J'ai pré féré les avoir moins élégans et moins rares, mais plus nombreux et à la portée des jeunes gens (qui voudraient s'occuper de langues orientales vivantes." (7) II.pen se désormais associer ses étudiants à la publication de tant de textes, d'où il a tiré, l'année précédente, la matière d'une Anthologie arabe ou choix de poésies arabes inédites. "Sur 21 manuscrits arabes que j'ai achetés, poursuit-il, 17 sont inédits; plusieurs sont pleins d'intérêt et pourraient être publiés avec fruit." Nous signalerons, dans les notices consacrées à ce groupe de manuscrits, les textes publiés par les soins de l'arabisant genevois. Malgré une santé précaire, l'enseignement de Jean Humbert n'aura pas été vain, à en juger par un Diction- narium arabico-latinum, de la main de son élève Emile Demole, le futur pasteur (1805-1877). Reçu par la Bi bliothèque en I960 seulement, ce manuscrit appartient à cette importante série, établie en 1820. Dans la seconde moitié du 19e siècle, les acqui sitions s'espacent. Rappelons le don fait en 1862, par l'abbé d'Aulnoy, de "manuscrits arabes et persans provenant de la prise d'Alger en 1850." (8) Si, spo radiquement, quelque bibliophile, comme Marc Monnier, dote le fonds arabe d'un beau manuscrit, il faut at tendre, vers la fin du 19e siècle et au début du 20e, (7) Ibid. (8) Archives de la Bibliothèque, H 4. Registre des séances de la commission 1849-1867, séance du lundi 5 novembre 1862. les activités académiques de deux spécialistes, Edouard Montet (1856-1933) et surtout Max van Berchem (1863- 1921), pour voir s'enrichir sensiblement la collection genevoise. Le premier, dès 1885 professeur d'hébreu, d'archéologie biblique et d'exégèse de l ’ Ancien uploads/Litterature/ manuscrits-arabes-bibliotheque-de-geneve-catalogue-des-manuscrits.pdf
Documents similaires

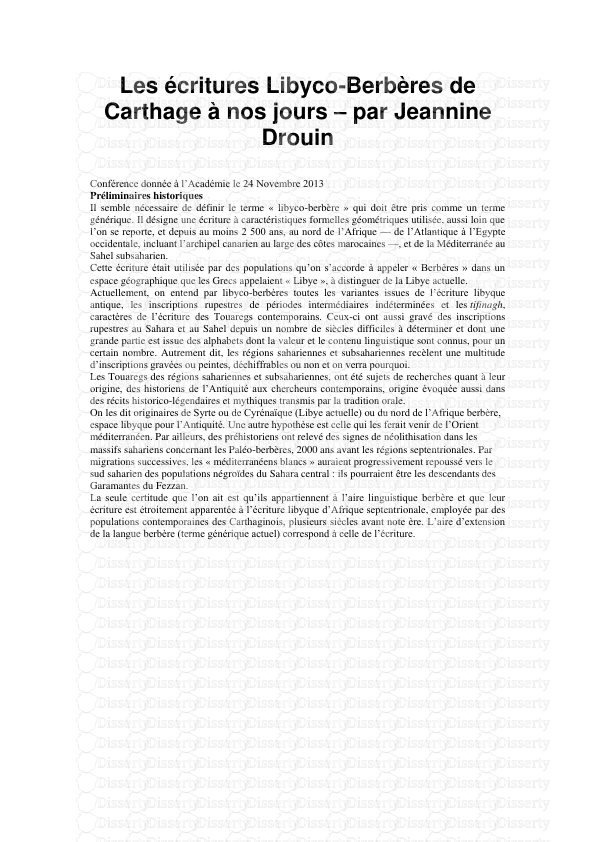








-
36
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 29, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 3.8551MB


