9 Thélème (Madr., Internet). 36(1) 2021: 9-15 Thélème. Revista Complutense de E
9 Thélème (Madr., Internet). 36(1) 2021: 9-15 Thélème. Revista Complutense de Estudios Franceses ISSNe: 1989-8193 https://dx.doi.org/10.5209/thel.70910 Maurice Blanchot et la question de l’être Sidi Abdellah Azeroual1 Recibido: 29/07/2020 / Aceptado: 24/05/2021 Résumé. Pour Maurice Blanchot, l’indifférence face à l’opacité du monde s’alimente de la conscience avertie de l’homme. Celle-ci l’expose à l’inutilité de concevoir l’être comme une instance profondément active dans le monde. Ce qui inquiète Maurice Blanchot, ce n’est pas la raison elle-même, mais « […] l’accumulation accélérée de dispositifs rationnels, un vertige logique de rationalisations […] » (Blanchot, Le Livre à venir, 1986 : 32). Afin de vérifier cette hypothèse, il est nécessaire de se pencher sur le rapport qui lie la distanciation et la neutralité à des notions purement blanchotiennes, entre autres le ressassement comme volonté et comme représentation. Mots clés : Maurice Blanchot, pensée, conscience, volonté, paradoxe, ressassement. [es] Maurice Blanchot y la cuestión del ser Resumen. Para Maurice Blanchot, la indiferencia ante la opacidad del mundo se alimenta de la conciencia informada del hombre. Esto lo expone a la inutilidad de concebir al ser humano como una instancia profundamente activa en el mundo. Lo que preocupa a Maurice Blanchot no es la razón en sí misma, sino “[...] la acumulación acelerada de dispositivos racionales, un vértigo lógico de racionalizaciones [...]” (Blanchot, Le Livre à venir, 1986: 32). Para verificar esta hipótesis, es necesario examinar la relación que vincula el distanciamiento y la neutralidad con algunas nociones de Blanchot, entre otras, la reiteración como voluntad y representación. Palabras clave: Maurice Blanchot, pensamiento, conciencia, voluntad, paradoja, reiteración. [en] Maurice Blanchot and the question of being Abstract. For Maurice Blanchot, indifference to the opacity of the world feeds on the informed conscience of humans. This exposes us to the uselessness of conceiving the human being as a deeply active instance in the world. What concerns Maurice Blanchot is not reason itself, but “[...] the accelerated accumulation of rational devices, a logical vertigo of rationalizations [...]” (Blanchot, Le Livre à venir, 1986: 32). In order to verify this hypothesis, it is necessary to examine the relationship which links distancing and neutrality to some of Blanchot’s notions, amongst others, reiteration as will and as representation. Keywords: Maurice Blanchot, thought, consciousness, will, paradox, reiteration. Sommaire : I. L’écriture du mal absolu. II. Les limites de l’inconscience de l’homme. III. Blanchot et le silence de Kafka. IV. Éloge de la répétition. V. L’indifférence et l’autonomie de l’être. Cómo citar: Azeroual, A. (2021). « Maurice Blanchot et la question de l’être ». Thélème. Revista Complutense de Estudios Franceses. Vol. 36, Núm. 1 : 9-15. 1 École Nationale Supérieure des Arts et Métiers de Meknès, Université My Ismail, sidiabdellahazeroual@gmail.com ARTÍCULOS 10 Azeroual, A. Thélème (Madr., Internet). 36(1) 2021: 9-15 « La vérité coûte cher. Nous n’avons pas besoin de nous souvenir de Nietzsche pour en être assuré » (Blanchot, Le Livre à venir, 1986 : 31). « […] ô étrange et terrible tranquillité » (Blanchot, Au moment voulu, 1951 : 23). « L’idée la plus importante de Kant, camarades, c’est la “chose en soi”, ce qui se dit en allemand “Ding an sich”. Kant pensait que derrière nos représentations se trouve une chose objective, un “Ding”, que nous ne pouvons pas connaître mais qui, pourtant, est réelle. Mais cette idée est fausse. Il n’y a rien de réel derrière nos représentations, aucune “chose en soi”, aucun “Ding an sich” » (Kundera, 2014 : 112). L’écriture et la pensée de Maurice Blanchot n’ont pas cessé d’interroger les limites de l’être qui voudrait exister sans engagement, loin de tout désir de reconstituer la complexité de la réalité environnante. Pour reprendre les termes de Bernard Noël, on peut dire que c’est « entre le fini et l’infini [que] bat le sens, celui qui ne court ni après la vérité, ni le centre, ni la raison : celui qui préfère le doute et l’oubli au salut » (Noël, 2012 : 60). Maurice Blanchot opte pour une distanciation nécessaire à la compréhension objective du monde. Pour saisir le rapport qui lie l’écriture à la problématique de l’être dans l’imaginaire blanchotien, nous insisterons, dans cet article, sur quatre idées majeures : la question du mal absolu, l’inconscience qui est une protection de l’homme contre ses propres angoisses, le rôle du ressassement dans la remise en question de l’absurdité du monde et, finalement, la neutralité comme l’unique voie qui pourrait mener l’homme à son indépendance. Nous tenterons de répondre à ces questions en rapprochant la pensée de Maurice Blanchot au nihilisme inclus dans la philosophie d’Arthur Schopenhauer et à l’usage que fait André Gide du mythe de Prométhée. Nous n’oublierons pas, aussi, d’étudier l’apport de l’expérience de Franz Kafka dont la sensibilité vis-à-vis de la tyrannie du monde inspire Maurice Blanchot, ainsi que le mécanisme de la pensée du dehors considérée par Michel Foucault comme le lieu privilégié de l’indéterminé. D’une manière ou d’une autre, en confrontant Emmanuel Kant et Arthur Schopenhauer, Milan Kundera tente de poser une question qui a bien préoccupé certains philosophes occidentaux : qu’est-ce que la volonté ? Si elle existe, de quelle instance dépend-elle ? De la réalité tangible qui la dicte et la produit ou d’une force transcendantale qui décide de ses modalités et impose certaines conditions nécessaires à son accomplissement ? Milan Kundera, en empruntant la voix de son personnage Joseph Staline, donne raison à Arthur Schopenhauer : Schopenhauer a été plus proche de la vérité. […] La grande idée de Schopenhauer, camarades, c’est que le monde n’est que représentation et volonté. Cela veut dire que derrière le monde tel que nous le voyons il n’y a rien d’objectif, aucun «Ding an sich», et que pour faire exister cette représentation, pour la rendre réelle, il doit y avoir une volonté ; une volonté énorme qui l’imposera (Kundera, 2014 : 112-113). L’homme semble être pris au piège de ce dilemme : s’il opte pour la « chose en soi », tout désir de liberté serait vain ou, au moins, conditionné par la dépendance essentielle de l’être au monde ; s’il opte pour la primauté de la volonté sur le destin de l’être, il serait confronté à l’exploration douloureuse de sa vulnérabilité. Parce qu’il est par essence un être fragile, l’homme serait dans ce dernier cas surpassé par le désir d’être ce que Milan Kundera appelle une « volonté énorme ». De toute façon, de Schopenhauer jusqu’aujourd’hui, en traversant philosophie, art et littérature (Alberto Giacometti, Albert Camus, Salvador Dali, Henri Michaux, Georges Bataille, etc.), la volonté ne suffit pas pour vaincre ou s’adapter à la condition déplorable de l’homme. Maurice Blanchot, lui, plus perspicace peut-être, plus neutre aussi quand il évoque, souvent implicitement, la question de la volonté ou de l’involonté de l’homme, ne cache pas sa réticence vis-à-vis de cette illusion de se vouloir être heureux dans la fête absurde d’être. Pour lui, un déplacement de cette joie est plus que nécessaire : il faudrait se concevoir heureux dans l’impossibilité de l’être, la satisfaction étant un leurre. La recette que propose Maurice Blanchot invite à requestionner les éléments qui promettent une prise de conscience heureuse du monde : « […] les malheureux, tourmentés, souffraient de ce qu’ils croyaient un remède pour les guérir et ils étaient écrasés par la honte qui les jetait entre les bras d’un sauveur » (Blanchot, Après coup précédé par Le Ressassement éternel, 1983 : 75). I. L’écriture du mal absolu Parler en termes de recette ouvre la philosophie blanchotienne au débat soulevé par André Gide autour de la figure de Prométhée2. Le lecteur de Maurice Blanchot devrait se soumettre à la formule d’André Gide : « Je n’aime pas les hommes ; j’aime ce qui les dévore » (Gide, 1925 : 65). Dans Le Prométhée mal enchainé, Prométhée est rongé à la fois par l’aigle qui dévore son foie, par le désir de fuir la torture et par la promesse d’une écriture du mal que symbolisent les plumes de cet aigle. C’est dans ce sens qu’on peut prétendre que l’aigle représente la force énigmatique qui confronte l’homme. André Gide pense que « […] l’aigle, de toute façon, nous dévore, vice ou vertu, devoir ou passion ; cessez d’être 2 Prométhée dote l’homme du feu qu’il dérobe aux dieux. Il leur a volé le savoir technique et a, symboliquement, initié l’humanité à la civilisation via les diverses productions que favorise l’usage du feu. 11 Azeroual, A. Thélème (Madr., Internet). 36(1) 2021: 9-15 quelconque, et vous n’y échapperez pas » (Gide, 1925 : 77). Que faudrait-il décider : apprivoiser l’aigle ou le tuer ? Cela dépend de la valeur qu’on attribue à sa nature : il mériterait d’être le miroir de l’homme quand cet « […] aigle est notre raison d’être […] » (Gide, 1925 : 71). Or, quand Prométhée apprend que l’aigle peut aussi être une conscience3, il ne se contente pas de le tuer ; il le mange après. Il faudrait s’arrêter sur le verbe manger où est explicite l’acte de mâcher et où est implicite l’acte d’éjecter : sublimation uploads/Litterature/ maurice-blanchot-et-la-question-de-l-x27-etre-theleme-revista-complutense-de-estudios-franceses.pdf
Documents similaires








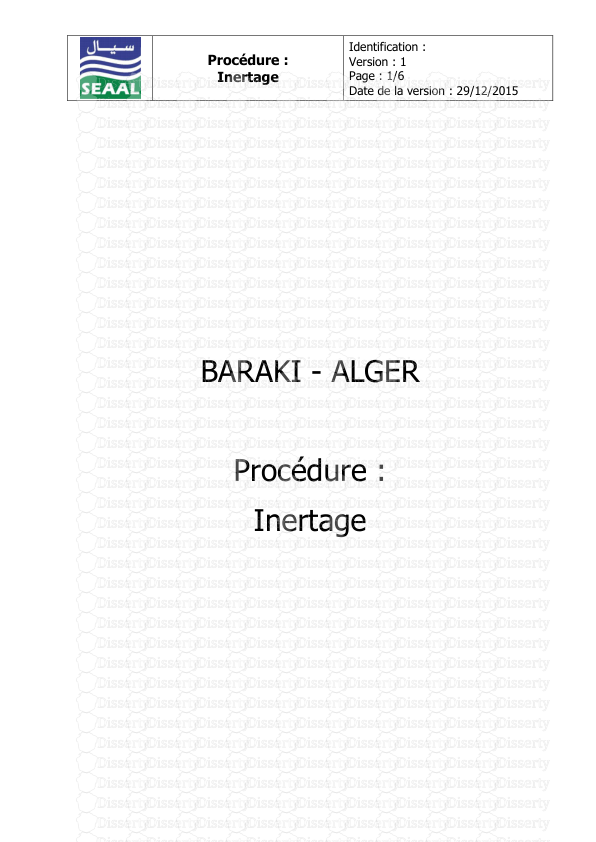

-
77
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 17, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2609MB


