Critique littéraire 1 Méthodes de la critique littéraire - La poétique d'Aristo
Critique littéraire 1 Méthodes de la critique littéraire - La poétique d'Aristote - La querelle des Anciens et des Modernes - La critique au XIXe siècle Le XIXe siècle a vu la promotion de l'histoire (c’est-à-dire l'histoire était dominante) parmi les sciences. La critique en quête de rigueur s'est donc tournée d'abord vers l'investigation (la recherche) historique. Après la Seconde Guerre mondiale, l'histoire littéraire – enrichie des apports de l'étude des mentalités, des arts… - poursuit sa brillante carrière. Mais l'essor et l'éclatement des sciences humaines (sociologique, psychanalyse, linguistique, mythologie) ne tardent pas à susciter l'apparition de nouvelles interprétations des œuvres. Des conflits surgissent qui entraînent une réflexion exigeante sur les présupposés et les limites de chaque méthode. Naissance de la critique moderne: Le XVIIIe siècle avait vu le triomphe de l'esprit critique, mais la manière plus chaleureuse de Diderot, dans ses Salons (exposition de peinture), ouvrait déjà la voie à une forme moderne (à partir du beau) de la prose: la critique littéraire conçue non plus seulement comme un instrument de combat, mais comme une méditation sensible où, pour reprendre la formule de Proust " se devine sous la lecture d'autrui la lecture de soi-même". Baudelaire est le type même du critique moderne et du poète qui porte un critique en lui-même. Il nous intéresse par ses analyses pénétrantes (très profondes) de la modernité " le transitoire (une période de transition), le fugitif (celui qui fuit), le contingent (celui qui est à côté), la moitié de l'art, dont l'autre moitié est l'éternel Critique littéraire 2 et l'immuable" (il définit l'art en deux données contradictoires). Aux normes de Boileau, il substitue l'attention accordée à la touche géniale, au détail insolite qui doit permettre le brusque passage au spirituel. L'âge positif L'esprit positif allait-il ruiner ce splendide départ? Il fait de la critique une science et non plus un art. Sainte-Beuve classe les écrivains en "familles d'esprits" et les explique par leur caractère ou par leur temps.( se référer à la critique littéraire de Carloni et Filloux P.28…. Taine soumet les faits littéraires ou artistiques à des lois et croit au déterminisme de la race, du milieu, du moment. Renan reconnaît au " savant seul le droit d'admirer" et affirme dans l'avenir de la science que " la vraie admiration est historique": Les "Pensées" de Pascal ou les "Sermons" de Bossuet, admirables en tant qu'œuvre du XVIIe siècle, mériteraient à peine d'être remarquées" si elles paraissaient de nos jours. Sainte-Beuve a su réagir au dogmatisme (qui suit un dogme très rigoureux) tainien ; dans l'un des Nouveaux Lundis, en 1864 il reprochait à Taine ,l'auteur de L'histoire de la littérature anglaise " de méconnaître ou de laisser inexpliquée la spécialité unique du talent , si imprévue". Mais n'allait-il point tenter de forcer cette dernière citadelle irréductible" en étudiant l'homme? Cette tentative courageuse méconnaissait comme l'a fait remarquer Proust dans son contre Sainte- Beuve "qu'un livre est le produit d'autre moi que celui que nous manifestons dans la société" L'œuvre critique de cet érudit, doublé d'un homme de goût, reste un monument, avec l'Histoire de Port-Royal, les Portraits, les Lundis. Tout se passe Critique littéraire 3 comme si, en véritable créateur, ou en véritable recréateur, ce biographe des âmes avait fait éclater les limites d'une méthode trop rigoureuse. Le temps des polémiques (critique qui attaque) L'âge des polémiques était ouvert, et dans l'arène des lettres allaient s'affronter critiques dogmatiques (comme Taine, Renan) et critiques impressionnistes (comme Sainte-Beuve). Brunetière (1849-1906) juge les œuvres au nom de valeurs intangibles (qu'on ne peut pas toucher), le " véritable" esprit français, la "véritable" morale et la "véritable" nature de chaque genre littéraire. ( se référer à la critique littéraire de Carloni et Filloux P. 46,47…. ). A ce nouveau système Jules Lemaître (1853-1914) et les impressionnistes opposent la sympathie immédiate, l'art de traduire le plus fidèlement possible les impressions qu'une œuvre produit sur la sensibilité de chacun.(voir Anatole France , Rémi de Gourmont , Gide , Alain …) . Le grand mérite de la critique historique, représentée en particulier par Gustave Lanson (1857-1934), est d'avoir avec beaucoup de sagacité, permis une conciliation entre ces 2 extrêmes, et uni la solidité de l'érudition (savoir qui est basé sur des recherches et des enquêtes.. etc.) aux exigences du goût. La connaissance de la biographie , du milieu, des influences n'est pour Lanson qu'une opération préliminaire permettant d'approfondir le plaisir esthétique. Sans doute " l'étude de la littérature ne saurait-elle se passer aujourd'hui d'érudition"; mais "si la lecture des textes originaux n'est pas l'illustration perpétuelle et le but dernier de l'histoire littéraire, celle-ci ne procure plus qu'une connaissance stérile et sans valeur" (Avant- propos de l'histoire de la littérature française, 1894). La méthode lansonienne, Critique littéraire 4 fondée sur l'établissement de bibliographies, sur l'étude des sources et l'examen des manuscrits, garde aujourd'hui encore toute sa valeur. Elle ne doit pas être confondue avec ce qu'on a appelé le "lansonisme", caricature ou déformation de cette doctrine, où la fiche tue l'esprit, et qui n'a guère eu d'existence que dans les travaux d'épigones (successeurs - imitateurs) maladroits ou dans l'esprit d'adversaires malveillants (malintentionnés). A la veille de la Première Guerre mondiale, l'exaspération des esprits élève le débat sur la critique à la hauteur d'un conflit "national". Maurras réhabilite la critique normative. Péguy, mû par sa ferveur patriotique, s'emporte contre la Sorbonne, bastion (forteresse) de "l'esprit historique" et du "parti intellectuel", et voit dans le lansonisme une invasion de l'esprit germanique c'était vouloir à tout prix, ici comme ailleurs, faire une mauvaise querelle. Mais la raison réelle était plus profonde et plus intéressante. Bergson était passé par là, " rompant les fers" en dénonçant l'intelligence comme un mode de connaissance imparfait, très inférieur à l'intuition infiniment plus accordée à l'infinie fluidité du courant de conscience dont, en définitive, est bien issue l'œuvre d'art. Au lieu de juger, au lieu d'expliquer, ne faut-il pas plutôt subtilement pénétrer dans "ce que voit un autre de cet univers qui n'est pas le même que le nôtre" (Proust), saisir le mouvement intime de la création littéraire en le revivant soi-même? L'étude de Proust sur Flaubert dans Chroniques, est bien supérieure, en ses quelques pages, au Flaubert publié en 1922 par Albert Thibaudet (1874-1936): les deux caractères de sa critique: description et dégustation. L'œuvre de Thibaudet est la manifestation la plus cohérente et la plus étendue du bergsonisme en critique littéraire. Une place prépondérante y est faite au sentiment de la mobilité et de la durée. Le danger d'une telle interprétation critique est de se substituer inconsciemment à l'auteur étudié. Les écrits critiques de Valéry, quelque brillants Critique littéraire 5 qu'ils soient, n'échappent pas toujours à ce piège. Hugo devient pour lui, un "créateur par la forme", comme l'auteur de Charmes lui-même; Bossuet lui apparaît comme une "trésor de figures, de combinaisons et d'opérations coordonnées", comme un temple dont l'architecture splendide cache un sanctuaire ,aujourd'hui désert .Bref , chaque écrivain devient un mythe où s'exprime la philosophie de la genèse littéraire propre à Valéry. L'apparente "variété" ne recouvre qu'une monotonie réelle, et dans le miroir du passé Narcisse ne cesse de retrouver sa propre image. La critique spiritualiste court un risque analogue. Elle feint de trouver, au terme d'un travail d'approximation, une dimension transcendante qu'elle ne fait en réalité que retrouver, puisqu'il s'agissait bien, sans que l'esprit en eût conscience, d'un a priori véritable. Les admirables pages de Péguy sur Corneille dans Victor-Marie comte Hugo et dans la Note conjointe témoignent moins d'une connaissance de l'auteur du Cid et de Polyeucte que d'une reconnaissance, à travers le prétexte qu'il constitue des thèmes familiers à Péguy lui-même : La tragédie du salut, le mystère de la communion des saints, l'enracinement du spirituel dans le charnel. Charles du Bos (1882-1939) fouille la "forêt obscure de l'âme d'autrui" pour en découvrir l'Âme au sens religieux du terme. La "voie sacrée" de Stefan George, la bénédiction de la douleur chez Baudelaire "le parfum d'éternité de la beauté spirituelle" chez Marcel Proust, mais aussi "l'esprit souterrain" de Dostoïevski ou le satanisme de Gide sont tributaires de la quête même "du spirituel dans l'ordre littéraire". De pénétrante, la critique se fait interprétative, et s'éloigne délibérément de l'ordre des sciences exactes. Aussi viennent se dresser en face de ces "hérétiques" les gardiens, ombrageux ou souriants, du rationalisme. Avec vigueur, et parfois même avec hargne, Julien Critique littéraire 6 Benda (1867-1955) oppose à la "critique pathétique" des chercheurs d'ineffable les droits d'un examen objectif. Pour Alain (1868-1951), comprendre n'a pas de fin, et tout, même la page écrite, mérite d'être passé au crible de l'élaboration abstraite. Clarifiée, elle devra aussi en sortir enrichie. De fait, ses " Propos sur la littérature", souvent lumineux, font saisir en un instant la vie ou la beauté d'une œuvre. Dans le sillage d'Alain ou de Benda comment ne pas citer Paul Léautaud (1872-1956) l'auteur du "théâtre de Maurice Boissard", acharné à déceler toute trace du Romantisme intempestif. La critique depuis 1845 L'après-guerre a vu se mêler les tendances les uploads/Litterature/ methodes-de-la-critique-litteraire.pdf
Documents similaires



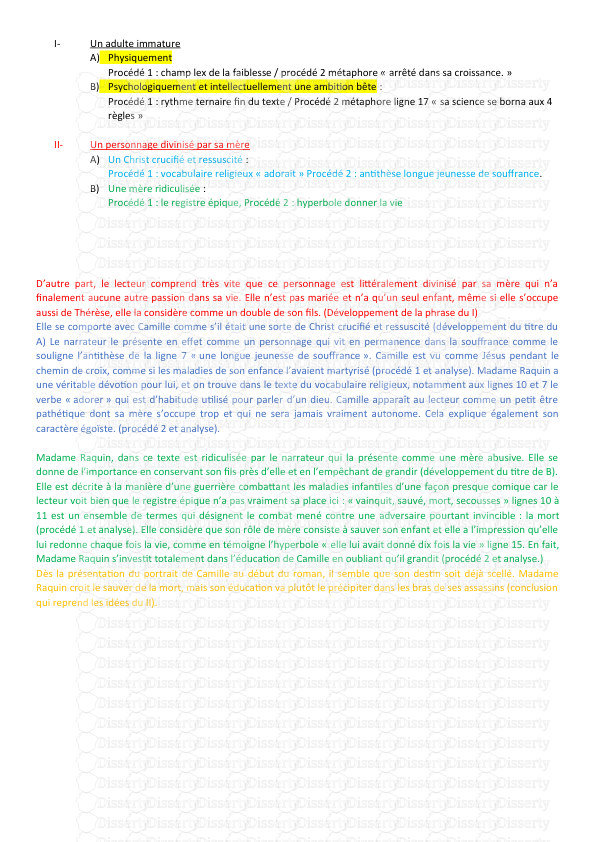






-
92
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 11, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.4113MB


