HAL Id: hal-00448759 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00448759 Submitted on
HAL Id: hal-00448759 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00448759 Submitted on 2 Feb 2016 HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of sci- entific research documents, whether they are pub- lished or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers. L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d’enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés. Rhétorique du menu gastronomique Jean-Philippe Dupuy To cite this version: Jean-Philippe Dupuy. Rhétorique du menu gastronomique. Communication langages, Nec Plus, 2009, pp.19-33. <hal-00448759> 1 Jean-Philippe DUPUY jean-philippe.dupuy@u-bourgogne.fr Rhétorique du menu gastronomique JEAN-PHILIPPE DUPUY Si le contenu de nos assiettes intéresse l’ethnologue, le sociologue, l’historien, le diététicien ou le critique gastronomique, le discours tenu autour de l’alimentation, qu’il soit produit par le consommateur1 ou le publicitaire, qu’il figure dans un livre de recettes2, sur un emballage de produit cuisiné3 ou sur une étiquette de vin4, constitue un terrain d’études privilégié pour qui veut savoir non ce que nous mangeons mais ce que nous croyons, désirons, détestons manger. A travers ces discours, ce sont nos croyances, nos représentations qui se dessinent et qui, plus sûres que le microscope ou l’éprouvette, révèlent le « vrai » goût des choses. Car le goût résulte certes des propriétés mêmes de l’aliment, appréhendées dans une synesthésie complexe, mais il est avant tout perçu, c’est- à-dire construit, sémantisé, en fonction d’une culture : « C’est cet ensemble donc, constitué de traces mnémoniques issues des consommations antérieures, des expériences sensorielles, des apprentissages sociaux et des expériences individuelles, qui permet en fin de compte d’aboutir au “goût de l’aliment”»5. L’un de ces discours, le menu, entendu comme la « liste détaillée des mets dont se compose un repas »6, semble susciter un moindre intérêt, vraisemblablement parce qu’on lui reconnaît une simple fonction auxiliaire de dénomination. Derrière « Crudités/ Gigot d’agneau/ Haricots verts / Tarte aux pommes », on ne voit en effet le plus souvent que l’annonce syntagmatique des aliments proposés successivement à la consommation. Nous voudrions montrer au contraire que le menu peut aussi se lire comme un texte, qui nous en dit forcément plus qu’il ne le prétend : pour nous, le menu est à considérer non dans ce qu’il dénomme et dénote –ce qui serait l’objet d’une rhétorique alimentaire7, mais bien plutôt dans ce que révèlent les choix rhétoriques qu’il met en œuvre. Le corpus Notre corpus est constitué des menus proposés par les vingt-six restaurants français trois étoiles8 (guide Michelin 2007). Ce choix peut sembler inutilement restrictif : l’usage 1 Voir notamment Jean-Pierre Corbeau, Jean-Pierre Poulain, Penser l’alimentation, Privat, Paris, 2002 ; Pierre Bourdieu, Intervention au Congrès de l'AFEF, Limoges, 30 octobre 1977, parue dans Le français aujourd'hui, 41, mars 1978, p. 4-20 et Supplément au n° 41, pp. 51-57. Repris dans Questions de sociologie, Les éditions de Minuit, 1980, p 95- 112. 2 Voir par exemple Faustine Regnier, Anne Lhuissier, Séverine Gojard, Sociologie de l’alimentation, La Découverte, Paris, 2006 ; Jean-Louis Flandrin, Massimo Montanari, Histoire de l’alimentation, Fayard, Paris, 1996. 3 Benoît Heilbrunn, « Quand les marques donnent de la voix », Les voies du goût Rencontres BIAC 2007 (à paraître). 4 Yves Jeanneret, Emmanuel Souchier, « L’étiquette de vins : analyse d’un objet ordinaire », Communications & Langages, n°121, 1999. 5 Matty Chiva, « L’innovation alimentaire : de la construction du goût aux assiettes », Sciences Humaines n°75, août septembre 1997, p.46-51. 6 Le Nouveau Petit Robert, édition 1993, p.1386. 7 Roland Barthes, L’aventure sémiologique, Seuil, Paris, 1985, p.31. 8Frédéric Anton (Le Pré Catelan), Georges Blanc (Georges Blanc), Paul Bocuse (Bocuse), Michel Bras (Bras), Alain Ducasse (Plaza Athénée), Michel Guérard (Les Prés d’Eugénie), Pierre Gagnaire (Pierre Gagnaire), Marc Haeberlin (L'Auberge de l'Ill), Jean Georges Klein (L’Arnsbourg), Christian Le Squer (Pavillon Ledoyen), Jean-Michel Lorain (La Côte Saint-Jacques), Régis et Jacques Marcon (Le Clos des Cimes), Guy Martin (Le Grand Véfour ), Alain Passard (L’Arpège), Anne Sophie Pic (Maison Pic), Olivier Roellinger (Les maisons de Bricourt), Guy Savoy (Guy Savoy), Michel Trama (Les Loges de l’Aubergade), 2 des procédés rhétoriques n’est ni l’apanage des restaurants étoilés, ni un gage de qualité gastronomique ; en droit, rien n’interdit à une cantine de proposer, comme O. Roellinger, un « assaisonnement flibustier pour l’avocat[…] » ou un « blanc de barbue aux épices des minorités »... Dans les faits, on constate cependant une relation culturellement bien établie entre prétention gastronomique et usage de la rhétorique : le cuisinier populaire, par autocensure, renoncera le plus souvent à des énoncés qui lui sembleront trop pompeux, et le client considérerait comme de la « poudre aux yeux » des procédés discursifs par trop appuyés. Pour le consommateur, la rhétorique (cet écart avec une façon « normale », habituelle d’exprimer le réel) semble en effet ne se justifier qu’en cas de plus-value gastronomique ; sans quoi, elle sera perçue comme un simple artifice, voire une tromperie. Son usage ne va donc pas sans risque ; risque que tout restaurateur n’est pas disposé à assumer mais que le chef étoilé pourra prendre sans hésiter : la qualité gustative des mets proposés étant garantie par des autorités de référence, le déploiement de tels procédés apparaît sans danger ; le cuisinier pourra se faire poète, imaginer des intitulés sémantiquement obscurs, jouer avec et sur les mots, déjouer les attentes et les certitudes, on lui pardonnera tout ! Les menus étoilés constituent ainsi un corpus privilégié dans la mesure où s’y exprime un discours libéré de la plupart des contraintes habituelles du menu.. Quelques précisions encore : tout d’abord, ce qui nous intéresse, ce que nous allons analyser, c’est bien le menu et non la cuisine que le menu préfigure : c’est le signifiant et (hélas !) non le référent ; notre but est bien de montrer comment fonctionne le discours gastronomique, ce qu’il révèle et ce qu’il produit, et non de nous attacher aux variations de la cuisine contemporaine. Notons encore que nous n’envisagerons que le contenu linguistique des menus ; or il est bien évident qu’ « il n’est pas de texte qui, pour advenir aux yeux du lecteur, puisse se départir de sa livrée graphique », qu’il faudrait « considérer le texte à travers sa matérialité (couverture, format, papier…), sa mise en page, sa typographie ou son illustration, ses marques éditoriales variées (auteur, titre ou éditeur), sans parler des marques légales et marchandes (ISBN, prix ou copyright)… »9; bref il serait nécessaire, pour être complet, de tenir les menus en main pour y déceler toutes les traces d’ « énonciation éditoriale ». Dans l’attente d’en faire l’expérience in situ, par une pratique régulière et attentive des grandes tables, nous nous concentrerons exclusivement sur le texte verbal. La rhétorique en question Mais s’agit-il bien de rhétorique 10? Rappelons que la renaissance de cet art dans les années 1960 a donné naissance à son tour à deux néo-rhétoriques11, la première consacrée à l’étude des mécanismes argumentatifs, la seconde (parfois appelée « rhétorique restreinte ») à celle des figures ; ce que résume par exemple Philippe Breton : « Toute l’histoire de la Michel Troisgros (Troisgros), Marc Veyrat (La Maison de Marc Veyrat), Eric Westermann (Buerehiesel). Les menus ont été collectés à partir des sites WEB des restaurants (date de consultation : 25/08/2007) ; notons que certains restaurants prestigieux affirment leur différence en choisissant de ne pas proposer de site WEB, ou de ne faire figurer sur le WEB qu’une simple page de coordonnées. 9 Emmanuel Souchier, « L’image du texte : pour une théorie de l’énonciation éditoriale », Les cahiers de médiologie n°6, Gallimard, Paris, 1998 ; p.138. 10 « Quoiqu’indéfiniment reprise voire galvaudée, l’expression “rhétorique de l’image” reste souvent une sorte de fourre-tout mal compris, lorsqu’elle ne sert pas tout simplement de poudre aux yeux », constate Martine Joly (Martine Joly, Introduction à l’analyse de l’image, Nathan Université, Paris, 1993-1999, p.65) . On en dira presque autant du simple terme de « rhétorique ». 11 Jean-Marie Klinkenberg, Précis de sémiotique générale, Points, Paris, 1996. 3 rhétorique, l’ancien “art de convaincre”, est traversée […] par la place que doit occuper le “plaire” ou l’“émouvoir” par rapport au strict raisonnement argumentatif »12. Le menu de restaurant est-il un terrain propice à la rhétorique ? On pourrait penser en première analyse qu’il n’en est rien, en raison du caractère contraint du menu : la taille de chaque énoncé (quelques mots en général), l’impossibilité d’utiliser toute structure syntaxique complexe (on verra que l’énoncé est le plus souvent constitué d’un substantif complété d’éventuelles expansions), la nécessité d’inclure des éléments légaux (origine des produits, appellations), semblent rendre improbable le développement d’une stratégie du plaire et du convaincre. Ce serait mal connaître les ressources de cet art ! Avec son « Hamburger de foie gras », M. Trama nous convainc du caractère à la fois traditionnel et iconoclaste de sa cuisine en jouant de l’oxymore ; et lorsque Y. Alléno nous propose uploads/Litterature/ rhetorique-du-menu-gastronomique.pdf
Documents similaires








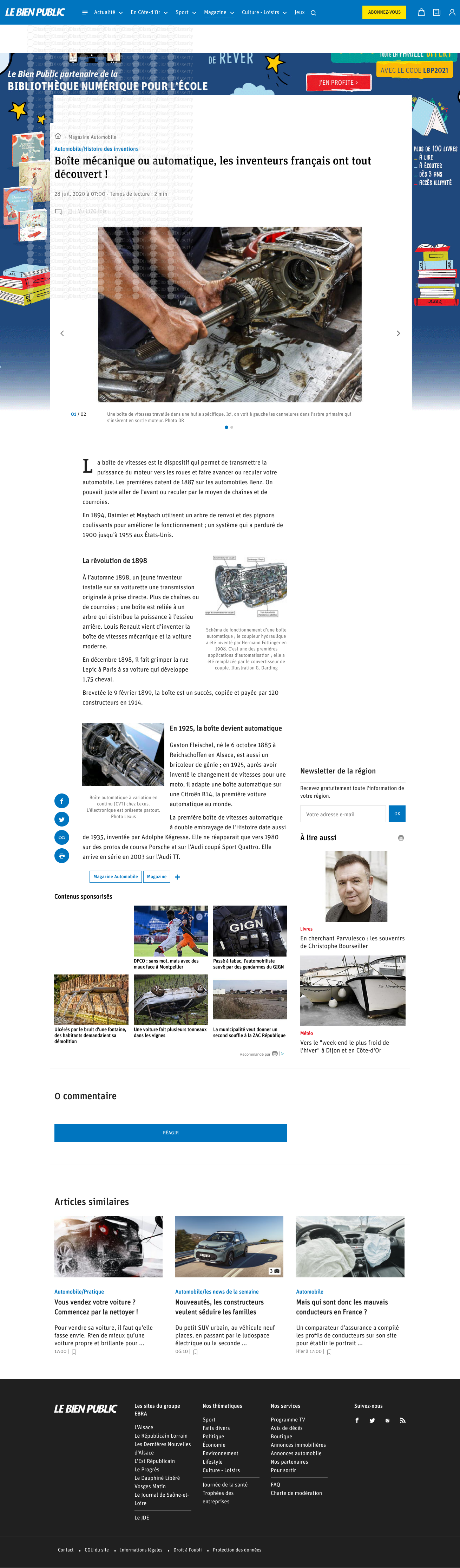

-
76
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 13, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.3738MB


