Communications Une généalogie du structuralisme Tomáš Glanc, Stéphanie Cirac, P
Communications Une généalogie du structuralisme Tomáš Glanc, Stéphanie Cirac, Philippe Roussin Citer ce document / Cite this document : Glanc Tomáš, Cirac Stéphanie, Roussin Philippe. Une généalogie du structuralisme. In: Communications, 103, 2018. Le formalisme russe cent ans après. pp. 197-211; https://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_2018_num_103_1_2921 Fichier pdf généré le 27/08/2021 Résumé Une généalogie du structuralisme. Quels liens relient le formalisme au structuralisme ? L’article suggère que toute théorie est aussi une narration qui peut être analysée à partir du contexte de son élaboration et du parcours de ses auteurs – Roman Jakobson, René Wellek, Jan Mukarovský, suivis de la jeune génération des années 1960. Le récit qui se dégage ne suit pas toujours une ligne claire et continue ; en étudiant ce type de construction narrative, on saisit ses mutations, ruptures et silences. L’article interroge ces silences en montrant que ceux-ci peuvent être porteurs de sens. Dans son analyse des transferts de connaissance entre les mouvements formaliste et structuraliste, l’auteur s’intéresse à la réception de ces théories, et fait ressortir les clichés qu’ont pu véhiculer certaines représentations, souvent idéologiques, ainsi que les écarts qui ont distingué à l’époque les lectures occidentales et tchécoslovaques de ces théories, et, partant, de leurs liens. Resumen Una genealogía del estructuralismo. ¿ Qué vínculos unen el formalismo con el estructuralismo ? Este artículo sugiere que toda teoría es también una narración que puede analizarse a partir del contexto de su elaboración y de la trayectoria de sus autores — Roman Jakobson, René Wellek, Jan Mukarovský, y luego la joven generación de los años 60. El relato que se desprende no siempre sigue una línea clara y continua ; estudiando este tipo de construcción narrativa, se entienden sus mutaciones, rupturas y silencios. El artículo cuestiona esos silencios mostrando que pueden ser significativos. En su análisis de las transferencias de conocimiento entre el movimiento formalista y el estructuralista, el autor se interesa por la recepción de estas teorías, recalcando los clichés que pudieron acarrear algunas representaciones, a menudo ideológicas, así como las diferencias que caracterizaron, en la época, las lecturas occidentales y checoeslovacas de dichas teorías, y por consiguiente los vínculos entre ambas. Abstract A Genealogy of Structuralism. What are the links between formalism and structuralism ? This article suggests that all theories are also a narration that can be analyzed based on the context of their development and the journey of their authors — Roman Jakobson, René Wellek, Jan Mukarovský, followed by the young generation of the 1960s. The narrative does not always follow a clear and continuous line ; when studying this type of narrative construction, one seizes mutations, ruptures, and silences. The article looks at these silences, showing that they may be meaningful. In this analysis of the transfers of knowledge between the formalist and the structuralist movements, the author looks at the reception of these theories and brings out the clichés that may have conveyed certain representations, often of an ideological nature, as well as the gaps which, at the time, characterized Western and Czechoslovak readings of these theories and thus the links between them. 197 Tomáš Glanc Une généalogie du structuralisme L’importance de la contribution est-européenne à la théorie de la littérature du xxe siècle n’est plus à démontrer. Elle est particulièrement évidente dans le cas du formalisme russe, en dépit de la relative confusion qui entoure l’expression de « formalisme est-européen ». La formule est de René Wellek, qui y a eu recours, dès 1936, lorsqu’il a voulu attirer l’attention sur la substitution de la notion de « forme » à celle de « structure » au sein de l’école pragoise 1 et, ensuite en 1946, lorsqu’il a intégré Roman Ingarden au formalisme 2. Son interprétation a dominé les théories littéraires américaines, jusqu’au post-structuralisme, et marxiste (Kurt Konrad) 3. Les structuralistes tchèques des années 1960, eux, ont ignoré la proximité des écoles russe et tchèque et ont préféré actualiser les positions théoriques qui avaient été celles de Konrad pendant l’entre-deux-guerres et les croiser avec la pensée de Jan Mukarovský 4. La procession victorieuse et le développement continu du formalisme-structuralisme le long de l’axe Moscou-Prague-Paris relèvent d’une histoire intellectuelle, qui s’apparente beaucoup à la construction d’un « grand récit ». Une analyse plus fine fait apparaître de nombreuses divergences entre les travaux de chercheurs pourtant considérés comme très proches les uns des autres – Šklovskij et Jakobson, ou Jakobson et Mukarovský 5. Lorsque l’on veut appréhender la manière dont l’histoire de cette pensée théorique s’est écrite, on se trouve confronté à une série d’études disparates portant sur des points particu- liers. La question centrale à laquelle mon article s’efforcera de répondre est, dès lors, la suivante : comment se construit un récit de la pensée théorique et de ses sources, de ses continuités et de ses mutations, et comment ce récit influence-t-il son objet scientifique ? Lorsque l’on se réfère aux déclarations des protagonistes, il faut garder à l’esprit qu’ils ont eux-mêmes épousé la logique de leur autobiographie intellec- tuelle. Toute une série d’histoires apparaissent alors, qui ouvrent sur le « dévelop- pement continu » d’un certain type de récits portant sur le « climat spirituel », sur le « structuralisme tchèque » ou encore sur le « formalisme dogmatique » 6. La Tomáš Glanc 198 situation est d’autant plus complexe qu’aux côtés de travaux qui font autorité on rencontre des interprétations qui montent en épingle tel ou tel concept particulier mais qui se trouvent être fondées sur des malentendus. La confusion règne en matière de faits, de termes, d’objectifs ou d’influences. Le livre de Jan Broekman publié en 1974 et consacré au structuralisme, Structuralism : Moscow, Prague, Paris, en est un exemple. L’auteur analyse le formalisme russe, le symbolisme, le futurisme et le marxisme, et traite également du Cercle linguistique de Prague (CLP), sans maîtriser le russe ni le tchèque, en s’appuyant sur les rares traduc- tions disponibles, sans tenir compte de la critique de Saussure et du formalisme formulée par Jakobson dans ses travaux du début des années 1930, ni non plus des débats sur le structuralisme dans la Tchécoslovaquie des années 1960, qu’il réduit au livre Dialectique concrète de Karel Kosík. Lubomír Doležel a livré la critique en règle d’un autre opus, bien plus influent, mais qualifié par lui d’« inepte » – le best-seller de Terry Eagleton, Théorie de la littérature. Introduction (1983), selon qui l’école pragoise aurait représenté un chaînon intermédiaire entre le forma- lisme et le structuralisme, inspiré de Ferdinand de Saussure, et aurait éliminé le sujet. De telles affirmations relèvent, pour Doležel, d’un aveuglement ridicule 7. Eagleton, néo-marxiste irlandais, déçu par l’élitisme des études littéraires univer- sitaires, a écrit une histoire populaire, « démocratique », de la théorie de la litté- rature, devenue un manuel de référence traduit dans des dizaines de langues, y compris en arabe et en sanscrit. Le canon qui en a résulté, fondé sur des approxi- mations et des formulations vagues, a été répété à l’infini. Si l’idéologie d’Eagleton prétend à un fondement démocratique, la théorie communiste de la littérature a, elle, reproché au formalisme et au structuralisme leur distance à l’égard du peuple et leurs tendances « antipopulaires ». Les racines du schéma « populaire versus formalisme » remontent à l’année 1936, qui marque le début d’une nouvelle ère dogmatique dans les domaines de l’esthétique et de la connaissance en Union soviétique 8. Tout le monde reconnaît aujourd’hui la fécondité des recherches théoriques menées pendant la première moitié du xxe siècle en Russie, en Tchécoslovaquie comme en Pologne (bien que des travaux fondamentaux n’aient toujours pas été traduits). Si l’on s’interroge, du point de vue de l’histoire et du transfert des idées et des connaissances, sur le rôle que les travaux des représentants de la méthode formelle et du CLP ont pu jouer et sur la manière dont ils l’ont fait, on doit constater qu’une grande part d’inconnu et nombre de malentendus demeurent. Le courant philosophique qui s’est intéressé à la question de la forme ainsi que les travaux menés par les chercheurs des deux institutions soviétiques qu’étaient l’Académie d’État des sciences artistiques (GAXN, 1921-1930) et l’Institut d’État d’histoire de l’art (GIII, 1912-1931) 9 ont produit un vaste corpus de connaissances, qui n’a, jusque récemment, été étudié que de manière fragmentaire. La réception, ses spécificités ou son absence, n’a pas été analysée – ou de façon très sommaire. Une généalogie du structuralisme 199 Le point de vue adopté par le chercheur, on le sait, influence l’interprétation et il n’est donc pas sans conséquence. Emil Volek, qui a longtemps fréquenté les milieux académiques nord-américains 10, a cherché à définir les interac- tions entre le point de vue de l’observateur et la cartographie théorique qu’il est susceptible de dresser. Considéré du point de vue tchèque, écrit-il, le structura- lisme tchèque ouvre une fenêtre sur le monde et témoigne de la valeur et de la dimension internationale des chercheurs tchèques ; pour un point de vue inter national, il constitue une arrière-scène de l’Opojaz et du structuralisme français 11. C’est une autre perspective encore que découvre uploads/Litterature/ une-ge-ne-alogie-du-structuralisme.pdf
Documents similaires






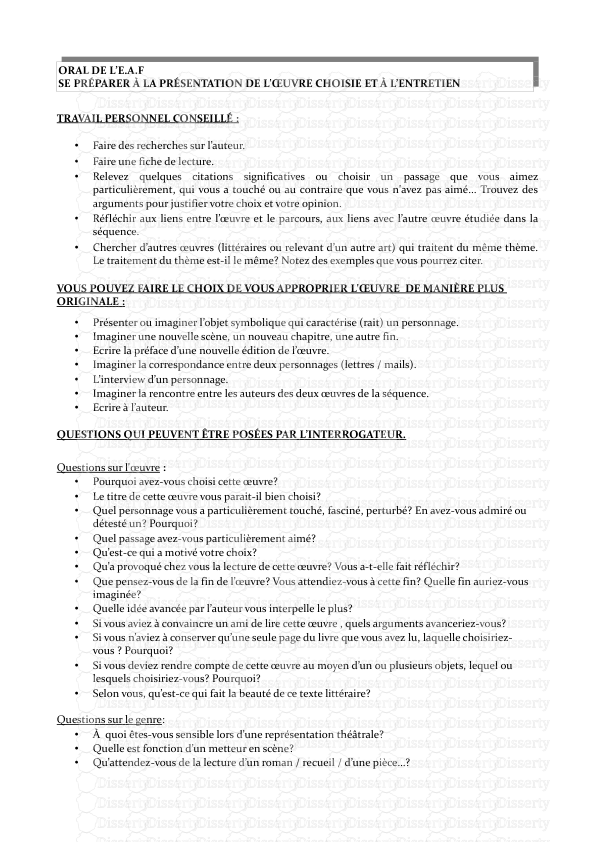



-
74
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 22, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.3240MB


